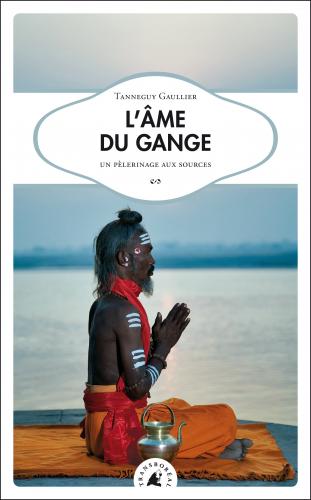
Les chevaucheurs de vent :
« À Lakhisarai, j’entrai sur les terres du Bouddha. Comme Jésus, Siddhârtha Gautama marchait beaucoup et enseignait de place en place. Il avait également besoin de périodes de solitude et vécut trois ans en ermitage près de Lakhisarai. À l’époque, le lieu hébergeait de nombreux monastères aujourd’hui disparus. En traversant la ville, je fus hélé par un homme penché à la fenêtre du deuxième étage d’une maison. Il voulait m’interviewer pour le journal local. Des curieux vinrent l’aider car son anglais était sommaire. Ce journaliste me disait avoir interviewé, dix ans auparavant, un Allemand qui traversait l’Inde à vélo. Apparemment, j’étais le deuxième Blanc qu’il rencontrait en dix ans…
Lorsque je m’installais dans des gargotes pour déjeuner, la nouvelle de l’arrivée d’un étranger en ville courait si vite qu’en cinq minutes j’étais entouré par une trentaine de personnes venues me poser des questions. L’enthousiasme des Indiens rendait ces échanges très comiques. Tout le monde me regardait en souriant. Mes moindres faits et gestes étaient analysés et commentés. Parfois un journaliste arrivait avec son calepin. Il voulait tout savoir, jusqu’au nom de mes parents et au nombre de mes frères et sœurs. Ainsi, j’ai été interviewé une dizaine de fois pendant ma marche.
Après le déjeuner, je décidai de repartir vers les berges du Gange particulièrement vastes au Bihar. Lors de cette randonnée gangétique, trois types de progression m’étaient offerts. Bien que je suivisse souvent les rives, pour profiter du calme et de la beauté des paysages, il était épuisant de marcher dans le sable et dans les marécages, de franchir les cours d’eau et de subir un soleil sans ombre. Sur la route, j’avançais plus vite. Je pouvais me ravitailler et rencontrer les gens. Quand la route faisait une grande boucle, je partais à travers champs, en suivant l’aiguille de ma boussole. Alors, c’était la belle échappée ! Dans ces moments coupés du monde, je me sentais davantage relié à la nature. C’était magique ! La campagne resplendissait de la blondeur des champs de sénevé. Vive, la lumière exaltait toute la gamme des teintes vertes. Le soleil paraissait s’admirer aux reflets des étangs. Les feuilles des arbres bruissaient dans le vent avec des sons de pipeau. Cette plaine immense était un grand jardin sauvage et opulent.
Ainsi, j’étais exalté, je l’avoue. Croyez-le ou non, je vivais ces moments où la pensée s’arrête pour laisser place à la sensation tout entière. Dans cette campagne dorée de soleil, qui se déployait en espaces infinis et tranquilles, ce que je voyais me semblait si spontané, limpide et inaltéré que j’avais l’impression de percevoir le monde, comme pour la première fois, à travers une conscience sans voile. J’étais parfaitement uni au présent et renouvelais mes sens. Je pensais à “mes frères de rêves”, comme disait Pierre Loti, à ces esthètes que la beauté de la nature enivre. Par exemple, j’imaginais converser avec la voyageuse Blanche de Richemont, cette passionnée du désert. Dans son Manifeste vagabond, elle écrivit ces belles pensées qui m’accompagnent : “Les êtres qui se sont mis au service de la terre et du divin à travers elle ne sont plus atteints par la médiocrité. Ils ont longuement marché pour apprendre à voir Dieu dans le vol d’un oiseau. La nature les pousse à être plus vastes qu’eux-mêmes. Une expansion inévitable de l’être naît de cette osmose. Toute leur relation au monde est élevée à un niveau spirituel. Ils savent qu’ils participent à un ensemble cosmique, qu’ils sont reliés aux entrailles de l’univers.”
Comme c’est vrai ! Les amoureux de la nature sont des êtres religieux. Ces passionnés ressentent fortement le lien qui les unit à la terre. Consciemment ou non, ils discernent une signature dans les manifestations de la vie. Percevant l’harmonie, l’équilibre, l’interdépendance des éléments de l’univers, ils savent que la beauté est ce qu’il y a de plus précieux et qu’elle est en partage. Aussi disent-ils, comme la Brhadâranyaka-upanishad : “La terre que voici est du miel pour tous les êtres, et tous les êtres sont du miel pour cette terre.”
Dans ces étendues sans limites, je vivais en communion avec la nature. Les paysages étaient harmonieux. L’animalité se faisait majestueuse. Jamais je n’avais été autant émerveillé par la couleur des oiseaux. Tandis que de grands hérons blancs volaient dans le ciel, des oiseaux aux plumes quasi fluorescentes gambadaient près de moi. Il y avait des martins-pêcheurs de toutes les couleurs : bleus, verts, tachetés de blanc ou violets à coiffe noire. Avec leur houppette ocre sur la tête, des huppes fasciées sautillaient dans les herbes, sans crainte de s’approcher du promeneur. C’est drôle car leur nom vient de leur cri qui ressemble à un “houp-oup-oup”. Je me souviens également de ces minuscules oiseaux d’un bleu saphir, éloge à la délicatesse, miracle si admirable que l’homme les a honorés du beau nom de “monarques bleus”.
C’est pourquoi je pensais aux odes qu’on trouve dans les Veda. À ces beaux hommages au soleil, à la nuit, au vent, aux saisons, aux animaux, aux plantes, à l’eau, au feu… À tous ces éléments qui nous sont si proches mais avec lesquels nous ne dialoguons plus. Ces poèmes chantaient l’émerveillement du monde. Ils glorifiaient l’intime présence de Dieu dans la création. Cette poésie incantatoire cherchait à participer au miracle de la vie, ses auteurs considérant la nature comme une réalité physique, psychique et spirituelle. Dans l’Atharva-Veda, écrit il y a trois mille ans, on peut lire de tels hymnes, comme cette célébration de la terre, preuve d’une alliance que d’anciennes cultures ont su établir mieux que nous :
Ô Terre, porteuse de toutes choses, réceptacle de biens, contrefort, poitrine dorée. Tu es celle qui soutient le Feu universel. Ô Terre, les cinq races d’hommes sont tiennes, les mortels pour qui l’immortelle lumière s’étend sous les rayons du soleil levant. Haute réalité, loi rigoureuse, sacrement, ferveur, prière, sacrifice soutiennent la Terre ! Les dieux la gardent nuit et jour sans dormir, la vaste Terre, sans défaillance. Au plus haut firmament est son cœur, cœur immortel de la Terre enveloppé de vérité. Veuille la Terre nous assigner éclat et force dans un empire souverain !
Lors de ces échappées, je découvrais également des villages isolés, desservis uniquement par des sentiers. La surprise accompagnait toujours mon approche. La stupeur, les exclamations et les rires, particulièrement des enfants, escortaient ma marche. Les habitants ne circulaient qu’à pied, à cheval ou à bicyclette. Les jeunes enfants se promenaient nus. Tout ce monde semblait vivre hors du temps. Les activités se réalisaient avec lenteur. Il n’y avait pas de magasins. Puits, lavoirs, maisons, outils étaient antédiluviens. Ces villageois avaient à la fois l’air d’être très occupés et de ne rien avoir à faire d’important. Souvent, une personne me conduisait à l’autre bout du village pour me montrer la route à suivre car, dans l’entrelacs des ruelles en terre, il était impossible de savoir par où passer. D’ailleurs, il y avait toujours conciliabule pour déterminer s’il valait mieux prendre tel chemin ou tel autre afin de traverser le village.
Dans l’un de ces hameaux se trouvait un petit poste de police. On m’y invita à prendre le thé. J’avais l’impression d’être dans un poste avancé du Far West tant on semblait être à l’écart de la civilisation. De plus, le style des policiers était à mi-chemin entre celui de l’aventurier et celui du shérif. Ils portaient de longues moustaches, des vêtements de brousse et un pistolet à la ceinture. L’un d’eux m’accompagna pendant plus d’une heure pour assurer ma sécurité. D’évidence, il n’y avait aucun danger, mais cela lui semblait être son devoir de protéger l’étranger qui passait. Quand, à mon approche, les villageois, intrigués, se dirigeaient vers moi, mon garde du corps leur disait de s’écarter pour me laisser passer. Il criait sur la foule qui selon lui dérangeait mon voyage. J’étais à la fois désolé et amusé. Puis nous nous arrêtâmes pour regarder des musiciens jouer jusqu’à la frénésie du tabla, du kangeera, du sarode, de l’harmonium et de la flûte bansuri. Assis par terre, ils remuaient de droite à gauche, pris par l’exaltation des rythmes. J’étais happé par le spectacle. Enfin, après avoir traversé plusieurs villages, le policier m’indiqua la direction à suivre pour retrouver la route.
Dans ces moments-là, mes plus grandes joies m’étaient données par les enfants. Ils venaient m’entourer lorsque je m’asseyais quelque part. Leurs expressions étaient incroyables : il y avait chez eux un surprenant mélange de curiosité, d’incompréhension, de joie et d’attente. Un jour, je compris qu’il y avait aussi de la défiance. En effet, alors que je leur offrais des gâteaux, le père de l’un d’entre eux, sachant que son fils n’osait pas les accepter, le poussa dans ma direction mais l’enfant se mit crier. Alors il prit son fils dans ses bras pour l’approcher de moi, quoique je fisse manifestement peur à son enfant. C’était pourtant celui qui semblait le plus captivé par ma présence et me posait le plus de questions en hindi. Finalement, quand je repris la route, c’est aussi celui qui, paradoxalement, m’accompagna tout joyeux pendant un kilomètre. »
Des millions d’âmes en prière (p. 260-265)
Kedarnath, Badrinath et Gaumukh (p. 381-387)
Extrait court
« À Lakhisarai, j’entrai sur les terres du Bouddha. Comme Jésus, Siddhârtha Gautama marchait beaucoup et enseignait de place en place. Il avait également besoin de périodes de solitude et vécut trois ans en ermitage près de Lakhisarai. À l’époque, le lieu hébergeait de nombreux monastères aujourd’hui disparus. En traversant la ville, je fus hélé par un homme penché à la fenêtre du deuxième étage d’une maison. Il voulait m’interviewer pour le journal local. Des curieux vinrent l’aider car son anglais était sommaire. Ce journaliste me disait avoir interviewé, dix ans auparavant, un Allemand qui traversait l’Inde à vélo. Apparemment, j’étais le deuxième Blanc qu’il rencontrait en dix ans…
Lorsque je m’installais dans des gargotes pour déjeuner, la nouvelle de l’arrivée d’un étranger en ville courait si vite qu’en cinq minutes j’étais entouré par une trentaine de personnes venues me poser des questions. L’enthousiasme des Indiens rendait ces échanges très comiques. Tout le monde me regardait en souriant. Mes moindres faits et gestes étaient analysés et commentés. Parfois un journaliste arrivait avec son calepin. Il voulait tout savoir, jusqu’au nom de mes parents et au nombre de mes frères et sœurs. Ainsi, j’ai été interviewé une dizaine de fois pendant ma marche.
Après le déjeuner, je décidai de repartir vers les berges du Gange particulièrement vastes au Bihar. Lors de cette randonnée gangétique, trois types de progression m’étaient offerts. Bien que je suivisse souvent les rives, pour profiter du calme et de la beauté des paysages, il était épuisant de marcher dans le sable et dans les marécages, de franchir les cours d’eau et de subir un soleil sans ombre. Sur la route, j’avançais plus vite. Je pouvais me ravitailler et rencontrer les gens. Quand la route faisait une grande boucle, je partais à travers champs, en suivant l’aiguille de ma boussole. Alors, c’était la belle échappée ! Dans ces moments coupés du monde, je me sentais davantage relié à la nature. C’était magique ! La campagne resplendissait de la blondeur des champs de sénevé. Vive, la lumière exaltait toute la gamme des teintes vertes. Le soleil paraissait s’admirer aux reflets des étangs. Les feuilles des arbres bruissaient dans le vent avec des sons de pipeau. Cette plaine immense était un grand jardin sauvage et opulent.
Ainsi, j’étais exalté, je l’avoue. Croyez-le ou non, je vivais ces moments où la pensée s’arrête pour laisser place à la sensation tout entière. Dans cette campagne dorée de soleil, qui se déployait en espaces infinis et tranquilles, ce que je voyais me semblait si spontané, limpide et inaltéré que j’avais l’impression de percevoir le monde, comme pour la première fois, à travers une conscience sans voile. J’étais parfaitement uni au présent et renouvelais mes sens. Je pensais à “mes frères de rêves”, comme disait Pierre Loti, à ces esthètes que la beauté de la nature enivre. Par exemple, j’imaginais converser avec la voyageuse Blanche de Richemont, cette passionnée du désert. Dans son Manifeste vagabond, elle écrivit ces belles pensées qui m’accompagnent : “Les êtres qui se sont mis au service de la terre et du divin à travers elle ne sont plus atteints par la médiocrité. Ils ont longuement marché pour apprendre à voir Dieu dans le vol d’un oiseau. La nature les pousse à être plus vastes qu’eux-mêmes. Une expansion inévitable de l’être naît de cette osmose. Toute leur relation au monde est élevée à un niveau spirituel. Ils savent qu’ils participent à un ensemble cosmique, qu’ils sont reliés aux entrailles de l’univers.”
Comme c’est vrai ! Les amoureux de la nature sont des êtres religieux. Ces passionnés ressentent fortement le lien qui les unit à la terre. Consciemment ou non, ils discernent une signature dans les manifestations de la vie. Percevant l’harmonie, l’équilibre, l’interdépendance des éléments de l’univers, ils savent que la beauté est ce qu’il y a de plus précieux et qu’elle est en partage. Aussi disent-ils, comme la Brhadâranyaka-upanishad : “La terre que voici est du miel pour tous les êtres, et tous les êtres sont du miel pour cette terre.”
Dans ces étendues sans limites, je vivais en communion avec la nature. Les paysages étaient harmonieux. L’animalité se faisait majestueuse. Jamais je n’avais été autant émerveillé par la couleur des oiseaux. Tandis que de grands hérons blancs volaient dans le ciel, des oiseaux aux plumes quasi fluorescentes gambadaient près de moi. Il y avait des martins-pêcheurs de toutes les couleurs : bleus, verts, tachetés de blanc ou violets à coiffe noire. Avec leur houppette ocre sur la tête, des huppes fasciées sautillaient dans les herbes, sans crainte de s’approcher du promeneur. C’est drôle car leur nom vient de leur cri qui ressemble à un “houp-oup-oup”. Je me souviens également de ces minuscules oiseaux d’un bleu saphir, éloge à la délicatesse, miracle si admirable que l’homme les a honorés du beau nom de “monarques bleus”.
C’est pourquoi je pensais aux odes qu’on trouve dans les Veda. À ces beaux hommages au soleil, à la nuit, au vent, aux saisons, aux animaux, aux plantes, à l’eau, au feu… À tous ces éléments qui nous sont si proches mais avec lesquels nous ne dialoguons plus. Ces poèmes chantaient l’émerveillement du monde. Ils glorifiaient l’intime présence de Dieu dans la création. Cette poésie incantatoire cherchait à participer au miracle de la vie, ses auteurs considérant la nature comme une réalité physique, psychique et spirituelle. Dans l’Atharva-Veda, écrit il y a trois mille ans, on peut lire de tels hymnes, comme cette célébration de la terre, preuve d’une alliance que d’anciennes cultures ont su établir mieux que nous :
Ô Terre, porteuse de toutes choses, réceptacle de biens, contrefort, poitrine dorée. Tu es celle qui soutient le Feu universel. Ô Terre, les cinq races d’hommes sont tiennes, les mortels pour qui l’immortelle lumière s’étend sous les rayons du soleil levant. Haute réalité, loi rigoureuse, sacrement, ferveur, prière, sacrifice soutiennent la Terre ! Les dieux la gardent nuit et jour sans dormir, la vaste Terre, sans défaillance. Au plus haut firmament est son cœur, cœur immortel de la Terre enveloppé de vérité. Veuille la Terre nous assigner éclat et force dans un empire souverain !
Lors de ces échappées, je découvrais également des villages isolés, desservis uniquement par des sentiers. La surprise accompagnait toujours mon approche. La stupeur, les exclamations et les rires, particulièrement des enfants, escortaient ma marche. Les habitants ne circulaient qu’à pied, à cheval ou à bicyclette. Les jeunes enfants se promenaient nus. Tout ce monde semblait vivre hors du temps. Les activités se réalisaient avec lenteur. Il n’y avait pas de magasins. Puits, lavoirs, maisons, outils étaient antédiluviens. Ces villageois avaient à la fois l’air d’être très occupés et de ne rien avoir à faire d’important. Souvent, une personne me conduisait à l’autre bout du village pour me montrer la route à suivre car, dans l’entrelacs des ruelles en terre, il était impossible de savoir par où passer. D’ailleurs, il y avait toujours conciliabule pour déterminer s’il valait mieux prendre tel chemin ou tel autre afin de traverser le village.
Dans l’un de ces hameaux se trouvait un petit poste de police. On m’y invita à prendre le thé. J’avais l’impression d’être dans un poste avancé du Far West tant on semblait être à l’écart de la civilisation. De plus, le style des policiers était à mi-chemin entre celui de l’aventurier et celui du shérif. Ils portaient de longues moustaches, des vêtements de brousse et un pistolet à la ceinture. L’un d’eux m’accompagna pendant plus d’une heure pour assurer ma sécurité. D’évidence, il n’y avait aucun danger, mais cela lui semblait être son devoir de protéger l’étranger qui passait. Quand, à mon approche, les villageois, intrigués, se dirigeaient vers moi, mon garde du corps leur disait de s’écarter pour me laisser passer. Il criait sur la foule qui selon lui dérangeait mon voyage. J’étais à la fois désolé et amusé. Puis nous nous arrêtâmes pour regarder des musiciens jouer jusqu’à la frénésie du tabla, du kangeera, du sarode, de l’harmonium et de la flûte bansuri. Assis par terre, ils remuaient de droite à gauche, pris par l’exaltation des rythmes. J’étais happé par le spectacle. Enfin, après avoir traversé plusieurs villages, le policier m’indiqua la direction à suivre pour retrouver la route.
Dans ces moments-là, mes plus grandes joies m’étaient données par les enfants. Ils venaient m’entourer lorsque je m’asseyais quelque part. Leurs expressions étaient incroyables : il y avait chez eux un surprenant mélange de curiosité, d’incompréhension, de joie et d’attente. Un jour, je compris qu’il y avait aussi de la défiance. En effet, alors que je leur offrais des gâteaux, le père de l’un d’entre eux, sachant que son fils n’osait pas les accepter, le poussa dans ma direction mais l’enfant se mit crier. Alors il prit son fils dans ses bras pour l’approcher de moi, quoique je fisse manifestement peur à son enfant. C’était pourtant celui qui semblait le plus captivé par ma présence et me posait le plus de questions en hindi. Finalement, quand je repris la route, c’est aussi celui qui, paradoxalement, m’accompagna tout joyeux pendant un kilomètre. »
(p. 154-158)
Des millions d’âmes en prière (p. 260-265)
Kedarnath, Badrinath et Gaumukh (p. 381-387)
Extrait court


