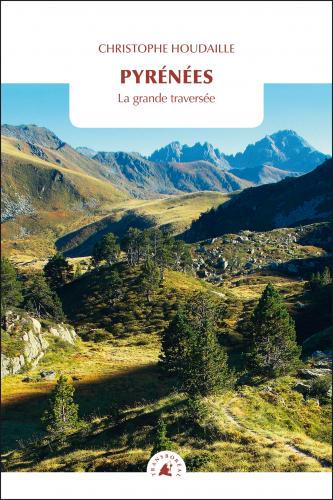
À travers le Biros ~ résurgence du passé :
« La portion de GR10 que je vais traverser dans les dix jours à venir est réputée comme étant la plus sauvage, la plus difficile. Aussi est-elle souvent évitée. Les possibilités de ravitaillement sont espacées. Cependant il est dommage que cette région ne soit pas plus parcourue car elle offre justement le dépaysement que l’on est venu chercher. Entre la vallée de la Garonne, prolongée par le val d’Aran, et celle de l’Ariège, qui donne accès au col de Puymorens, il n’y a pas de liaison avec l’Espagne. Sur l’ensemble de la frontière, il s’agit du plus long tronçon dépourvu de col ou de tunnel routier. Pourtant, l’histoire montre qu’il y a eu depuis fort longtemps des échanges de population, hommes, femmes et enfants, franchissant les cols qui, en Ariège, dépassent les 2 000 mètres.
De nos jours, l’activité se fait rare. Les mines ont été fermées, les papeteries ont disparu, les industries ont quitté les lieux. Même le tourisme se fait discret. Mais les montagnes sont bien là. Les forêts colonisent les pentes raides. Les vallées souvent étroites abritent des hameaux dépeuplés. En ce début d’octobre, il y a peu de monde en montagne. C’est aussi bien ainsi.
Je l’ai entendue, cette réflexion : “Quoi, se retrouver seul en montagne, sans parler à quiconque durant plus d’une journée, non merci !”
Il ne faut pas craindre que vivre quelques jours d’isolement vous fasse devenir un ours, un intrus, voire un exclu. Au contraire, lorsqu’on rencontre peu de monde, on se sent attiré par l’échange avec autrui. On est content de converser, en quête d’une information dont on n’a pas vraiment besoin. On salue les gens avec enthousiasme, randonneurs ou riverains, et ils vous le rendent bien.
Après une ou deux journées de solitude, il est facile de s’imaginer seul au monde. Seul, peut-être pas totalement, ce serait trop désolant. Mais disons que l’on se retrouve en haute montagne alors que le monde civilisé, tel qu’on le connaissait, a disparu. Il va falloir se débrouiller avec ce que l’on possède, et ce que l’on pourra récupérer. Et de faire mentalement la liste des objets les plus utiles, ceux qui aident à se procurer l’essentiel, ceux qui permettront de créer d’autres articles nécessaires à la survie et au bien-être. En fait, on a besoin de tout ce qu’il y a dans le sac à dos. Pardon, jetons le rasoir, ou gardons sa lame pour des petits travaux de précision. Une fois seul au monde, il devient vain de nomadiser pour son plaisir. C’est la première constatation. C’est une idée un peu triste, qui laisse penser que la randonnée est inutile, qu’elle est un bien superflu, création de notre société. Dans le but de trouver plus facilement de quoi se nourrir, gibier, poisson, fruits sauvages, il faut se sédentariser temporairement, s’installer dans le piémont. En prévision de cette situation, par jeu bien sûr, le regard cherche le surplomb rocheux qui permettra de construire un abri. Le cerveau envisage différents types de toiture, et l’on s’aperçoit qu’on est assez dépourvu de pratique pour fabriquer un refuge efficace. Lorsque je pense à cette situation improbable, je me vois plus sédentaire que nomade. Une migration annuelle conviendrait : se déplacer au fur et à mesure des besoins, à la recherche de ressources nouvelles. Peut-être aussi pour le plaisir de parcourir de nouveaux lieux, avec l’espoir de découvrir un site particulièrement propice à l’installation. Ces petites réflexions placent le voyage dans la durée. Un isard n’est plus regardé comme un bel animal sauvage, mais comme une future proie à traquer. Les sources deviennent fontaine de vie ; mais celle-ci coule-t-elle toute l’année ? Et puis, il y a tellement de choses que l’on ne connaît pas : les plantes comestibles, celles à cultiver efficacement sans acheter les graines en jardinerie, les récoltes à consommer immédiatement et celles à conserver de longs mois. Comment trouver l’argile pour façonner des récipients, comment fabriquer des paniers, et le plus difficile, comment réinventer la métallurgie ? Bon, d’accord, il suffira, pour commencer, d’aller récupérer les fils de cuivre des réseaux électriques, la ferraille qui traînera un peu partout, ce sera plus facile ! Pour commencer?
Ces pensées sont-elles un appel venant de notre nature profonde ? De fait, lorsque je trouve porte close à une cabane, réservée au berger pour cause de détérioration trop fréquente par des randonneurs mal intentionnés, je me réjouis presque à l’idée de me passer des commodités que je ne peux pas transporter sur mon dos. Pourtant, je l’avais espéré cet abri qui m’aurait évité de monter la tente sur l’herbe humide, qui m’aurait peut-être permis de m’asseoir à une table. Mais puisqu’il n’est pas disponible, je sais trouver sur l’herbe un agrément suffisant. L’intérieur de la tente devient mon univers, mon cocon pour la nuit. Ce n’est pas une tente magique, pourtant son volume offre assez de place pour lire, manger, écrire, dormir, rêver. Elle donne la satisfaction de se suffire à soi-même pour un temps. J’en viens presque à vouloir me couper du monde, me lancer dans une grande vie de nomadisme.
En dehors de la période estivale et des week-ends, et loin des sites touristiques, le GR10 n’est pas très fréquenté. Chaque contact avec les autres “GR’distes” se montre enrichissant. On distingue facilement le randonneur au long cours du randonneur à la journée.
À la frontière entre la Haute-Garonne et l’Ariège, par un temps couvert et humide, je croise un jeune couple qui fait la traversée dans l’autre sens, en compagnie d’un chien. Celui-ci a son propre harnais qui contient une partie de sa nourriture. Tandis que nous devisons, il s’endort aussitôt sur le chemin. Mes interlocuteurs me mettent en garde contre la distance entre les ravitaillements en Ariège. Ils ont un peu souffert de la faim, d’autant qu’avec leur compagnon ils ne peuvent pas aller en gîte ! Le chien a l’air heureux, et à l’appel “On va se promener”, il bondit sur ses pattes pour reprendre la route.
Tous ces randonneurs au long cours, différents du promeneur, ont un point commun. Ils sont souriants, détendus, calmes, prêts à surmonter les difficultés sans rechigner. Passionnés, aucun ne se plaint, de quoi que ce soit. Si l’on parle de fatigue et de difficulté à s’approvisionner dans certains secteurs, il s’agit plus d’un constat que d’un regret, mais surtout d’un échange d’informations : il faut faire avec ce que le parcours offre et accepter les impondérables. L’échange se veut positif, enrichissant : on néglige ses petits malheurs parce qu’au fond de soi, on est réellement très heureux. Il n’y a aucun esprit de compétition. Si l’on va lentement, peut-être est-ce parce que l’on prend le temps de visiter davantage. On parle des sources chaudes de Mérens-les-Vals où se prélasser, de gîtes où la nourriture est si bonne, des cabanes disponibles et de celles qui sont fermées, mais on aborde peu la question de l’équipement car on porte tous à peu près la même chose, et le reste est affaire de choix personnel. C’est parfois avec tristesse que l’on voit s’éloigner ces marcheurs, disparaissant derrière la crête, tandis que, secrètement, on leur souhaite une bonne traversée. »
Depuis la côte basque ~ la randonnée itinérante (p. 28-34)
Crète de la Bède ~ la beauté du voyage (p. 162-166)
Extrait court
« La portion de GR10 que je vais traverser dans les dix jours à venir est réputée comme étant la plus sauvage, la plus difficile. Aussi est-elle souvent évitée. Les possibilités de ravitaillement sont espacées. Cependant il est dommage que cette région ne soit pas plus parcourue car elle offre justement le dépaysement que l’on est venu chercher. Entre la vallée de la Garonne, prolongée par le val d’Aran, et celle de l’Ariège, qui donne accès au col de Puymorens, il n’y a pas de liaison avec l’Espagne. Sur l’ensemble de la frontière, il s’agit du plus long tronçon dépourvu de col ou de tunnel routier. Pourtant, l’histoire montre qu’il y a eu depuis fort longtemps des échanges de population, hommes, femmes et enfants, franchissant les cols qui, en Ariège, dépassent les 2 000 mètres.
De nos jours, l’activité se fait rare. Les mines ont été fermées, les papeteries ont disparu, les industries ont quitté les lieux. Même le tourisme se fait discret. Mais les montagnes sont bien là. Les forêts colonisent les pentes raides. Les vallées souvent étroites abritent des hameaux dépeuplés. En ce début d’octobre, il y a peu de monde en montagne. C’est aussi bien ainsi.
Je l’ai entendue, cette réflexion : “Quoi, se retrouver seul en montagne, sans parler à quiconque durant plus d’une journée, non merci !”
Il ne faut pas craindre que vivre quelques jours d’isolement vous fasse devenir un ours, un intrus, voire un exclu. Au contraire, lorsqu’on rencontre peu de monde, on se sent attiré par l’échange avec autrui. On est content de converser, en quête d’une information dont on n’a pas vraiment besoin. On salue les gens avec enthousiasme, randonneurs ou riverains, et ils vous le rendent bien.
Après une ou deux journées de solitude, il est facile de s’imaginer seul au monde. Seul, peut-être pas totalement, ce serait trop désolant. Mais disons que l’on se retrouve en haute montagne alors que le monde civilisé, tel qu’on le connaissait, a disparu. Il va falloir se débrouiller avec ce que l’on possède, et ce que l’on pourra récupérer. Et de faire mentalement la liste des objets les plus utiles, ceux qui aident à se procurer l’essentiel, ceux qui permettront de créer d’autres articles nécessaires à la survie et au bien-être. En fait, on a besoin de tout ce qu’il y a dans le sac à dos. Pardon, jetons le rasoir, ou gardons sa lame pour des petits travaux de précision. Une fois seul au monde, il devient vain de nomadiser pour son plaisir. C’est la première constatation. C’est une idée un peu triste, qui laisse penser que la randonnée est inutile, qu’elle est un bien superflu, création de notre société. Dans le but de trouver plus facilement de quoi se nourrir, gibier, poisson, fruits sauvages, il faut se sédentariser temporairement, s’installer dans le piémont. En prévision de cette situation, par jeu bien sûr, le regard cherche le surplomb rocheux qui permettra de construire un abri. Le cerveau envisage différents types de toiture, et l’on s’aperçoit qu’on est assez dépourvu de pratique pour fabriquer un refuge efficace. Lorsque je pense à cette situation improbable, je me vois plus sédentaire que nomade. Une migration annuelle conviendrait : se déplacer au fur et à mesure des besoins, à la recherche de ressources nouvelles. Peut-être aussi pour le plaisir de parcourir de nouveaux lieux, avec l’espoir de découvrir un site particulièrement propice à l’installation. Ces petites réflexions placent le voyage dans la durée. Un isard n’est plus regardé comme un bel animal sauvage, mais comme une future proie à traquer. Les sources deviennent fontaine de vie ; mais celle-ci coule-t-elle toute l’année ? Et puis, il y a tellement de choses que l’on ne connaît pas : les plantes comestibles, celles à cultiver efficacement sans acheter les graines en jardinerie, les récoltes à consommer immédiatement et celles à conserver de longs mois. Comment trouver l’argile pour façonner des récipients, comment fabriquer des paniers, et le plus difficile, comment réinventer la métallurgie ? Bon, d’accord, il suffira, pour commencer, d’aller récupérer les fils de cuivre des réseaux électriques, la ferraille qui traînera un peu partout, ce sera plus facile ! Pour commencer?
Ces pensées sont-elles un appel venant de notre nature profonde ? De fait, lorsque je trouve porte close à une cabane, réservée au berger pour cause de détérioration trop fréquente par des randonneurs mal intentionnés, je me réjouis presque à l’idée de me passer des commodités que je ne peux pas transporter sur mon dos. Pourtant, je l’avais espéré cet abri qui m’aurait évité de monter la tente sur l’herbe humide, qui m’aurait peut-être permis de m’asseoir à une table. Mais puisqu’il n’est pas disponible, je sais trouver sur l’herbe un agrément suffisant. L’intérieur de la tente devient mon univers, mon cocon pour la nuit. Ce n’est pas une tente magique, pourtant son volume offre assez de place pour lire, manger, écrire, dormir, rêver. Elle donne la satisfaction de se suffire à soi-même pour un temps. J’en viens presque à vouloir me couper du monde, me lancer dans une grande vie de nomadisme.
En dehors de la période estivale et des week-ends, et loin des sites touristiques, le GR10 n’est pas très fréquenté. Chaque contact avec les autres “GR’distes” se montre enrichissant. On distingue facilement le randonneur au long cours du randonneur à la journée.
À la frontière entre la Haute-Garonne et l’Ariège, par un temps couvert et humide, je croise un jeune couple qui fait la traversée dans l’autre sens, en compagnie d’un chien. Celui-ci a son propre harnais qui contient une partie de sa nourriture. Tandis que nous devisons, il s’endort aussitôt sur le chemin. Mes interlocuteurs me mettent en garde contre la distance entre les ravitaillements en Ariège. Ils ont un peu souffert de la faim, d’autant qu’avec leur compagnon ils ne peuvent pas aller en gîte ! Le chien a l’air heureux, et à l’appel “On va se promener”, il bondit sur ses pattes pour reprendre la route.
Tous ces randonneurs au long cours, différents du promeneur, ont un point commun. Ils sont souriants, détendus, calmes, prêts à surmonter les difficultés sans rechigner. Passionnés, aucun ne se plaint, de quoi que ce soit. Si l’on parle de fatigue et de difficulté à s’approvisionner dans certains secteurs, il s’agit plus d’un constat que d’un regret, mais surtout d’un échange d’informations : il faut faire avec ce que le parcours offre et accepter les impondérables. L’échange se veut positif, enrichissant : on néglige ses petits malheurs parce qu’au fond de soi, on est réellement très heureux. Il n’y a aucun esprit de compétition. Si l’on va lentement, peut-être est-ce parce que l’on prend le temps de visiter davantage. On parle des sources chaudes de Mérens-les-Vals où se prélasser, de gîtes où la nourriture est si bonne, des cabanes disponibles et de celles qui sont fermées, mais on aborde peu la question de l’équipement car on porte tous à peu près la même chose, et le reste est affaire de choix personnel. C’est parfois avec tristesse que l’on voit s’éloigner ces marcheurs, disparaissant derrière la crête, tandis que, secrètement, on leur souhaite une bonne traversée. »
(p. 117-121)
Depuis la côte basque ~ la randonnée itinérante (p. 28-34)
Crète de la Bède ~ la beauté du voyage (p. 162-166)
Extrait court


