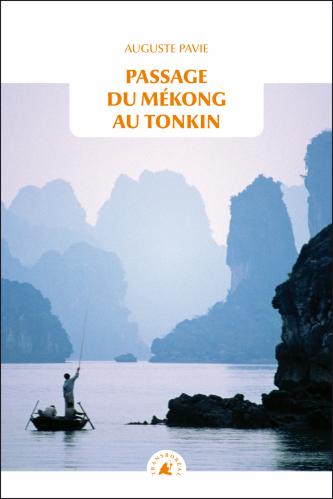
Passage du Mékong au Tonkin
Auguste Pavie
Parti de Bangkok, où il était vice-consul de France, Auguste Pavie a pour mission de rejoindre Luang Prabang, la cité royale du Laos, et d’y implanter une délégation diplomatique. Arrivé à destination au début de l’année 1887, il entreprend de découvrir seul, sans escorte, une voie de communication entre le Mékong et le Tonkin, et effectue ainsi la première reconnaissance des territoires situés aux confins du « pays du Million d’éléphants ». Ce voyage long de deux années, semé d’embûches et de contretemps liés aux manœuvres du Siam pour entraver l’extension de l’influence française en Asie du Sud-Est, révèle l’un des personnages les plus attachants de l’exploration qui n’a de cesse, en route, de dépeindre la beauté des paysages et de témoigner des coutumes et de la vie des populations d’Indochine.
Avec une introduction par : Henri Eckert
« “Je connus la joie d’être aimé des peuples chez qui je passais.”
Cette phrase clôt le septième et dernier volume des œuvres de la mission Pavie, paru en 1919. Elle termine aussi le condensé qu’Auguste Pavie rédigea quelques années plus tard à partir de ses carnets de route sous le titre À la conquête des cœurs. C’est dire que l’explorateur tenait surtout à ce que l’on retînt la dimension humaine de son épopée. Aujourd’hui où son œuvre politique, le rattachement du Laos à l’Indochine française, appartient à un passé révolu, la personnalité de Pavie a conservé un charme intact. Les pages que l’on va lire, si elles sont le récit d’aventures et de découvertes effectuées entre 1887 et 1888, offrent aussi l’occasion d’approcher peu à peu cet homme attachant.
Non que Pavie se mette jamais en avant. À plusieurs reprises dans ses écrits, il évoque sa timidité, qui composerait selon lui le fond de son caractère. Il est en tout cas réservé, dans sa vie comme dans ses ouvrages. Ce n’est pas en le lisant qu’on apprendra de lui qu’il est né à Dinan le 31 mai 1847, qu’il s’est engagé à 17 ans dans l’armée et porté volontaire pour l’expédition du Mexique, qu’il a renoncé aux chevrons de sergent pour intégrer l’infanterie de marine et partir en Cochinchine en 1868, qu’il rentre volontairement en France pour se battre au cours de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, avant de retourner en Cochinchine où il a trouvé un emploi dans les télégraphes. Ces quelques faits, dont d’aucuns pourraient tirer gloire, Pavie les délaisse. Quand le roi de Luang Prabang lui demande une photo le représentant en uniforme, il lui en donne une qui le montre encore simple soldat. Mais ces quelques éléments de biographie tracent le portrait d’un homme entreprenant et déterminé, ce qui tempère quelque peu sa timidité. Pavie n’est pas un ambitieux qui écrase pour s’élever. C’est un passionné qui cherche à se dévouer. Lui-même a raconté comment un bonze cambodgien sut forcer avec douceur la barrière qui l’isolait, et lui permettre de trouver sa vocation. On lira ce récit dans la première partie de ce volume, publié initialement par Pavie sous le titre “Comment je devins explorateur”, et repris en 1921 comme introduction à son dernier ouvrage, À la conquête des cœurs.
La figure d’Auguste Pavie n’est peut-être pas entièrement inconnue du grand public. Son nom revient de temps à autre dans la presse, à propos de tel ou tel événement consacré aux voyages, aux découvertes, à l’Indochine. Le raccourci facile qui sert alors à le décrire est celui de l’employé de poste devenu explorateur et ministre. Certes, rien n’est faux si l’on s’attache à l’expression littérale. En octobre 1869, Pavie est recruté comme agent auxiliaire stagiaire des télégraphes de Cochinchine, et en 1891 il est nommé ministre résident à Bangkok. Mais la formule joue plutôt sur une connotation particulière : employé de poste, cela évoque un paisible fonctionnaire attendant sagement derrière un guichet l’heure de l’apéritif. Il est vrai que l’absinthe, le pastis ou le cognac-soda eurent leur part de gloire dans l’histoire de la fonction publique aux colonies. Pourtant, rien ne décrit plus mal le rôle de Pavie que de l’imaginer guichetier ou facteur.
À son arrivée en Cochinchine en 1869, Saigon n’est française que depuis dix ans. La future “perle de l’Orient”, élevée sur les décombres d’un village et d’un fort indigènes, doit son existence à la volonté des amiraux qui gouvernent la colonie jusqu’en 1879. Comme tout le reste, le télégraphe est à créer. Pavie est chargé de reconnaître les tracés, c’est-à-dire d’arpenter des régions reculées pour en faire le relevé topographique permettant de déterminer l’itinéraire le plus approprié et le moins coûteux. Il faut ensuite diriger la pose de la ligne, et pour cela recruter la main-d’œuvre, défricher, tailler et planter les poteaux sur des dizaines de kilomètres, loin du confort relatif de la ville. Ce travail l’amène aussi dans les pays voisins, le Cambodge qui a signé un traité avec la France en 1863, et le Siam qui fait jouer la concurrence commerciale entre les puissances coloniales, France et Angleterre, dont les possessions l’entourent.
Ainsi, être employé de poste en Cochinchine dans les années 1870, c’est déjà être explorateur et voyageur. C’est mener aussi une vie particulièrement risquée. En brousse, les fauves représentent encore une menace bien réelle, moins féroce pourtant que la maladie. Ces dangers non plus, Pavie ne les met pas en avant pour en tirer gloire. Quand il évoque sa nomination comme agent du télégraphe à Kampot au Cambodge, c’est presque négligemment qu’il signale que ses deux prédécesseurs y ont trouvé la mort. Dans son journal de route, les allusions à sa propre santé sont un peu plus fréquentes : il s’agit parfois de justifier une interruption de la correspondance causée par la maladie. Pourtant, on risquerait de glisser sur ces quelques mentions, et d’oublier que jour après jour, l’explorateur est guetté par deux ennemis mortels, la fièvre et la dysenterie. Doublement atteint, Pavie demande presque des excuses : en luttant contre une sévère dysenterie, il a quelque peu négligé la quinine préventive, et le voilà frappé de fièvre. Il frôle la mort, mais ce ne sont pas ses plaintes qui nous l’apprennent, c’est la tristesse avec laquelle il lit de l’inquiétude dans le regard de ceux qui l’entourent? À l’armée, sa faible constitution avait été remarquée. Comme télégraphiste, il dut retourner en France pour une convalescence en 1873.
Pourtant, si l’on considère l’ensemble de sa carrière, Pavie jouit d’une exceptionnelle condition physique. Alors que le séjour colonial des militaires ne dépasse pas trois ans, et suffit cependant à ruiner bien des organismes, alors que le physiologiste Paul Bert, bien qu’entouré des égards dus au résident général de l’Annam et du Tonkin, est emporté en moins d’un an, Pavie arpente villes, fleuves et forêts d’Indochine pendant un quart de siècle, de 1868 à 1895, à peine entrecoupé de quelques brefs séjours en France. Sa survie tiendrait du miracle si elle ne s’appuyait sur les solides précautions évoquées plus haut, et sur un mode de vie mieux adapté au climat que celui de la plupart des coloniaux. En effet, Pavie adopte, en tout ou presque, les usages locaux. C’est parfois par nécessité, quand il ne peut se ravitailler en produits européens, mais c’est toujours avec la conviction que les mœurs indigènes sont mieux adaptées aux contraintes que les modes importées d’Europe. Réduit à marcher pieds nus, Pavie critique le port des chaussures, qui entretiennent l’humidité sous la pluie et racornissent au soleil. Il en vient même à refuser les paires qu’on lui propose. Son vêtement aussi s’est allégé et simplifié. De même, il a modifié son régime alimentaire, et compte parmi les rares Français de l’époque à remplacer le pain par le riz ou à se dispenser de vin. Il est donc sûrement mieux armé pour la survie sous les tropiques que les soldats vêtus de laine, nourris de bœuf en sauce, abreuvés de gros rouge et de tafia.
Un autre facteur peut aussi expliquer l’étonnante santé de Pavie. Les chefs coloniaux les plus capables ont remarqué que le taux d’attrition de leur troupe diminuait quand on la faisait vivre au grand air et en pleine activité, plutôt que de la laisser végéter dans la sieste et l’inaction sous prétexte de la protéger des atteintes du climat. À cet égard, l’exemple de Pavie pourrait confirmer cet enseignement, car son activité est prodigieuse. Lui-même remarque que la fièvre lui laisse habituellement un peu de répit au moment d’un coup de collier. Son emploi du temps quotidien ressemblerait, pour beaucoup de nos contemporains sans doute, à un coup de collier permanent. Un lecteur distrait le remarquerait à peine, car l’auteur ne s’étend guère sur son sort personnel. Cependant, son sens du détail le pousse à noter de temps à autre quelques indications qui permettent assez bien de reconstituer sa vie en brousse.
La journée de marche commence vers 6 heures du matin. Il faut parfois cuire avant le départ le repas que l’on avalera sur le pouce à midi. L’allure de la progression n’est pas très élevée. Dans ses notes, Pavie l’estime à 3,5 kilomètres à l’heure, pour huit heures de marche par jour. On ne musarde pas en chemin. Pavie est topographe : comme il l’a appris à l’armée et pratiqué aux télégraphes, il relève son itinéraire. Cela signifie compter ou faire compter les pas pour mesurer les distances ; déterminer à la boussole le moindre changement de direction ; sonder la profondeur des rivières, estimer leur largeur, leur débit, ou encore l’altitude du relief environnant ; en reporter les formes sur la planchette. Il faut de plus se renseigner sur le nom de chaque cours d’eau, de chaque village, sur l’existence et la direction des pistes du voisinage? Comme si ce n’était pas suffisant, Pavie est aussi naturaliste. Il mentionne parfois les beaux spécimens de plantes, de roches ou d’animaux qu’il a récoltés, le temps passé pour classer ses collections avant de les expédier. C’est du reste par ce moyen qu’il s’était fait connaître du premier gouverneur civil de la Cochinchine, Le Myre de Vilers, arrivé en 1879 à Saigon, et qui devait lui confier ses premières missions, parallèlement à son travail de télégraphiste, de 1880 à 1885.
À la pratique des sciences de la nature, Pavie ajoute celle des sciences humaines, et notamment l’ethnographie. Il se montre curieux des différents peuples, recueille leurs légendes, observe leurs coutumes. Il a appris le cambodgien et le vietnamien, et se débrouille en laotien. À chaque occasion, il interroge un piroguier, son cornac, les femmes au marché? Même les jeux des enfants retiennent son attention. Pour compléter ses observations, Pavie recueille et traduit tous les textes anciens dont il apprend l’existence, et, autant qu’il le peut, il emporte avec lui son encombrant appareil photographique. Plus embarrassantes encore sont les plaques photosensibles (le film n’est pas encore inventé), qu’il convient de protéger de la lumière, de l’humidité et du soleil. Prendre une photo nécessite tout un déballage, car le matériel délicat est protégé au fond d’une caisse métallique réputée étanche, ainsi que de longs délais de préparation et de mise en œuvre. En pirogue, Pavie doit profiter des arrêts et des ruptures de charge qu’entraîne le franchissement des rapides pour photographier. Lors des étapes terrestres, il faut se contenter des haltes, ou de l’étape, si la lumière est suffisante.
Ce n’est pas encore le temps de l’appareil que l’on porte en bandoulière, et c’est pourquoi les photos de Pavie n’ont pas toujours le caractère spontané et vivant de son récit. Cependant, il est permis de croire que ce style un peu sec répond au moins autant à la volonté du photographe qu’aux limitations techniques de son art. Pavie possède une vive conscience de témoigner pour la postérité. Figer les lieux par l’image, c’est plus qu’illustrer un récit de voyage, c’est leur donner un peu de ce hiératisme qui les rend intemporels. Même les scènes plus spontanées ont valeur d’enseignement de portée générale, comme le souligne Pavie en commentant une photo montrant des Laotiens fascinés par ses jumelles. Quant aux personnages, Pavie les fait poser, et leur laisse le choix de la tenue et du décor. C’est en tout cas ce qu’il nous dit à propos des deux commissaires siamois de Luang Prabang, en précisant que la simplicité de l’un qui choisit de se faire accompagner de sa petite-fille, et la vanité de l’autre qui voulut son plus bel équipage, correspondent en fait aux deux tendances que se partage l’administration du Siam dans son ensemble. Comme la plupart des coloniaux, Pavie photographie donc des individus en pensant révéler des archétypes. Ses prises de vue ont aussi une utilité plus immédiate. Il emporte en effet dans son bagage lourd, celui qu’il est souvent obligé de laisser en chemin sous la garde d’un Cambodgien, faute de moyen de transport, tous les produits chimiques et papiers spéciaux nécessaires au tirage de ses clichés. Il peut ainsi offrir leur portrait aux principaux personnages qu’il fréquente. La photographie sert alors la diplomatie.
À suivre Pavie dans ses promenades de botaniste, de géographe ou de photographe, il ne faudrait pas oublier que le but essentiel de ses voyages est politique et diplomatique. C’est le caractère officiel de sa mission qui nous vaut son texte. En effet, chaque soir, et ce n’est pas la moins harassante de ses activités, Pavie s’astreint à faire le compte rendu de sa journée. Plus elle a été chargée et plus il est copieux. Pavie conserve ses notes personnelles, ses carnets de route qui contiennent tous les détails. Ce document lui sert ensuite à rédiger les dépêches diplomatiques. Il faut parfois en prendre copie, et il n’est pas douteux que Pavie passe ainsi des heures la plume à la main. Le ministère aurait même souhaité que la correspondance fût envoyée en deux exemplaires, l’un vers Bangkok et la France, l’autre vers Hanoi et la résidence générale. Non possumus, répond Pavie. Et d’expliquer que, matériellement, il n’a pas le temps de copier lui-même et ne dispose pas de secrétaire, contrairement à ceux qui lui écrivent?
Tous les quinze jours environ, la lettre adressée au ministre des Affaires étrangères est confiée à un courrier qui la porte à Bangkok, où le chargé d’affaires français en prend connaissance et la transmet. Les archives du ministère à Paris détiennent les registres dans lesquels ont été reliées à la suite les correspondances de Pavie, complétées parfois par des annotations du ministre ou d’un de ses fonctionnaires. On y trouve les cartes dessinées par Pavie lui-même, et parfois une photo collée par son auteur dans une de ses lettres. On pourrait se demander ce qui pousse l’explorateur à envoyer ainsi ce qui est déjà plus un véritable récit de voyage qu’un sobre compte rendu politique. L’état d’ignorance dans lequel se trouve le ministère peut en être une raison. Le désir de Pavie, isolé à 12 000 kilomètres de distance, de créer un lien privilégié avec son ministre par le ton très personnel de sa correspondance en est sans doute une autre. Du reste, il a parfaitement réussi à capter l’attention qu’il recherchait.
Réduire sa démarche à ces deux seules raisons serait pourtant négliger l’essentiel. Pavie est séduit, Pavie est amoureux, Pavie n’est jamais las de faire connaître ce qu’il voit chez ceux qu’il a choisi d’aimer. Lui-même emploie des mots très forts pour décrire ses motivations. “J’en arrivai à être obsédé du désir de visiter d’autres contrées ; de connaître et de faire connaître les pays inexplorés de l’Indochine orientale, de servir mon pays en me rendant utile à leurs populations”, écrit-il dans la préface du premier volume des œuvres de la mission. Ce que la passion a d’éphémère, l’utilité doit le pérenniser. Pavie construit donc lettre par lettre une œuvre qu’il voudrait impérissable. Exegi monumentum? Par sa correspondance, Pavie conjugue Horace au présent.
À son retour en France, l’explorateur entreprend tout naturellement de publier les résultats de sa mission. Dix volumes paraissent, qui s’échelonnent de 1898 à 1919. Malgré les quarante ans qui les séparent des événements rapportés, les derniers volumes parus ne sont pas les moins précis, car Pavie prend pour base ses carnets et toute la correspondance officielle conservée aux Archives, à laquelle il reste extrêmement fidèle. Quelques corrections de style, la suppression d’anecdotes et des questions de service ne privent pas l’ensemble de la sincérité et de la vivacité du premier jet. La lecture des originaux, plus développés, instruit le chercheur et l’érudit ; elle apporterait sans doute peu au lecteur profane. C’est pourquoi la présente édition se tient au choix fait par Pavie lui-même, en reprenant le texte du sixième volume de la mission, publié en 1911. Ce volume, comme son numéro d’ordre dans la collection ne le laisse pas deviner, est en fait consacré à la première période de l’activité diplomatique de Pavie, de 1887 à 1888.
Quelle est donc cette mission politique dont Pavie est chargé, et dont il décrit la réalisation dans ce livre ? Il en a donné lui-même un bref aperçu, qu’il faut chercher dans les toutes dernières pages de son ouvrage, sous forme d’appendice. Il semble plus judicieux de le reproduire ici, afin d’aider à la compréhension du contexte dans lequel se déroule son voyage.
Voici donc ce qu’en dit Pavie :
“Nommé vice-consul de deuxième classe au Siam le 11 novembre 1885, j’arrivai à Bangkok le 19 mars 1886. C’était le moment de nos difficultés avec la Chine au Tonkin, il était nécessaire d’être renseigné sur les régions voisines de nos premiers postes où les Pavillons noirs étaient établis, où le Siam envoyait des soldats, installait des agents. Il était indispensable également de rechercher les voies de communication unissant à l’Annam et au Tonkin les régions dont nous revendiquions la possession.
J’avais pour mission de gagner Luang Prabang, qui serait mon poste d’attache et d’où je rayonnerais vers nos confins. Le Siam, qui venait d’occuper militairement cette région, ne consentit pas à reconnaître ma qualité. Cependant, après six mois de retard, je pus le 30 septembre me mettre en route en simple voyageur. Dans l’intervalle, la cour de Bangkok avait proposé à l’acceptation du gouvernement de la République une convention qui était la reconnaissance de l’autorité siamoise sur les pays que j’avais pour but de visiter. Elle considérait évidemment en me laissant partir à ce moment que la ratification de cet acte serait accomplie avant mon arrivée sur le terrain que j’avais mission de parcourir. Cependant mes premiers avis et l’annonce des dramatiques événements de Luang Prabang parvinrent en temps utile.”
Essayons de débrouiller quelque peu l’écheveau des relations entre la France, la Chine, le Siam et l’Annam (pour donner à l’actuel Vietnam le nom, contestable, sous lequel les Français le désignent alors) en élargissant la perspective. Au XIXe siècle, la péninsule Indochinoise voit s’affirmer les ambitions de deux puissances conquérantes, le Siam et le Dai Nam, appelé Annam par les Français. Entre les deux, sur les rives du Mékong, se trouvent le vieux royaume du Cambodge et les terres peu peuplées de l’actuel Laos. Le Vietnam, dont le berceau est la région de Hanoi, a commencé depuis plusieurs siècles une conquête du sud de la Péninsule. Il a détruit le royaume indianisé du Champa, dont les vestiges enrichissent les collections du musée cham de Danang. Pavie évoque les quelques populations de cette origine qu’il a fréquentées, et que l’on rencontre encore de nos jours de part et d’autre de la frontière khméro-vietnamienne.
Poursuivant leur avance vers le sud, les Vietnamiens atteignent les bouches du Mékong et l’extrémité de la Péninsule au XVIIIe siècle, région que les Français, à la suite des missionnaires, appelleront Cochinchine. Ils commencent alors à grignoter le Cambodge. Ce royaume a depuis longtemps perdu la splendeur qui fut celle d’Angkor, sous la pression de ses voisins du nord et de l’ouest, les Thaïs. C’est pourquoi, en 1863, le souverain cambodgien s’accommode facilement d’un traité de protectorat avec une puissance coloniale débarquée en Cochinchine quatre ans plus tôt, la France. Il y voit une chance de survie pour son royaume déclinant, déchiré entre les appétits de ses deux puissants voisins. Commence alors pour le Cambodge ce que l’historien Alain Forest a appelé “une colonisation sans heurt”. Mais les Français, au milieu du XIXe siècle, sont encore très ignorants des choses de la Péninsule, et particulièrement de son histoire et de sa géographie. C’est un terrain de choix pour les explorateurs, et Pavie, qui couronne leurs efforts, évoque volontiers les plus célèbres d’entre eux, en recueillant pieusement le souvenir de leur passage au sein des populations rencontrées.
Henri Mouhot est certainement celui qui tient la première place dans les pensées de Pavie. Trente ans avant lui, ce Montbéliardais, né en 1826, a parcouru les mêmes pays, Siam, Cambodge, Laos, à titre privé et sans soutien officiel. L’histoire le tient pour le “découvreur” d’Angkor, qu’il fit connaître en Occident par la publication des récits de ses voyages, effectués de 1858 à 1861, dans la célèbre revue Le Tour du monde. Si Pavie, et avec lui tout le Second Empire, a rêvé dans sa jeunesse sur ces aventures, l’explorateur a d’autant mieux conservé le souvenir de son devancier qu’il est appelé à marcher sur ses traces et, comme on le lira, à redonner un peu de lustre à la tombe de Mouhot, mort tout près de Luang Prabang à l’âge de 35 ans, en novembre 1861.
Mouhot n’est pas le seul Français connu à précéder Pavie sur le cours du Mékong. Le plus célèbre d’entre eux est Francis Garnier, et son action nous ramène au contexte historique. Si la France, qui avait déjà fait quelques démonstrations navales limitées, prend pied définitivement en Cochinchine par la prise de Saigon en février 1859, elle poursuit en fait des ambitions plus vastes et plus lointaines. Le véritable mirage est le marché chinois. Toutes les puissances européennes rêvent de le conquérir. Mais la Chine est un État trop grand pour que l’on songe à en faire la conquête, et un enjeu trop important pour que les puissances européennes puissent permettre à une seule d’entre elles de s’en emparer. En revanche, ce marché peut se fractionner, chaque pays obtenant une aire d’influence, ou le monopole d’un produit particulier comme l’opium. L’Indochine est alors une voie d’accès possible pour les Européens, et un moyen de drainer les produits des provinces méridionales de la Chine. La rivalité entre la France et l’Angleterre en Asie du Sud-Est n’a donc pas seulement pour objet “quelques arpents de jungle_1”, elle est perçue comme une compétition pour le marché chinois.
De cela, Francis Garnier, un jeune officier de marine, est bien convaincu. Avec l’appui des milieux économiques intéressés, il persuade le ministre de la Marine, Chasseloup-Laubat, de lancer une expédition de reconnaissance du Mékong pour s’assurer qu’il constitue bien une voie possible de pénétration en Chine. Le commandement de la mission, qui quitte Saigon le 5 juin 1866, a été confié à un officier plus âgé, le capitaine de frégate Doudart de Lagrée. C’est grâce à l’influence personnelle de cet officier attaché à la cour du Cambodge que le roi Norodom avait accepté le protectorat français en 1863. Parmi les membres européens de la mission, qui part sur deux canonnières et bénéficie d’une petite escorte de miliciens autochtones, se trouve un peintre et dessinateur, l’enseigne de vaisseau Delaporte, qui va bientôt devenir le plus célèbre illustrateur d’Angkor.
Le but est d’abord de reconnaître le cours supérieur du Mékong. On arrive donc jusqu’à Luang Prabang en 1867, on trouve la case où mourut Mouhot six ans plus tôt, on élève un monument sur sa tombe. Et l’on continue à remonter le fleuve jusqu’en Chine, où Doudart de Lagrée meurt à son tour. Quant à Francis Garnier, ayant reconnu que le Mékong est très malcommodément navigable, il envisage désormais le fleuve Rouge, qui traverse le Tonkin, comme la voie navigable permettant de drainer le commerce chinois. Son projet de reconnaissance de ce fleuve se heurte à la mauvaise volonté des autorités annamites, et mène à une première et éphémère conquête du Tonkin, au cours de laquelle l’explorateur trouve la mort le 21 décembre 1873. La France évacue alors sa tête de pont au Tonkin et signe une convention. La vraie conquête ne reprend qu’en 1882, et débouche sur un protectorat imposé au royaume d’Annam. La France entend alors prendre à sa charge les intérêts extérieurs du pays qu’elle protège. C’est à ce titre qu’elle se soucie du Laos.
Qu’est-ce donc que le Laos ? On se tromperait si l’on appliquait à la réalité du XIXe siècle les idées que l’on peut avoir au XXIe siècle. Le Laos qu’ont traversé Mouhot, Garnier ou Pavie n’est pas un État unique, n’a pas de gouvernement central, pas de frontières strictement définies, pas d’unité ethnique. La population majoritaire appartient au groupe lao, un rameau de la grande famille des Thaïs. Il ne faudrait pas pour autant croire ces populations venues du sud, c’est-à-dire de la Thaïlande actuelle. Au contraire, le berceau des Thaïs est en Chine, au Yunnan, d’où ils ont progressivement envahi la péninsule Indochinoise, particulièrement après la destruction de leur royaume, le Nan Chao, en 1253, par les Mongols de Koubilaï Khan, le petit-fils de Gengis Khan. Mais il s’agit davantage d’une colonisation de peuplement, d’une longue infiltration, que d’une conquête militaire.
Le fondateur du Laos est le roi Fa Ngum, dont Pavie évoque le rôle et la conversion au bouddhisme sous l’influence cambodgienne au XIVe siècle. Le Lan Xang, ou “pays du Million d’éléphants”, déborde largement les frontières du Laos actuel. Malgré les crises de succession et les changements de capitale entre Luang Prabang et Vientiane, le royaume connaît son apogée sous le roi Souligna Vongsa, un contemporain de Louis XIV dont le règne, de 1637 à 1694, est aussi remarquablement long. Mais l’unité est brisée à sa mort : trois royaumes émergent des guerres de succession. Le royaume de Vientiane se place sous la suzeraineté vietnamienne ; le royaume du Champassak, au sud, subit l’influence grandissante du Siam ; enfin le royaume de Luang Prabang tente de préserver son indépendance. Au XIXe siècle, le Laos est donc devenu une zone tampon entre Siam et Vietnam, divisée en plusieurs principautés parfois hostiles. La prise et la destruction de Vientiane en 1828 par les Siamois l’ont en partie dépeuplé. À côté des roitelets laotiens, le Siam établit un peu partout ses fonctionnaires. C’est dans ce contexte troublé qu’intervient la France.
Nous avons dit que la France recherche en Indochine des moyens d’accéder à l’empire du Milieu, ce qui explique son intérêt pour le Mékong. Elle est aussi soucieuse de ménager le Siam, de crainte qu’il ne se tourne vers l’Angleterre, avec qui il est en contact tout au long de sa frontière birmane. Dans les années 1880, le Siam s’inquiète des ambitions françaises, et décide de profiter de la situation difficile créée par l’insurrection vietnamienne déclenchée à Hué le 5 juillet 1885, et par le maintien de bandes chinoises dans le haut Tonkin. Le Siam essaie donc d’obtenir de ces bandes une reconnaissance de son autorité, et propose à la signature de la France une convention qui, sous couvert de définir des règles de bon voisinage, reviendrait à reconnaître dans les faits sa propre domination sur l’ensemble du Laos et ses marges tonkinoises. Avant de signer, la France souhaite se renseigner plus en détail sur ces régions. Sur les instances de l’ancien gouverneur de la Cochinchine, Le Myre de Vilers, le ministre des Affaires étrangères, Freycinet, nomme dans ce but Auguste Pavie vice-consul en novembre 1885.
Pavie, qui n’est alors que commis principal des postes, mais déjà chevalier de la Légion d’honneur en récompense de ses explorations précédentes au Cambodge et au Siam, doit rejoindre son poste à Luang Prabang. Ce n’est pas la partie la plus simple de sa mission. Au moment de sa nomination, il est en France. Le voyage de la métropole en Indochine, qui dure plus d’un mois à l’époque, n’est pas la principale difficulté et s’effectue dans l’enthousiasme, car Pavie a lui-même suggéré et sollicité ce poste d’agent consulaire au Laos. Les étapes à Saigon et Phnom Penh ne le retardent guère. Pavie y recrute toutefois, avec l’aide du général Bégin, les huit Cambodgiens qui vont l’accompagner dans sa mission. Le consul a tenu à n’emmener que des Cambodgiens, dont il parle la langue et apprécie les qualités. Deux d’entre eux ont séjourné à Paris comme élèves de l’école coloniale destinée à former les élites indigènes. C’est à Bangkok que commencent les difficultés et les atermoiements. Le départ est sans cesse ajourné par suite de la mauvaise volonté des autorités siamoises. Pavie avait quitté la France le 31 janvier 1886 ; c’est le 30 janvier 1887 que s’ouvre son récit, au moment où il rejoint le Mékong qui va l’emmener en quelques jours à Luang Prabang. Il lui a donc fallu plus d’un an pour se retrouver à pied d’œuvre. Quelles vont être les grandes lignes de son action ?
Pavie est incontestablement animé d’un ardent patriotisme. Ses instructions lui commandent de faire connaître la France aux habitants, et de s’enquérir de leurs dispositions à son égard. Pour Pavie, faire connaître c’est faire aimer. À tout instant, il se montre soucieux de l’image de la France véhiculée par les autres ressortissants. Il se réjouit du bon souvenir laissé par ses prédécesseurs, Mouhot, Doudart de Lagrée, Francis Garnier. Il se félicite de la réputation de douceur que leur comportement a répandue chez les Laotiens. Il espère que les deux officiers qui doivent le rejoindre, le capitaine Cupet et le lieutenant Nicolon, se montreront à la hauteur de cette réputation. Quant à lui, il arbore en permanence le drapeau tricolore : sur sa pirogue ou son radeau, comme sur un bâtiment de la marine, mais aussi sur ses logements successifs. Une anecdote tirée de sa correspondance, mais non conservée par lui dans le texte imprimé, nous apprend qu’il a doté ses employés d’un bonnet tricolore destiné à les faire reconnaître partout où ils passent.
Pavie est donc essentiellement convaincu du bon droit de la France, qui pour lui représente l’humanité et la bienveillance face au despotisme siamois. Il cherche également à fonder en droit ces prétentions françaises. C’est le sens qu’il convient de donner à sa recherche de manuscrits anciens. Certes, son intérêt pour la culture locale est indéniable, comme le montre la publication en langue française de contes cambodgiens qu’il entreprit à son retour. Mais Pavie veut surtout trouver des preuves historiques de l’inanité des prétentions siamoises sur le Laos, et pour cela établir la suzeraineté vietnamienne, dont la France se veut l’héritière. Ce terme de suzeraineté est emprunté à une réalité occidentale et médiévale, mais volontiers appliquée par les colonisateurs à la situation orientale contemporaine qu’ils essaient de comprendre. Or l’historiographie de l’époque donne aux termes vassalité ou suzeraineté des définitions très normatives ; on serait de nos jours beaucoup plus nuancé. Les rapports entre États asiatiques le sont encore plus. Il est bien convenu, dans tout le nord de la péninsule Indochinoise, que la Chine exerce une certaine tutelle. Cependant, comme celle-ci s’exerce de loin, elle ne peut être que débonnaire. Le tribut porté à l’empereur est plus une marque honorifique de respect que le signe d’une véritable soumission politique, et il en va de même des tributs demandés par le Vietnam ou le Siam aux roitelets laotiens. Ces derniers en portent parfois simultanément aux deux puissances, ce qui montre bien que payer le tribut n’indique pas une soumission exclusive ou absolue. C’est plutôt une manière, pour un État faible, de se concilier les bonnes grâces des puissants, en flattant leur prestige. Au reste, seul ce dernier définit les devoirs d’un suzerain envers son vassal : peut-on l’abandonner sans défense, sans pour autant perdre la face ?
La reconnaissance d’une relation de dépendance entre deux États est donc plus nominale que fondée sur une définition juridique précise des obligations contractées par les deux parties. S’ajoute à cela le fait que la notion de frontière n’a pas non plus la même acception en Asie qu’en Occident. Depuis l’Empire romain, notre conception est linéaire. La frontière est un trait précis sur une carte, une séparation nette sur le terrain, parfois fortifiée, toujours précisément bornée. En Indochine au contraire, point de pré carré. Aux confins du royaume se trouvent justement ces régions à l’allégeance incertaine, ces princes auxquels on accorde l’investiture pour mieux croire qu’on a pouvoir sur eux. La diversité ethnique et la mobilité des populations ajoutent encore à l’incertitude. Au Laos, le groupe lao ne représente que 40 % de la population, la famille thaïe, à laquelle il se rattache, pas plus de 60 %. Des peuples différents occupent le fond d’une vallée et le sommet des interfluves. Les États dynamiques et conquérants, comme le Vietnam, pratiquent parfois la colonisation, au sens précis du terme : des colons viennent s’installer en nombre dans les régions frontalières, et au bout d’une génération ou deux, le royaume s’est agrandi? »
Établissement du texte par : Henri Eckert
Rédaction des notes par : Henri Eckert


