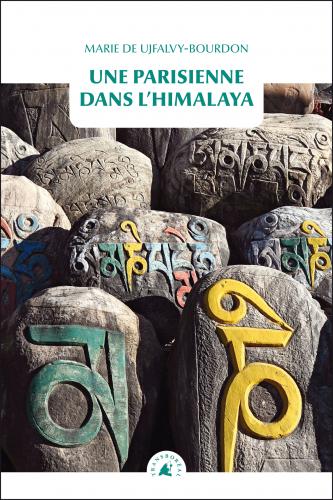
Une Parisienne dans l’Himalaya
Marie de Ujfalvy-Bourdon
À la fin du XIXe siècle, alors que le Grand Jeu régit l’Asie centrale, Marie de Ujfalvy-Bourdon sillonne pendant huit mois, avec son mari anthropologue, les vallées reculées de l’Himalaya occidental. Trois décennies avant Alexandra David-Néel, elle est la première Européenne à rencontrer les peuples du Cachemire, du Baltistan et du Ladakh. Sensibilité à la puissance des paysages, attention aux mœurs hindoues, bouddhistes ou musulmanes, prises de position sur le rôle de la femme et observations géopolitiques : ce récit écrit avec humour dans un style enlevé et incisif est un témoignage de premier plan sur les contrées himalayennes.
Avec une introduction par : Samuel Thévoz
« “Les dames ne comprenaient pas que je fusse décidée à suivre mon mari. C’était folie qu’une femme s’avisât d’une telle aventure ; courir les grands chemins ! passe encore s’ils avaient été suffisamment frayés. Assurément vous n’en reviendrez pas ! – Et de fait quand j’en revins, on s’extasia de ma réapparition, comme d’une résurrection.”
Rare témoignage sur des régions méconnues du nord de l’Inde à une période particulièrement mouvementée, compte rendu original sur une enquête scientifique insolite, le présent récit de Marie de Ujfalvy-Bourdon est également la mise en œuvre d’une vision et d’un discours singuliers sur un monde en pleine mutation. Mme de Ujfalvy se rend à trois reprises en Asie, voyages pour lesquels, de son propre aveu, elle prend délibérément la décision d’accompagner son mari, Charles-Eugène de Ujfalvy, savant d’origine hongroise né à Vienne et installé à Paris. En 1876, ils partent en Asie centrale à la demande du ministère de l’Instruction publique. Ce voyage, qui durera plus d’une année, est la première véritable mission scientifique française officielle au Turkestan. Deux ans plus tard, ils prennent à nouveau la direction de l’Asie centrale et visitent principalement le Kazakhstan. À peine revenus de la mer d’Aral en janvier 1881, les deux époux, infatigables, s’embarquent en mars pour une expédition dans les régions frontalières du nord-ouest de l’Inde. De ses aventures en Asie, Marie de Ujfalvy choisit de faire deux récits qu’elle publiera d’abord sous forme de feuilletons dans la célèbre revue Le Tour du monde. Le premier voyage est retracé dans De Paris à Samarcande, Impressions de voyage d’une Parisienne, publié en 1880, et la dernière expédition fait l’objet du Voyage d’une Parisienne dans l’Himalaya occidental jusqu’aux monts Karakoram, publié en 1887.
Malgré l’exploit que représentent pareilles pérégrinations et l’originalité, pour l’époque, de la démarche de Marie de Ujfalvy, nous possédons bien peu d’éléments sur la vie de l’auteur. À peine une notice, au dos d’une photo-portrait prise à Budapest par Klősz Gy. en 1909 et conservée à la Société de géographie de Paris, griffonnée par une main inconnue : “Madame de Ujfalvy-Bourdon née à Chartres (Eure-et-Loir) le 12 janvier 1845 appartient à une famille bretonne originaire de Lorient (Morbihan).” Suivent les titres de ses deux ouvrages et l’indication que Mme de Ujfalvy est officier d’académie depuis 1881 – sans doute à la suite de la nomination de son mari comme professeur à l’École des langues orientales.
Pourtant, l’auteur a laissé sa marque au sein de la littérature française. Il convient en effet de noter que Jules Verne, grand lecteur de récits de voyage, s’appuie sur De Paris à Samarcande pour mettre en scène le grand reportage de son héros Claudius Bombarnac (1893) en Asie centrale et en particulier à Samarcande et à Tachkent. Outre l’itinéraire qu’il lui emprunte, le romancier évoque explicitement l’“intrépide voyageuse Mme de Ujfalvy-Bourdon” à plusieurs reprises. Il souligne son intérêt prononcé pour l’art décoratif des monuments anciens, sa fascination pour les civilisations disparues, son goût du portrait et des types anthropologiques, sa sensibilité à la musique populaire et un style imagé, rompu à la pratique de la comparaison, qu’il reprend et développe à sa manière.
D’une manière plus indirecte, Marie de Ujfalvy a marqué l’histoire du voyage, à un moment où peu de contrées restaient encore à découvrir, et plus largement l’histoire littéraire, en rédigeant deux récits dans lesquels se laisse entendre une voix aux harmonies nouvelles. Dès 1894, Marie Dronsart, célèbre traductrice des romans de Robert Louis Stevenson, fait figurer notre auteur parmi les grandes voyageuses du XIXe siècle, ces quelques femmes “curieuses” au fondement même d’une tradition du récit de voyage au féminin. Selon Marie Dronsart, le goût pour le voyage est une inclination naturelle des femmes : c’est d’évidence qu’elles s’adonnent au charme de l’inconnu, qu’elles livrent avec finesse et vivacité l’individualité de leurs impressions et affirment l’originalité de leur point de vue. Ces récits témoignent d’une lente mais sûre colonisation de la société mâle, du passage d’une position ancillaire de la femme à un rôle de premier ordre pleinement assumé dans le progrès de la civilisation.
L’itinéraire et les aventures racontées dans le récit témoignent bien du caractère intrépide de pareil voyage. Les Ujfalvy rejoignent Bombay par mer, à bord d’un navire du Lloyd autrichien qui, de Trieste, relie l’Inde par le canal de Suez encore tout frais dans les mémoires françaises. Le train conduit ensuite les voyageurs à Ambala : là commence la véritable aventure. Ce ne seront plus que routes de montagnes, parcourues en différents types de chaises à porteurs – dhoolie, dandy, champang, bien souvent inconfortables –, à cheval, à pied, en barque?
D’Ambala, ils parviennent à Simla, capitale actuelle de l’Himachal Pradesh, alors station d’altitude et capitale d’été de l’Inde britannique, où ils rencontrent le vice-roi, lord Ripon, et les représentants officiels du British Raj. Leur projet de gagner le Cachemire par les différents Hill States himalayens représente déjà un périple inhabituel et courageux. Quittant le confort des maisons coloniales, les Ujfalvy et M. Clarke, qui partagera leur route jusqu’à Srinagar, sont accompagnés de François, un hindou de Pondichéry qui leur servira de guide et d’interprète, d’une vingtaine de coolies et des saïs qui s’occupent des chevaux, personnel dont ils changeront régulièrement. Ils passent alors d’étape en étape du Kulu au Mandi et de Kangra au Chamba, franchissant les multiples cols et traversant les fleuves et rivières non moins nombreux dans ces régions accidentées. Lorsqu’ils ne dorment pas sous tente, ils logent dans les bungalows “réglés et tarifés” par les Anglais ou dans les dharmshala, maisons de repos généralement sommaires mises à disposition par les autorités locales. Si Mme de Ujfalvy se félicite de la voirie aménagée par les Anglais, elle déplore que les routes placées sous la responsabilité des rajahs soient souvent mal entretenues et rendent le parcours – sans compter la contemplation des paysages ! – inconfortable, tandis que la nature y est dévastée par une déforestation effrénée. De surcroît, certains villages sont mis en quarantaine pour cause d’épidémie de choléra, ce qui contraint les voyageurs à changer d’itinéraire. Mais Marie de Ujfalvy trouve un grand charme à cette vie nomade, et la beauté enchanteresse de la nature, le plaisir de la découverte et l’étonnement devant la diversité des populations l’emportent toujours sur les aléas du voyage. C’est avec vivacité qu’elle décrit le spectacle qui s’offre à elle et parsème son récit d’anecdotes frappantes. C’est par exemple avec un humour enjoué que la voyageuse raconte avoir été surprise par l’orage lors d’une excursion qui aurait pu se révéler fatale. Elle raconte ainsi leur retour au bungalow : “Nous étions [?] méconnaissables et métamorphosés en fontaines [?] Nous nous mîmes gaiement à table, car nous avions faim, et, le danger passé, la sécurité n’en est que plus charmante.”
Mais le point culminant du voyage est certainement la traversée du Cachemire jusqu’au Baltistan, sur les flancs du Karakoram, dont les paysages désolés, qui contrastent sévèrement avec les vallées luxuriantes de l’Himalaya, privent le séjour des voyageurs de tout agrément. Le maharajah du Cachemire, Ranbir Singh, prend à sa charge les frais du voyage et met à leur disposition son tehsildar, ou percepteur d’impôts, ainsi que coolies et marchandises. L’équipée, à laquelle s’adjoignent le peintre américain M. de Forest et son épouse, traverse le haut plateau du Deosai (“plateau du Diable”) où, à plus de 4 000 mètres, le mal d’altitude se fait sentir. M. de Ujfalvy est pris de cruels maux de tête et de saignements de nez. Remontant alors le cours de l’Indus, Mme de Ujfalvy raconte une chasse à l’ours plus burlesque qu’épique, l’auteur s’applaudissant discrètement d’avoir contribué à l’échec de l’entreprise de ces messieurs. C’est en visitant les villes de Skardu et de Shigar, puis des régions limitrophes du Ladakh, que l’enquête ethnographique des Ujfalvy bat son plein. Par manque de moyens, les deux voyageurs regagnent à contrecœur Srinagar et quittent le Cachemire par les régions septentrionales de l’actuel Pakistan où ils continuent leur enquête dans les régions montagneuses du Yaghestan, visitent Baramula, Rawalpindi et la station sanatoriale de Murree. Ils ne peuvent quitter l’Inde sans voir Delhi et Agra, et quittent Bombay le 9 décembre, après huit mois de voyage.
Quels sont les enjeux et les conditions de ce Voyage d’une Parisienne dans l’Himalaya ? À bien y regarder, pareil intitulé est en effet investi de nombreuses significations. C’est, d’abord, le regard d’une Française sur des contrées colonisées par les Anglais qui fait l’un des intérêts originaux de ce récit. L’histoire de la présence britannique sur le sol indien remonte alors à plus de deux cent cinquante ans, mais c’est au XIXe siècle que l’empire colonial se développe avec le plus de vigueur, annexant rapidement les derniers territoires indépendants à la Compagnie des Indes orientales (ou East India Company), compagnie marchande plénipotentiaire en Inde. C’est pour briser le monopole détenu par la Compagnie et pour faire face à son pouvoir grandissant que l’Angleterre ratifie en 1784 l’India Act. Un “conseil des commissaires” est institué, visant à affaiblir la Compagnie en impliquant progressivement le gouvernement britannique dans la gestion de l’Inde. Le pays est alors découpé en trois provinces (Bengale, Bombay, Madras), à chacune desquelles correspond une armée qui dépend de la Compagnie des Indes orientales, composée de troupes indigènes (cipayes, ou sepoy en anglo-indien, du persan sipahi, “soldat”) et de régiments européens.
Les événements récents qui forment l’arrière-fond sur lequel se dessine le voyage des Ujfalvy ont amené à une réorganisation profonde des relations anglo-indiennes. La révolte des Cipayes éclate en 1857 après de nombreux signes déclencheurs au cours de la première moitié du siècle. Les régiments indigènes se retournent contre leurs maîtres coloniaux. Après une lutte extraordinaire, la Mutiny se voit réprimée par les régiments européens aidés des troupes mercenaires sikhes et cachemiries. Aussi est-ce avec une attention particulière que Mme de Ujfalvy considère ceux qu’elle appelle les “races guerrières” : Sikhs, Rajputs, Dogras, Gurkhas?
Les conséquences de la révolte sont d’importance : la reine Victoria destitue la Compagnie et impose la tutelle de la couronne britannique tant dans les affaires administratives que militaires du sous-continent. Si la reine ne sera sacrée impératrice des Indes qu’en 1877 par le vice-roi lord Lytton (mandat de 1876 à 1880), l’année 1858 marque le début officiel du British Raj of India (Empire britannique des Indes) et instaure l’application radicale de l’India Act. Ainsi, l’armée, réformée, dépend désormais immédiatement de la Couronne, tandis que les territoires conquis sont organisés en provinces et en districts. Ils sont administrés respectivement par des gouverneurs et des commissaires britanniques placés sous l’autorité du gouverneur général de l’Inde, ou vice-roi, installé à Calcutta, au Bengale, et à Simla, dans l’Himachal Pradesh, capitale d’été officielle depuis 1867. En deçà, la gestion des anciens États princiers est laissée à la charge des rajahs locaux, dont le pouvoir, exercé de jure, ne garde généralement qu’une aura nominale, car l’autorité est de facto assurée par l’administration britannique. Marie de Ujfalvy ne manquera pas de souligner les conséquences de cette gestion des territoires à deux vitesses et les écarts notables entre les régions administrées directement par les Anglais et les régions où les rajahs conservent une certaine autonomie. La révolte des Cipayes développe chez les colons britanniques un profond sentiment de vulnérabilité, tandis que les rajahs doivent se contenter d’un pouvoir sérieusement affaibli. Les jugements que porte Marie de Ujfalvy sur l’attitude des uns – l’arrogance des Anglais – et des autres – le laisser-aller de l’administration locale – ont sans aucun doute partie liée aux effets durables de la situation coloniale qui marque l’ensemble du territoire indien après 1858.
Si les Ujfalvy traversent le nord de l’Inde depuis Bombay jusqu’à Simla en passant par Delhi, ils cherchent à gagner avant tout les États himalayens (les Hill States) de l’actuel Himachal Pradesh (les vallées de Kulu, de Mandi, de Kangra et de Chamba), le Cachemire et, plus au nord, le Baltistan (Petit-Tibet), ainsi qu’une partie du Ladakh, avant de repartir par le Penjab. Ces régions, pour la plupart fraîchement annexées au Raj, portent alors encore les marques des guerres répétées dont elles ont été le théâtre. Les guerres gurkhas sévissent au début du XIXe siècle à travers le Népal et les Hill States himalayens, et provoquent notamment, à la suite de certains procès d’intention, l’hostilité entre le Tibet et l’Inde britannique, qui s’ignoreront pour ainsi dire jusque dans la dernière décennie du siècle. Les avancées gurkhas sont arrêtées par Ranjit Singh et les territoires conquis par les Gurkhas (Kangra, Mandi, Kulu) sont remis aux rajahs locaux, placés sous la surveillance du commissariat britannique.
Mais ce sont avant tout les guerres anglo-afghanes qui déterminent le contexte géopolitique des régions visitées par nos deux voyageurs. Depuis les années 1820, les Anglais considèrent avec méfiance l’expansion de la Russie tsariste en Asie centrale, en Perse et en Afghanistan. Le conflit éclate entre Ranjit Singh – le gouverneur sikh à la tête du Penjab – et Dost Mohammed – à la tête, lui, du Sindh et d’une grande partie de l’actuel Afghanistan. La première guerre anglo-afghane, qui dure quatre longues années, est ainsi le premier conflit par procuration entre la couronne britannique et la Russie ; elle signe le début du Grand Jeu, selon l’expression popularisée par le roman de Rudyard Kipling, Kim. L’occupation de l’Afghanistan par les troupes anglo-sikhes est précaire et prend fin à la mort de Ranjit en 1839. Quarante ans plus tard, la mission de Robert Shaw à Kaboul commanditée par lord Lytton et le voyage clandestin au Turkestan de George Hayward, qui fit grand bruit – l’auteur de notre récit ne manque pas de faire allusion au meurtre récent du voyageur –, déclenchent la seconde guerre anglo-afghane. Là encore, il s’agit d’une guerre par procuration, directement liée à l’effondrement quelques années plus tôt de l’État indépendant de Kachgarie en Asie centrale après la mort du célèbre Yakub Beg en 1877. Ces événements réveillent la rivalité des Anglais et des Russes, en raison notamment de la russophobie croissante de lord Lytton. La guerre se conclut en 1880 par le traité de Gandamak, qui marque symboliquement la limite de l’expansion du Raj.
Les Ujfalvy découvrent donc l’Empire britannique des Indes à son apogée, c’est-à-dire après l’annexion récente du Sindh, du Penjab et de certains territoires afghans, ainsi qu’après l’annexion des restes de l’Empire moghol au nord, dont le Raj se déclare le successeur. En effet, entretemps, les conflits de succession consécutifs à la mort de Ranjit Singh encouragent les Anglais à annexer le Penjab et les régions de l’actuel Pakistan alors sous autorité des rois sikhs. Les deux guerres anglo-sikhes qui s’ensuivent – 1845-1846 et 1848-1849 – et la collaboration de Gulab Singh avec les Anglais auront pour conséquences une relation relativement pacifique avec les Sikhs du Penjab (ils feront preuve de loyauté pendant la révolte des Cipayes) et la reconnaissance du Cachemire comme État indépendant.
À vrai dire, de tous les territoires indiens, le Cachemire jouit du statut particulier que lui a conféré sa proximité avec les territoires occupés par la Russie tsariste au-delà de ce que les Anglais appellent la “frontière du Nord-Ouest” ou, simplement, la Frontier. La politique britannique de l’époque liée au début du Grand Jeu, politique préconisée par lord Mayo (1869-1872) et ses prédécesseurs, est celle des États-tampons. En se ménageant de pareilles zones franches, le Raj cherche à tirer avantage des frontières naturelles et assurer la sécurité de son territoire. Les régions montagneuses de l’Afghanistan, du Cachemire, du Baltistan représentent les zones où les empires britannique, russe et chinois entrent en contact. Comme aujourd’hui, leurs frontières sont mal définies et sources de nombreux conflits. Avant que les enjeux géopolitiques ne se concentrent sur le Tibet encore largement inconnu, cette “grande surface isolante entre la Chine et le monde européen” (Jacques Bacot) appelée à jouer le rôle d’État-tampon à partir du dernier tiers du siècle, c’est bien à cette jonction entre l’Inde et l’Asie centrale que les Anglais veulent contrer la menace de l’expansion de l’Empire russe. Pour cette raison, à l’issue des guerres anglo-sikhes, le vice-roi récompense Gulab Singh pour son appui efficace en lui cédant l’autorité sur le Cachemire . Ainsi naît l’État dogra – de l’ethnonyme qui donna son nom aux régiments au service de Gulab – de Jammu, Cachemire et Ladakh en 1847, unique royaume indépendant au sein de l’Inde britannique. Par la suite, le maharajah, de mèche avec le Raj, cherche à étendre son royaume au nord et annexe sous la conduite de Zorawar Singh les États de Gilgit, Yasin, Hunza et Chitral. Son règne représente pour les voyageurs le nouvel âge d’or de la région que les empereurs moghols décrivaient déjà comme le “paradis terrestre”.
Le successeur de Gulab, son fils Ranbir (1830-1885), s’efforcera de continuer l’œuvre de son père, mais rencontrera plusieurs difficultés dont Mme de Ujfalvy se fait le témoin oculaire. Le soupçonnant de chercher à faire alliance avec le tsar durant les discussions anglo-russes sur les frontières afghanes entre 1869 et 1873, le Raj lui impose un résident – comme ce fut le cas au Népal et à Gilgit par exemple. Pareille imposition est fort mal perçue par Ranbir Singh, et le prétexte avancé par les Anglais que le résident n’a charge que de s’intéresser aux relations extérieures de l’Inde britannique ne fait bien sûr pas illusion. Le résident est présent à Srinagar huit mois par an – ce qui rythme la vie des Anglais et des touristes en villégiature au Cachemire. Marie de Ujfalvy peut l’attester, qui quitte le Cachemire en même temps que tous les résidents occidentaux à l’automne, au moment où Ranbir, qu’elle qualifie de particulièrement hostile aux étrangers, procède au prélèvement de l’impôt annuel. Cette pratique, et la manière dont le maharajah rend la justice dans la principauté, s’ajoutent aux accusations portées à son égard et lui attirent la méfiance appuyée de représentants britanniques comme le capitaine George Hayward, dont on attribuera le meurtre en 1870 à une conspiration orchestrée par Ranbir lui-même. Toutefois, le gouverneur général, encore désireux en cette période de ménager une situation relativement stable dans les régions du Nord, opte pour un statu quo temporaire. La politique d’ingérence du Raj au Cachemire connaît ainsi une période de latence de 1873 à 1877, avant l’éclatement de la seconde guerre anglo-sikhe.
Toutefois, le Cachemire doit faire face à des événements particulièrement cruels, si bien que la région en vient à être surnommée la “terre de catastrophes”. Marie de Ujfalvy fait preuve d’un discernement remarquable quand elle met sur le compte d’une “dépression” globale au Cachemire la dévastation qu’elle observe dans les zones traversées en voyage. En effet, après les famines de 1832 et 1838, le Cachemire connaît une période de disette en 1877, qui a pour funeste conséquence l’exil des nombreux artisans vers le Penjab. Par conséquent, le commerce des châles, qui faisait la réputation du Cachemire, est moribond et le tourisme accuse une baisse notable. Il faut ajouter que cela est également un effet des guerres franco-prussiennes ; la France, grand importateur de pashmina sous Napoléon, rompt brutalement le marché. L’impératrice Joséphine, qui en avait lancé la mode, possédait une collection se montant, dit-on, à plus de 4 000 pièces ! Pour redresser la situation économique, le maharajah diversifie les artisanats et développe notamment avec l’aide de la France l’industrie des tissus et des tapis mais aussi différents domaines de production qui contribuent à l’épanouissement économique du Cachemire. C’est ainsi que les voyageurs rencontrent aux alentours de Srinagar des négociants français comme Henri Dauvergne (“notre compatriote Dauvergne, que tout Paris a connu, et qui absorbait alors le commerce des châles”, écrit Marie Dronsart) ou comme Georges Ermens, directeur des travaux agricoles et viticoles du maharajah. Les Anglais, de leur côté, sont toujours désireux d’améliorer les réseaux de communication et les conditions de vie au Cachemire par l’entremise d’un résident officiel ; lord Ripon, le vice-roi que les Ujfalvy rencontrent à Simla, poursuit en ce sens le mouvement lancé par son prédécesseur lord Lytton. Mais ce ne sera qu’en 1884, à la mort de Ranbir, que le contrôle britannique y sera véritablement prépondérant. La modernisation de ces régions sauvages (construction de routes, aménagements urbanistiques) est, pour les voyageurs, source d’émerveillement : en parcourant les routes du Baltistan septentrional, aux paysages arides et grandioses, Marie de Ujfalvy ne tarira pas d’éloge envers les formidables ouvrages entrepris par Mehta Manghel, le kardar du Baltistan, c’est-à-dire le représentant local de l’autorité britannique.
Lors de leur périple, les Ujfalvy sont reçus par des personnalités éminentes de l’univers colonial britannique en Inde, et bénéficient en cours de route des infrastructures mises en place par l’administration pour les voyageurs. C’est l’occasion pour Marie de Ujfalvy de se rappeler l’accueil des représentants du tsar lors de leurs précédents voyages en Asie centrale, et de comparer les étiquettes, les tempéraments, le sens de l’ordre et de l’hygiène, l’administration coloniale ou encore l’attitude envers les populations locales. À l’égard des deux mentalités nationales, l’auteur a des jugements sans appel : manque d’égards chez les Anglais, cordialité superficielle chez les Russes. À propos de la relation que les colons entretiennent avec leurs sujets “vaincus, mais non conquis”, tout en reconnaissant un certain respect des Anglais pour les cultures locales, elle condamne leur mépris et leur condescendance : “[Les Russes] savent bien mieux se faire obéir des indigènes dans le Turkestan que les Anglais des hindous [?] Les Anglais parlent la langue des indigènes, et les Russes, au contraire, forcent les indigènes qu’ils emploient à parler leur langue. Pourtant les Russes ne sont pas plus détestés des peuples du Turkestan que les Anglais ne le sont des peuples de l’Inde. Cela prouve encore une fois que les peuples de l’Orient ne reconnaissent que la force brutale. Soyez doux avec eux, ils vous méprisent.”
La distance avec laquelle Marie de Ujfalvy juge les colonies britanniques et russes rappelle que la France a été évincée de l’Inde depuis longtemps et qu’elle ne prend pas part au Grand Jeu. Si, dans d’autres contrées du monde, les voyageurs ne se privent pas d’évaluer la grandeur de leur propre empire à l’aune de leurs concurrents, Marie de Ujfalvy dessine au contraire l’image d’un empire français en retrait. Dès le passage du canal de Suez, dont la construction s’est achevée en 1869, c’est le génie national de la France que Marie de Ujfalvy célèbre, certes avec emphase, mais non sa grandeur coloniale. De fait, le voyage en Égypte et en Inde est à certains égards un parcours des territoires perdus par la France qui concentre, pour rivaliser avec les empires européens au lendemain de l’“Année terrible”, ses visées coloniales en Afrique et en Indochine. Néanmoins, c’est non sans un fort patriotisme et la conscience d’une gloire nationale d’un autre ordre que les Ujfalvy se rendent dans les contrées reculées du Cachemire.
Certes, le Cachemire est une destination privilégiée par les Anglais, notamment depuis que les célèbres photographes Samuel Bourne, John Burke et William Baker ont popularisé les charmes pittoresques de la vallée et les attraits sublimes des hautes montagnes environnantes. C’est d’ailleurs en s’arrêtant dans l’échoppe de Burke à Murree que les Ujfalvy rapportent une collection de clichés qui serviront de modèles pour les gravures illustrant leur futur récit. Certes encore, les voyageurs partent dans ces régions avec en mémoire les récits d’Hérodote et les conquêtes d’Alexandre racontées par Arrien, qui peuplèrent leurs rêveries d’enfants.
Pourtant, le nom de Cachemire résonne d’une manière particulière aux oreilles françaises. En effet, on peut parler d’une longue familiarité – quoique discontinue – avec la “Vallée heureuse”. Le voyageur du XVIIe siècle François Bernier, engagé en qualité de médecin au service de l’empereur moghol Aurangzeb, est le premier Européen à avoir visité cette région. Son récit plein d’émerveillement a fortement contribué à l’imaginaire européen lié au Cachemire, et les voyageurs postérieurs ne manquent pas de citer les anecdotes truculentes qu’il raconte – notamment le miracle produit par les mollahs de Baramula dont Marie de Ujfalvy rapporte à son tour la démystification malicieuse du voyageur. Au début du XIXe siècle, le célèbre naturaliste Victor Jacquemont herborise sur les flancs de l’Himalaya dans un esprit scientifique proche de celui d’Alexandre von Humboldt. Si son œuvre demeure relativement aride, sa correspondance sera publiée immédiatement après sa mort et fournira un extraordinaire point de comparaison aux voyageurs de plus en plus nombreux du siècle. L’un d’eux, précédant de quelques années le voyage des Ujfalvy, Guillaume Lejean, fort de cet héritage, se rend lui aussi au Cachemire par la route du Penjab, par laquelle M. et Mme de Ujfalvy quitteront le pays. Lejean s’étonne quelque peu de la sévérité avec laquelle son savant prédécesseur juge le pays. Comme Mme de Ujfalvy dans son récit, M. de Ujfalvy ne peut que souligner les différences de point de vue entre Bernier, le “sceptique, observateur fin et délicat”, Jacquemont, le “savant consommé avant l’âge qui ne vit que pour ses chères plantes”, et Lejean, l’“intrépide voyageur, poète et historien à la fois”. Il résume ses propres impressions par rapport au regard de ses illustres prédécesseurs, trahissant quelque peu ses origines par-delà sa culture d’adoption :
“Alors que la vallée de Cachemire apparut soudain sous mes pieds, je dois dire que de prime abord je me rappelai les paroles de Jacquemont ; et j’étais tout disposé à trouver exagérées les descriptions de Bernier et de Lejean. Mais, plus mon séjour dans le Cachemire se prolongeait, plus mon impression première se modifiait. En quittant la contrée trois mois plus tard, j’ai reconnu que ce pays, où la misère humaine côtoie les magnificences de la nature, que ce peuple, le plus fourbe et le plus lâche de la Terre, me plaisent singulièrement ; que je n’oublierai jamais le Cachemire et ses habitants, car le pays et les hommes sont pour le voyageur européen, venu des plaines des Indes, une douce réminiscence de la patrie : on se croirait au Tyrol, au milieu de paysans de la Romagne.”
Remarquons ainsi que, globalement, les enjeux des voyages français à la fin du XIXe siècle se rapportent au commerce et au tourisme, mais également au domaine de la science. Or la science est la raison première de la présence des Ujfalvy dans le “Paradis terrestre” des Moghols chanté par Thomas More dans Lalla Rookh?
S’il convient de souligner l’originalité de l’itinéraire suivi par les Ujfalvy pour se rendre à Srinagar – la route Simla-Srinagar (“route impossible” leur fait savoir sir Egerton qui les y attend), c’est en effet au Cachemire et dans les confins septentrionaux de la principauté que se joue l’intérêt le plus aigu du voyage. Les voyageurs ont d’abord l’intention de se rendre jusqu’au point extrême des territoires sous l’influence britannique, là où, au cœur de l’Hindu Kush et des Pamirs, ils n’avaient pu pénétrer lors de leurs précédents voyages de l’autre côté de la Frontier. Ranbir Singh leur refuse l’accès à Gilgit, car la relation avec cette région était plus qu’incertaine alors. Le résident anglais en poste à Gilgit, le capitaine John Biddulph, avait dû être rapatrié d’urgence et le meurtre encore récent de George Hayward entravait quelque peu la relation de confiance entre le maharajah et les Anglais. Ils pourront néanmoins se rendre dans les régions peu fréquentées de Skardu, et au-delà jusqu’à Shigar. C’est avec fierté que Marie de Ujfalvy peut déclarer : “Je suis la seule femme européenne qui ait foulé de son pied cette terre éloignée. Les Anglaises mêmes ne s’y sont pas senties attirées par cette nature sauvage et grandiose.”
Que viennent chercher là nos deux voyageurs avec tant d’obstination ? L’ambition de Charles-Eugène de Ujfalvy est de procéder à l’ethnographie des peuples retirés dans ces confins montagneux. Ils poursuivent en ce sens l’œuvre monumentale de Louis Rousselet qui avait voyagé à travers l’Inde et jusque dans les États de l’Himachal Pradesh. Pour le Cachemire et le Baltistan, quoique quelques voyageurs britanniques se soient déjà consacrés à cette tâche, Ujfalvy désire constater de ses propres yeux et éprouver selon ses propres méthodes l’appartenance anthropologique des populations. Son voyage revêt donc un aspect de collecte ethnographique important, et Marie de Ujfalvy raconte sans se lasser les moments où les voyageurs entreprennent d’acheter aux habitants, d’abord stupéfaits de l’objet du marché puis fort satisfaits de l’issue de l’échange, leurs vêtements ou quelque objet en leur possession. Il semble notamment difficile de faire comprendre aux populations locales qu’on puisse désirer le costume plutôt que la femme qui le porte?
Mais la collecte ethnographique n’est qu’un aspect de ce voyage scientifique. M. de Ujfalvy détient en effet une thèse : parmi les multiples ethnies qui cohabitent dans ces montagnes, il serait possible de démêler par l’observation des types raciaux l’histoire complexe des migrations remontant à une haute antiquité et, en particulier, de retracer l’avancée des conquérants aryens qui auraient traversé du nord au sud l’Hindu Kush en direction de l’Inde. Charles-Eugène, comme son épouse Marie, sont de fervents disciples de la pensée “anthropologiste” et des méthodes anthropométriques juste développées par le créateur de la Société d’anthropologie de Paris, Paul Broca, qui assura en personne la formation des deux époux. Par ces méthodes “scientifiques” et positives, Ujfalvy entreprend de contester les observations des voyageurs. Ce sont principalement les officiels anglais, Alexander Cunningham pour ses travaux sur la géographie de l’Inde ancienne (The Ancient Geography of India, 1871), Robert Shaw (voyages à Kachgar en 1871 et au Cachemire et au Baltistan en 1878), plus spécialement les études de Frederick Drew (Jummoo & Kashmir, 1875) et de John Biddulph (Tribes of the Hindoo Koosh, 1880), mais aussi de Gottlieb Leitner, savant autrichien que M. de Ujlfavy aura l’occasion de convaincre in situ de ses méthodes. En effet, contre l’avis émis par ces savants sur la base d’une enquête principalement linguistique et diffusé en France par l’entremise de l’anthropologue Joseph Deniker et du célèbre géographe Élisée Reclus, il s’agit de prouver par les méthodes de Broca que ce peuple de langue tibétaine et de confession musulmane serait d’ascendance aryenne, “vestige vivant” du passage des envahisseurs qui écumèrent l’Inde et l’Europe en des temps reculés. »
Établissement du texte par : Samuel Thévoz
Rédaction des notes par : Samuel Thévoz


