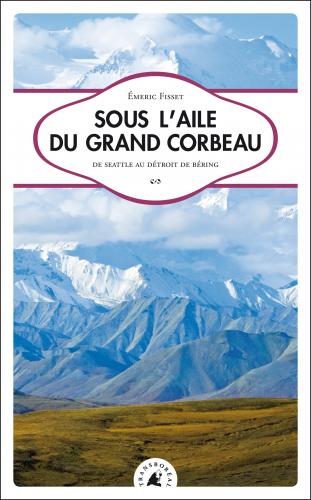
Shishmaref, île Sarichef :
« À l’instar des Sherpas qui ne foulent jamais d’eux-mêmes les sommets himalayens, des voisins du Nyiragongo qui ignorent son lac de lave ou des riverains de l’Amazonie qui ne peuvent rien savoir de ses sources, les Iñupiat méconnaissent le détroit de Béring. En anglais, ils le désignent par ocean plutôt que par strait, confusion répondant au terme tariuq – “sel” – qui, en iñupiaq, désigne toute étendue marine. Quiconque veut entreprendre la traversée du détroit de Béring se heurte à cette confusion sémantique. Respect teinté de terreur pour l’océan, ignorance du détroit, consacrée par sa fermeture politique entre 1948 et 1987. Mes questions à son sujet restent pourtant élémentaires : à quelle date et d’où tenter son franchissement hivernal ? Quels moyens employer, quelles conditions attendre ? Qu’en est-il des courants et de la banquise ?
Après-demain, 17 mars, la lune sera pleine. À mon arrivée à Shishmaref, je me lamentais chaque matin de la coloration des nuages du large. Leur trame grisée tenait à la réflexion des eaux et prouvait l’existence d’immenses brèches dans la banquise, à quelques kilomètres seulement ! Depuis quatre jours toutefois, le thermomètre affiche – 45 °C : l’hiver réenglace le détroit. Les nuages retrouvent au large leur blancheur éclatante. En cette mi-mars aussi, certaines simulations météorologiques m’apprennent que les dépressions atmosphériques successives issues de la mer d’Okhotsk devraient faiblir au-dessus du Kamtchatka pour mourir en mer de Béring. Ce point est crucial : leur passage engendrerait sinon un suroît qui rouvrirait la banquise du détroit en quelques heures. Les télécopies reçues attestent la présence d’un anticyclone qui, en isobares concentriques, couvre l’océan Glacial Arctique. Aucun front majeur de perturbations n’est donc attendu pour la fin de la semaine, voire le début de la suivante.
Lune bientôt pleine, chape de froid et prévisions météorologiques coïncident pour me convaincre de l’opportunité d’une tentative. Toutefois, mon départ subit un retard de deux jours. L’annonce que je cherchais un coéquipier m’a fait tardivement connaître un certain Warren, prêt à se joindre à moi pour peu que je consente à payer son retour. En dépit de ses yeux qui affichent sa consommation de marijuana, j’ai cru à la bonne foi et aux capacités de “Mich”, ainsi qu’on le surnomme ici. Je me disais que ce sosie du héros – au demeurant japonais ! – du film Agaguk, d’après le succès de librairie d’Yves Thériault, serait mon Zorba ! Que les oppositions Eskimo/Blanc, savoirs concret/abstrait, équipements coutumiers/synthétiques se révéleraient intéressantes. Considérant sa chevelure flottante, son parka et ses mukluk, je me répétais que Warren Kiyutelluk ne manquerait pas d’apporter une touche autochtone à l’exploit puisque, de mémoire eskimo, le détroit de Béring restait inviolé l’hiver. Toutes proportions gardées, je ferais un peu comme sir Edmund Hillary qui, en 1953, avait associé le sherpa Norgay Tenzing à sa propre victoire sur l’Everest. Cette présence à mon côté accroîtrait aussi mes chances de réussite et de survie, quoique Mich m’eût expliqué d’emblée qu’il ne connaissait de la glace que ce que ses expéditions printanières de chasse au phoque lui avaient appris. Depuis que le maire de Shishmaref m’avait raconté sa dérive au large du cap Espenberg, j’avais compris que la connaissance de la banquise autre que littorale était perdue. Cette mésaventure, la dernière en date d’un villageois, remontait à janvier 1962 (le mois et l’année de ma naissance) : Bill Barr et son compagnon avaient dérivé une semaine avec leurs attelages de chiens. Ce récit a constitué l’un des nombreux avertissements reçus car l’Eskimo préfère relater son expérience, incident ou tragédie, plutôt que de décréter possible ou impossible une gageure. Il ne conseille pas de tenter la traversée à partir de Wales, de Mitletukeruk, d’Ikpek, de l’île Sarichef, du cap Espenberg – voire de la pointe Hope ! –, mais évoque les courants puissants à tel ou tel endroit de la côte, les murailles d’icebergs entrevues ici, les failles soupçonnées là. Il ne mentionne pas janvier ou février, plutôt que mars : il dit que chaque année est différente, que la banquise est changeante, que les courants sont variables. Il ne faut pas seulement juger ces réponses comme teintées d’ignorance ou de méfiance, mais aussi comme révélatrices de l’attachement au libre arbitre que manifestent les chasseurs iñupiat, respectueux de mon entreprise. La mise en garde contre la puissance et l’imprévisibilité de tariuq, l’océan, restait implicite dans leurs récits.
Mais revenons-en à Mich. Alors que j’essayais, via la Commission régionale du détroit de Béring, d’obtenir son autorisation d’entrée en Sibérie, il occupait la geôle municipale ! À 6 heures du matin, il avait frappé à la porte de la maisonnette que Clifford avait mise à ma disposition : ivre mort et le visage tuméfié par les coups, il serinait qu’il m’accompagnerait, qu’il soutiendrait ma tentative. Dans le froid cinglant qui devait alors tuer sur le pavé d’Anchorage le frère adoptif de Shirley, je dus ensuite traîner Mich jusqu’à son canapé, avant qu’on ne vînt l’arrêter. La cuite de Mich avait dû être arrangée par les siens qui ne voulaient pas le laisser risquer sa vie avec la mienne. Néanmoins, je me réjouissais encore de sa compagnie, même si je n’osais y croire pour rester psychologiquement apte à réaliser seul mon défi. Quoi qu’il en fût, la difficulté des procédures administratives, en dépit du fait qu’aucun visa n’est requis pour les riverains du détroit, m’interdit de l’emmener. Je perdis ainsi deux jours à tenter de démêler l’écheveau administratif que la municipalité réemmêlait dans mon dos. Rien ne me permet aujourd’hui de rappeler la cohorte de pensées contradictoires qui, jour après jour depuis le cauchemar de décembre dernier où je me vis pour la première fois dérivant sur la glace, m’assaillit au cours des préparatifs. Ne reste maintenant qu’à taire mes angoisses, la peur et le doute, pour me retrouver seul, enfin, face à la sauvage majesté de la banquise.
Sous la neige amoncelée, Elsie Weyiouanna, la mère de Clifford, a retrouvé l’un des gros phoques abattus à l’automne. Deux nuits durant je dors près de sa carcasse qui décongèle sur le sol du bungalow, tandis que son regard translucide rappelle l’effarement de sa mort. Après que Shirley l’a dépecé au moyen d’un ulu, je le traîne au-dehors pour le fendre à la hache. Sur la neige, dans l’air saisissant de froidure, je découpe ensuite l’animal au couteau. Ses viscères souillant la neige autour de moi, je taille sa graisse et sa viande en cubes assez gros pour qu’un chien ne puisse les avaler d’un coup. Je remplis chacun des trente sachets Ziploc, hermétiques et doublés, de trente de ces cubes. Bien qu’il me reste encore des nutriments pour chiens, je récupère aussi des harengs gelés et du saumon séché. Cette nourriture devrait suffire à alimenter mes neuf chiens pendant huit à douze jours, selon l’effort exigé d’eux. Red, pas mon Red d’origine mais celui que j’ai échangé à Brevig Mission, et Fox, qu’un homme m’a donné alors qu’il s’apprêtait à l’abattre, feraient les frais de toute dérive imprévue sur la banquise, au-delà de la dizaine de jours impartis?
Warren Sinnok renforce les lisses du traîneau et en vérifie chaque écrou ; Bessi, sa débrouillarde épouse, attache doublement la ligne de trait, qu’elle a allongée : je veux pouvoir disposer Bill seul en tête, car il m’obéit le mieux. Puis je troque mes excédents de matériel contre deux câbles d’attache pour chiens, avec mes amis Sinnok et, sur leur conseil, acquiers un unaaq. Il s’agit d’un manche de bois au bout duquel est ficelée une pointe métallique longue de 30 centimètres, qui va s’amenuisant. Si, fichée dans la glace, cette pointe ne la perce pas, cela signifie qu’elle est assez épaisse pour permettre le passage.
Vendredi 17 mars. Depuis 5 heures du matin, j’emballe mon attirail. Dans l’air glacial qui fige le moindre souffle, je nourris d’abord les chiens puis charge le traîneau. Emballé dans des sacs plastique, mon duvet vient se loger à sa pointe. Un sac étanche enfermant une tenue grand froid et un duvet, de rechange tous deux, prend place ensuite. L’unaaq, la pelle, la scie à glace, le couteau et mon fusil à pompe se casent de part et d’autre des réserves de nourriture, de toute cette viande de phoque découpée et naturellement congelée. Le matelas-mousse, la tente, d’autres vêtements et même mon ordinateur Powerbook (que je n’ai pas osé expédier en Russie) viennent s’intercaler. Je boucle les sangles du sac de traîneau. L’excitation des chiens est à son comble dès que j’étire la ligne de trait. Et Bessi a toutes les peines du monde à botter mes chiens. Ses doigts, forcément nus, s’engourdissent très vite tandis qu’elle passe une bottine de feutre au-dessus des griffes rétives, et elle n’en retrouve l’usage qu’en les frottant dans l’échine des bêtes. Un à un, j’attelle mes compagnons : Bill et Spice, Buck et Stripe, Red, Fox et Paws, Spooky. Je referme ensuite mon parka : ils savent ce que cette ultime disposition signifie, et jappent d’excitation. À la hâte je serre les mains de Linda, l’enseignante, de Warren, de Clifford et de Shirley, ainsi que d’un ancien de Shishmaref. J’attelle enfin Winner qui, surexcité, attaque déjà la ligne de trait avec ses crocs. Bessi se tient sur l’une des lisses du traîneau, moi sur l’autre. “All right !” : les chiens font sauter de la neige le crochet qui nous retenait. J’esquisse un geste d’adieu à tous les amis rencontrés en deux semaines de séjour ici. Les élèves me saluent depuis leur classe. Je contourne le village, avant de rejoindre le remblai qui renforce la rive du détroit. Bessi saute du traîneau et je m’éloigne plein ouest, seul.
Plus personne n’est en vue. La capuche fourrée que je rabats sur ma tête achève de m’isoler du monde juste quitté. J’espérais qu’une motoneige m’accompagnerait, me ferait la trace sur quelques kilomètres. Rien ! Sans doute le froid, – 45 °C, est-il trop intense pour qu’un moteur démarre. Toute la journée, alors que le soleil incendie la banquise et effiloche lentement sa chape glacée, mon regard embrasse le littoral depuis la montagne Ear, dans mon dos, jusqu’au cap du Prince-de-Galles, sur ma gauche. Un ruban de collines étincelantes là-bas surmonte la ligne irrégulière de la banquise. Dernière vision, qui me rattache au continent dont je m’éloigne. Un immense bonheur m’envahit à l’idée que, pareillement, j’en découvrirai bientôt un autre : l’Asie. Je n’ai aucun doute à ce sujet. Elle est devant, à 160 kilomètres plein ouest. Sus à l’Asie? »
Cap Caution, détroit de la Reine-Charlotte (p. 57-61)
Rivière Swift, bassin de l’Anvik (p. 289-292)
Extrait court
« À l’instar des Sherpas qui ne foulent jamais d’eux-mêmes les sommets himalayens, des voisins du Nyiragongo qui ignorent son lac de lave ou des riverains de l’Amazonie qui ne peuvent rien savoir de ses sources, les Iñupiat méconnaissent le détroit de Béring. En anglais, ils le désignent par ocean plutôt que par strait, confusion répondant au terme tariuq – “sel” – qui, en iñupiaq, désigne toute étendue marine. Quiconque veut entreprendre la traversée du détroit de Béring se heurte à cette confusion sémantique. Respect teinté de terreur pour l’océan, ignorance du détroit, consacrée par sa fermeture politique entre 1948 et 1987. Mes questions à son sujet restent pourtant élémentaires : à quelle date et d’où tenter son franchissement hivernal ? Quels moyens employer, quelles conditions attendre ? Qu’en est-il des courants et de la banquise ?
Après-demain, 17 mars, la lune sera pleine. À mon arrivée à Shishmaref, je me lamentais chaque matin de la coloration des nuages du large. Leur trame grisée tenait à la réflexion des eaux et prouvait l’existence d’immenses brèches dans la banquise, à quelques kilomètres seulement ! Depuis quatre jours toutefois, le thermomètre affiche – 45 °C : l’hiver réenglace le détroit. Les nuages retrouvent au large leur blancheur éclatante. En cette mi-mars aussi, certaines simulations météorologiques m’apprennent que les dépressions atmosphériques successives issues de la mer d’Okhotsk devraient faiblir au-dessus du Kamtchatka pour mourir en mer de Béring. Ce point est crucial : leur passage engendrerait sinon un suroît qui rouvrirait la banquise du détroit en quelques heures. Les télécopies reçues attestent la présence d’un anticyclone qui, en isobares concentriques, couvre l’océan Glacial Arctique. Aucun front majeur de perturbations n’est donc attendu pour la fin de la semaine, voire le début de la suivante.
Lune bientôt pleine, chape de froid et prévisions météorologiques coïncident pour me convaincre de l’opportunité d’une tentative. Toutefois, mon départ subit un retard de deux jours. L’annonce que je cherchais un coéquipier m’a fait tardivement connaître un certain Warren, prêt à se joindre à moi pour peu que je consente à payer son retour. En dépit de ses yeux qui affichent sa consommation de marijuana, j’ai cru à la bonne foi et aux capacités de “Mich”, ainsi qu’on le surnomme ici. Je me disais que ce sosie du héros – au demeurant japonais ! – du film Agaguk, d’après le succès de librairie d’Yves Thériault, serait mon Zorba ! Que les oppositions Eskimo/Blanc, savoirs concret/abstrait, équipements coutumiers/synthétiques se révéleraient intéressantes. Considérant sa chevelure flottante, son parka et ses mukluk, je me répétais que Warren Kiyutelluk ne manquerait pas d’apporter une touche autochtone à l’exploit puisque, de mémoire eskimo, le détroit de Béring restait inviolé l’hiver. Toutes proportions gardées, je ferais un peu comme sir Edmund Hillary qui, en 1953, avait associé le sherpa Norgay Tenzing à sa propre victoire sur l’Everest. Cette présence à mon côté accroîtrait aussi mes chances de réussite et de survie, quoique Mich m’eût expliqué d’emblée qu’il ne connaissait de la glace que ce que ses expéditions printanières de chasse au phoque lui avaient appris. Depuis que le maire de Shishmaref m’avait raconté sa dérive au large du cap Espenberg, j’avais compris que la connaissance de la banquise autre que littorale était perdue. Cette mésaventure, la dernière en date d’un villageois, remontait à janvier 1962 (le mois et l’année de ma naissance) : Bill Barr et son compagnon avaient dérivé une semaine avec leurs attelages de chiens. Ce récit a constitué l’un des nombreux avertissements reçus car l’Eskimo préfère relater son expérience, incident ou tragédie, plutôt que de décréter possible ou impossible une gageure. Il ne conseille pas de tenter la traversée à partir de Wales, de Mitletukeruk, d’Ikpek, de l’île Sarichef, du cap Espenberg – voire de la pointe Hope ! –, mais évoque les courants puissants à tel ou tel endroit de la côte, les murailles d’icebergs entrevues ici, les failles soupçonnées là. Il ne mentionne pas janvier ou février, plutôt que mars : il dit que chaque année est différente, que la banquise est changeante, que les courants sont variables. Il ne faut pas seulement juger ces réponses comme teintées d’ignorance ou de méfiance, mais aussi comme révélatrices de l’attachement au libre arbitre que manifestent les chasseurs iñupiat, respectueux de mon entreprise. La mise en garde contre la puissance et l’imprévisibilité de tariuq, l’océan, restait implicite dans leurs récits.
Mais revenons-en à Mich. Alors que j’essayais, via la Commission régionale du détroit de Béring, d’obtenir son autorisation d’entrée en Sibérie, il occupait la geôle municipale ! À 6 heures du matin, il avait frappé à la porte de la maisonnette que Clifford avait mise à ma disposition : ivre mort et le visage tuméfié par les coups, il serinait qu’il m’accompagnerait, qu’il soutiendrait ma tentative. Dans le froid cinglant qui devait alors tuer sur le pavé d’Anchorage le frère adoptif de Shirley, je dus ensuite traîner Mich jusqu’à son canapé, avant qu’on ne vînt l’arrêter. La cuite de Mich avait dû être arrangée par les siens qui ne voulaient pas le laisser risquer sa vie avec la mienne. Néanmoins, je me réjouissais encore de sa compagnie, même si je n’osais y croire pour rester psychologiquement apte à réaliser seul mon défi. Quoi qu’il en fût, la difficulté des procédures administratives, en dépit du fait qu’aucun visa n’est requis pour les riverains du détroit, m’interdit de l’emmener. Je perdis ainsi deux jours à tenter de démêler l’écheveau administratif que la municipalité réemmêlait dans mon dos. Rien ne me permet aujourd’hui de rappeler la cohorte de pensées contradictoires qui, jour après jour depuis le cauchemar de décembre dernier où je me vis pour la première fois dérivant sur la glace, m’assaillit au cours des préparatifs. Ne reste maintenant qu’à taire mes angoisses, la peur et le doute, pour me retrouver seul, enfin, face à la sauvage majesté de la banquise.
Sous la neige amoncelée, Elsie Weyiouanna, la mère de Clifford, a retrouvé l’un des gros phoques abattus à l’automne. Deux nuits durant je dors près de sa carcasse qui décongèle sur le sol du bungalow, tandis que son regard translucide rappelle l’effarement de sa mort. Après que Shirley l’a dépecé au moyen d’un ulu, je le traîne au-dehors pour le fendre à la hache. Sur la neige, dans l’air saisissant de froidure, je découpe ensuite l’animal au couteau. Ses viscères souillant la neige autour de moi, je taille sa graisse et sa viande en cubes assez gros pour qu’un chien ne puisse les avaler d’un coup. Je remplis chacun des trente sachets Ziploc, hermétiques et doublés, de trente de ces cubes. Bien qu’il me reste encore des nutriments pour chiens, je récupère aussi des harengs gelés et du saumon séché. Cette nourriture devrait suffire à alimenter mes neuf chiens pendant huit à douze jours, selon l’effort exigé d’eux. Red, pas mon Red d’origine mais celui que j’ai échangé à Brevig Mission, et Fox, qu’un homme m’a donné alors qu’il s’apprêtait à l’abattre, feraient les frais de toute dérive imprévue sur la banquise, au-delà de la dizaine de jours impartis?
Warren Sinnok renforce les lisses du traîneau et en vérifie chaque écrou ; Bessi, sa débrouillarde épouse, attache doublement la ligne de trait, qu’elle a allongée : je veux pouvoir disposer Bill seul en tête, car il m’obéit le mieux. Puis je troque mes excédents de matériel contre deux câbles d’attache pour chiens, avec mes amis Sinnok et, sur leur conseil, acquiers un unaaq. Il s’agit d’un manche de bois au bout duquel est ficelée une pointe métallique longue de 30 centimètres, qui va s’amenuisant. Si, fichée dans la glace, cette pointe ne la perce pas, cela signifie qu’elle est assez épaisse pour permettre le passage.
Vendredi 17 mars. Depuis 5 heures du matin, j’emballe mon attirail. Dans l’air glacial qui fige le moindre souffle, je nourris d’abord les chiens puis charge le traîneau. Emballé dans des sacs plastique, mon duvet vient se loger à sa pointe. Un sac étanche enfermant une tenue grand froid et un duvet, de rechange tous deux, prend place ensuite. L’unaaq, la pelle, la scie à glace, le couteau et mon fusil à pompe se casent de part et d’autre des réserves de nourriture, de toute cette viande de phoque découpée et naturellement congelée. Le matelas-mousse, la tente, d’autres vêtements et même mon ordinateur Powerbook (que je n’ai pas osé expédier en Russie) viennent s’intercaler. Je boucle les sangles du sac de traîneau. L’excitation des chiens est à son comble dès que j’étire la ligne de trait. Et Bessi a toutes les peines du monde à botter mes chiens. Ses doigts, forcément nus, s’engourdissent très vite tandis qu’elle passe une bottine de feutre au-dessus des griffes rétives, et elle n’en retrouve l’usage qu’en les frottant dans l’échine des bêtes. Un à un, j’attelle mes compagnons : Bill et Spice, Buck et Stripe, Red, Fox et Paws, Spooky. Je referme ensuite mon parka : ils savent ce que cette ultime disposition signifie, et jappent d’excitation. À la hâte je serre les mains de Linda, l’enseignante, de Warren, de Clifford et de Shirley, ainsi que d’un ancien de Shishmaref. J’attelle enfin Winner qui, surexcité, attaque déjà la ligne de trait avec ses crocs. Bessi se tient sur l’une des lisses du traîneau, moi sur l’autre. “All right !” : les chiens font sauter de la neige le crochet qui nous retenait. J’esquisse un geste d’adieu à tous les amis rencontrés en deux semaines de séjour ici. Les élèves me saluent depuis leur classe. Je contourne le village, avant de rejoindre le remblai qui renforce la rive du détroit. Bessi saute du traîneau et je m’éloigne plein ouest, seul.
Plus personne n’est en vue. La capuche fourrée que je rabats sur ma tête achève de m’isoler du monde juste quitté. J’espérais qu’une motoneige m’accompagnerait, me ferait la trace sur quelques kilomètres. Rien ! Sans doute le froid, – 45 °C, est-il trop intense pour qu’un moteur démarre. Toute la journée, alors que le soleil incendie la banquise et effiloche lentement sa chape glacée, mon regard embrasse le littoral depuis la montagne Ear, dans mon dos, jusqu’au cap du Prince-de-Galles, sur ma gauche. Un ruban de collines étincelantes là-bas surmonte la ligne irrégulière de la banquise. Dernière vision, qui me rattache au continent dont je m’éloigne. Un immense bonheur m’envahit à l’idée que, pareillement, j’en découvrirai bientôt un autre : l’Asie. Je n’ai aucun doute à ce sujet. Elle est devant, à 160 kilomètres plein ouest. Sus à l’Asie? »
(p. 418-423)
Cap Caution, détroit de la Reine-Charlotte (p. 57-61)
Rivière Swift, bassin de l’Anvik (p. 289-292)
Extrait court


