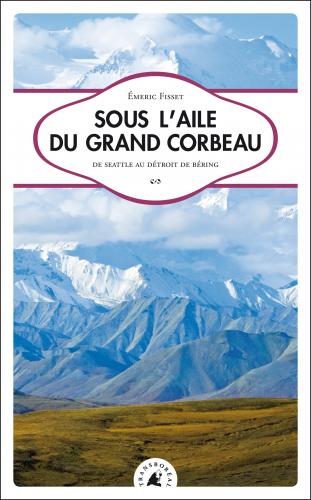
Cap Caution, détroit de la Reine-Charlotte :
« La lumière du phare de la pointe Scarlett a balayé ma nuit blanche. Chaque heure, je me suis réveillé en songeant à l’épreuve inévitable qui m’attend. Son nom sonne étrangement pour moi : Pacifique ! La carte laisse présumer le danger : God’s Pocket, Storm Islands, Cape Caution, Safety Cove. Bien avant l’aube, Allan Tansky, le gardien qui, à 3 heures 40, transmet le premier des sept bulletins quotidiens, m’annonce que la météo est favorable : “Un front de perturbations est prévu pour demain seulement.” Je me lève à 5 heures, l’estomac noué. Vite, je boucle mes sacs étanches. Dans la poche dorsale du gilet de sauvetage, j’enferme une couverture de survie et le saumon fumé que l’épouse d’Allan m’a remis la veille. À droite, mes poches contiennent une boussole et un sachet de fruits secs mêlés de Granola. À gauche, un chapeau, un bandeau pour la tête, des mitaines, un couteau, des allumettes et un sifflet. La jupe du kayak, qui enserre ma taille, contient en outre une lampe frontale, deux fusées de détresse et de quoi allumer rapidement un feu. En cas de chavirage et de perte de l’embarcation, cet équipement serait ma seule chance de survie avec le chandail que je porte sous la combinaison.
À 6 heures 30, je glisse avec le jour hors de l’anse du phare. Le ciel est couvert et la marée juste descendante. Le vent de sud-est malmène le drapeau canadien. Sitôt passés les rochers où s’accrochent les bâtiments rouge et blanc, sitôt tu le ronflement de leur générateur, s’ouvre la perspective des eaux froides et hostiles. À bâbord, les deux îles Pine et Redfern cassent encore la houle du Pacifique. Exiguës, elles encadrent l’îlot dit Herbert, devant mon étrave. D’abord simple rocher à 6 kilomètres, il profile lentement sa station météo automatisée. La houle n’est encore que de 2 mètres et déjà les lames explosent en cathédrales d’écume sur les récifs épars. J’entends parfois leurs orgues frémissantes et j’envie alors les quatre goélands qui dérivent sans crainte sur l’une de ces grumes flottantes qui sont ma terreur. Elles ponctuent ma progression avec les chevelures gominées des algues. J’entame un rosaire en dépassant l’île Herbert : au loin, à 12 kilomètres, se dessine la côte bleutée où je devine le débouché du chenal Slingsby. Au mois d’août 1792, c’est dans un de ces chenaux que le Discovery s’échoua le temps du reflux. Aussi son commandant, George Vancouver, baptisa-t-il Caution (“prudence” en anglais) ce cap de tous les dangers. Depuis, ses eaux suscitent l’effroi. J’évite de songer à la distance qui me sépare de lui, à peine discernable sur l’horizon. Surtout, ne pas prêter attention au tangage. Ne pas considérer cette houle qui soulève le kayak et me retourne le cœur. Garder des forces pour combattre les vagues. Rester calme : la journée promet d’être longue avec 60 kilomètres de côtes exposées aux sautes d’humeur du Pacifique. En rejoignant la frange littorale de Queen Charlotte Sound, je pagaie devant un remorqueur dont je parviens à déchiffrer le nom, Samson. Je le perds de vue malgré sa barge de conteneurs 800 mètres à la traîne, dans cette houle de plus en plus creusée. Un senneur, qui gagne sans doute Prince Rupert, disparaît lui aussi, antennes et mât inclus. Je tourne fortuitement la tête, alors que je prends appui avec la pagaie dans quelques moutons pour me maintenir en équilibre : à 10 mètres à peine, le bleu ferry-boat d’Alaska fonce droit sur moi ! Il ne peut pas me voir. Je m’écarte de sa route à grandes brassées. Filant à 20 nœuds, l’express côtier me frôle dans un bouillonnement furieux. Des passagers sur le pont m’ont aperçu, vers qui j’esquisse un salut. Au même moment se profile au loin la masse blanche du bâtiment des BC Ferries qui, comme chaque semaine, rejoint Port Hardy.
Pendant combien de secondes un néophyte réussirait-il à se maintenir dans une telle furie ! Et dire que je l’étais encore il y a trois semaines ! Je n’ai rien avalé ni bu au matin, et je suis incapable de sortir le moindre raisin sec de ma poche. Pourvu que je ne faiblisse pas ! Une barre de rouleaux rend inabordables les vastes plages avant le cap. Il faut poursuivre. Encore. Et la tension est telle, en ces instants, que je fonds en larmes dès que j’ai doublé la balise blanche à capteurs solaires. L’île Egg, au large, présente un phare habité. Il doit être midi. J’aimerais connaître l’heure exacte : la marée m’a aidé à sortir du détroit et je compte sur sa bascule, par-delà le cap, pour qu’elle m’emporte plein nord. Mais, né sans montre, je le suis resté ! À Paris, je suis même devenu champion dans l’art de voler l’heure. Et, si j’en fais l’effort, je peux garder la conscience du temps à dix minutes près. Aujourd’hui cependant, plus le moindre repère : la situation est trop exceptionnelle. Le Caméscope, seule horloge disponible à bord, est dans le cockpit : pas question de l’en extraire, dans de tels remous. Sur ma gauche, à quelque distance, je devine un objet longiligne. Orangé, gonflé, ballotté par la houle? Je m’inquiète : et s’il s’agissait d’un noyé ? Je dois m’en assurer. Mais comment me maintenir à sa hauteur ? Comment le remorquer jusqu’au rivage ? Le sang afflue à mes tempes, mon pouls s’accélère. L’objet se précise enfin : ce n’est qu’une tenue molletonnée de pêcheur, ni pieds ni mains n’en dépassent. Je m’éloigne vivement. Au soir, j’apprendrai qu’un chalutier de 13 mètres a coulé au large de l’île Pine et que le bulletin du phare de l’île Egg était : ciel couvert, visibilité de 7 milles, vent de sud-est de 35 km/h avec rafales de 60, vagues de 1,50 mètre, houle de 2 à 4 mètres?
Je dois poursuivre, alors que la mer, dirait-on, éclate en sanglots autour de moi. Garder à chaque instant, grâce au gouvernail que j’actionne avec le palonnier, le meilleur angle d’attaque contre les lames. Prendre appui sur celles qui s’acharnent contre moi. Je ne suis pas même effrayé. Anesthésié plutôt, quoique vigilant. Pas un phoque, pas un pygargue, pas un cormoran. Plus de goélands. Je suis seul, totalement seul, dans ce qu’un novice qualifierait de tempête. Je songe à Gérard d’Aboville et à mes amis qui ont affronté l’océan, à certaines photos du détroit de Magellan où la mer, tourmentée, frémissante, n’a plus rien d’une plaine. Mon étrave s’enveloppe de paquets d’écume qui balaient le pont avant et bondissent jusqu’à mes lèvres desséchées : des milliards de litres d’eau autour de moi, 3 litres d’eau douce derrière mon siège, mais rien à boire ! Le brouillard commence à tomber. De loin en loin, je crois entendre la trompe du phare invisible. Je sors la boussole. En vain : la houle plaque l’aiguille aimantée contre le cadran. Une vaste trouée entre l’île Calvert et la côte échancrée de fjords et de baies devrait se présenter au nord. Emporté par le flux, je m’engouffre dans Smith Sound, de sinistre réputation aussi, avant de comprendre ma méprise.
De nouvelles déferlantes ourlent les rochers Dugout d’une crinière longue de plusieurs centaines de mètres. En dépit du danger, le contraste de l’écume et des eaux smaragdines me fascine, comme me fascine l’envolée des embruns. Parfois, une bourrasque soulève la pelle émergée de ma pagaie double, menaçant de l’arracher ou de me déséquilibrer. Au rythme lent de la poussée de mes bras défilent sur la rive les genévriers et les sapins rabougris. Sans hésitation, je traverse le débouché de Rivers Inlet. Au-devant, avec son cap, l’île Calvert et ses masses montagneuses épargnent à Fitz Hugh Sound les humeurs de l’océan. Je surfe sur les vagues, vers cette simple baie vaste comme la Gironde. À bâbord, en cette fin d’après-midi, je devine Safety Cove où, à l’été 1792, George Vancouver abrita ses vaisseaux, tandis que ses lieutenants achevaient au nord leur exploration en chaloupe. J’aperçois enfin le phare de l’île Addenbroke, à l’est de la baie, et pique droit sur lui. Qu’importe l’éloignement du rivage ? Que peut-il vous arriver quand vous avez échappé aux battures du cap Caution ?
Les deux gardiens du phare viennent à ma rencontre. Nous hissons le kayak jusqu’au ponton où un palan finit de rouiller. J’ai le plus grand mal à marcher. Douze heures durant, je suis resté assis, les pieds rivés au palonnier ; douze heures durant, j’ai pagayé sans le moindre répit, sans manger ni boire. Et grâce au vent et aux marées, j’ai couvert l’incroyable distance de 85 kilomètres ! Mais au mal de mer succède la nausée. Tout remue sous mes pieds tandis qu’une douleur lancinante me brûle le bras gauche. Après l’épreuve du détroit de la Reine-Charlotte, rien ne saurait être pareil : elle a valeur d’initiation. Toujours je comparerai les intempéries et les éléments rencontrés à ceux que j’ai affrontés ce jour-là. Je suis enfin entré dans mon voyage. »
Rivière Swift, bassin de l’Anvik (p. 289-292)
Shishmaref, île Sarichef (p. 418-423)
Extrait court
« La lumière du phare de la pointe Scarlett a balayé ma nuit blanche. Chaque heure, je me suis réveillé en songeant à l’épreuve inévitable qui m’attend. Son nom sonne étrangement pour moi : Pacifique ! La carte laisse présumer le danger : God’s Pocket, Storm Islands, Cape Caution, Safety Cove. Bien avant l’aube, Allan Tansky, le gardien qui, à 3 heures 40, transmet le premier des sept bulletins quotidiens, m’annonce que la météo est favorable : “Un front de perturbations est prévu pour demain seulement.” Je me lève à 5 heures, l’estomac noué. Vite, je boucle mes sacs étanches. Dans la poche dorsale du gilet de sauvetage, j’enferme une couverture de survie et le saumon fumé que l’épouse d’Allan m’a remis la veille. À droite, mes poches contiennent une boussole et un sachet de fruits secs mêlés de Granola. À gauche, un chapeau, un bandeau pour la tête, des mitaines, un couteau, des allumettes et un sifflet. La jupe du kayak, qui enserre ma taille, contient en outre une lampe frontale, deux fusées de détresse et de quoi allumer rapidement un feu. En cas de chavirage et de perte de l’embarcation, cet équipement serait ma seule chance de survie avec le chandail que je porte sous la combinaison.
À 6 heures 30, je glisse avec le jour hors de l’anse du phare. Le ciel est couvert et la marée juste descendante. Le vent de sud-est malmène le drapeau canadien. Sitôt passés les rochers où s’accrochent les bâtiments rouge et blanc, sitôt tu le ronflement de leur générateur, s’ouvre la perspective des eaux froides et hostiles. À bâbord, les deux îles Pine et Redfern cassent encore la houle du Pacifique. Exiguës, elles encadrent l’îlot dit Herbert, devant mon étrave. D’abord simple rocher à 6 kilomètres, il profile lentement sa station météo automatisée. La houle n’est encore que de 2 mètres et déjà les lames explosent en cathédrales d’écume sur les récifs épars. J’entends parfois leurs orgues frémissantes et j’envie alors les quatre goélands qui dérivent sans crainte sur l’une de ces grumes flottantes qui sont ma terreur. Elles ponctuent ma progression avec les chevelures gominées des algues. J’entame un rosaire en dépassant l’île Herbert : au loin, à 12 kilomètres, se dessine la côte bleutée où je devine le débouché du chenal Slingsby. Au mois d’août 1792, c’est dans un de ces chenaux que le Discovery s’échoua le temps du reflux. Aussi son commandant, George Vancouver, baptisa-t-il Caution (“prudence” en anglais) ce cap de tous les dangers. Depuis, ses eaux suscitent l’effroi. J’évite de songer à la distance qui me sépare de lui, à peine discernable sur l’horizon. Surtout, ne pas prêter attention au tangage. Ne pas considérer cette houle qui soulève le kayak et me retourne le cœur. Garder des forces pour combattre les vagues. Rester calme : la journée promet d’être longue avec 60 kilomètres de côtes exposées aux sautes d’humeur du Pacifique. En rejoignant la frange littorale de Queen Charlotte Sound, je pagaie devant un remorqueur dont je parviens à déchiffrer le nom, Samson. Je le perds de vue malgré sa barge de conteneurs 800 mètres à la traîne, dans cette houle de plus en plus creusée. Un senneur, qui gagne sans doute Prince Rupert, disparaît lui aussi, antennes et mât inclus. Je tourne fortuitement la tête, alors que je prends appui avec la pagaie dans quelques moutons pour me maintenir en équilibre : à 10 mètres à peine, le bleu ferry-boat d’Alaska fonce droit sur moi ! Il ne peut pas me voir. Je m’écarte de sa route à grandes brassées. Filant à 20 nœuds, l’express côtier me frôle dans un bouillonnement furieux. Des passagers sur le pont m’ont aperçu, vers qui j’esquisse un salut. Au même moment se profile au loin la masse blanche du bâtiment des BC Ferries qui, comme chaque semaine, rejoint Port Hardy.
Pendant combien de secondes un néophyte réussirait-il à se maintenir dans une telle furie ! Et dire que je l’étais encore il y a trois semaines ! Je n’ai rien avalé ni bu au matin, et je suis incapable de sortir le moindre raisin sec de ma poche. Pourvu que je ne faiblisse pas ! Une barre de rouleaux rend inabordables les vastes plages avant le cap. Il faut poursuivre. Encore. Et la tension est telle, en ces instants, que je fonds en larmes dès que j’ai doublé la balise blanche à capteurs solaires. L’île Egg, au large, présente un phare habité. Il doit être midi. J’aimerais connaître l’heure exacte : la marée m’a aidé à sortir du détroit et je compte sur sa bascule, par-delà le cap, pour qu’elle m’emporte plein nord. Mais, né sans montre, je le suis resté ! À Paris, je suis même devenu champion dans l’art de voler l’heure. Et, si j’en fais l’effort, je peux garder la conscience du temps à dix minutes près. Aujourd’hui cependant, plus le moindre repère : la situation est trop exceptionnelle. Le Caméscope, seule horloge disponible à bord, est dans le cockpit : pas question de l’en extraire, dans de tels remous. Sur ma gauche, à quelque distance, je devine un objet longiligne. Orangé, gonflé, ballotté par la houle? Je m’inquiète : et s’il s’agissait d’un noyé ? Je dois m’en assurer. Mais comment me maintenir à sa hauteur ? Comment le remorquer jusqu’au rivage ? Le sang afflue à mes tempes, mon pouls s’accélère. L’objet se précise enfin : ce n’est qu’une tenue molletonnée de pêcheur, ni pieds ni mains n’en dépassent. Je m’éloigne vivement. Au soir, j’apprendrai qu’un chalutier de 13 mètres a coulé au large de l’île Pine et que le bulletin du phare de l’île Egg était : ciel couvert, visibilité de 7 milles, vent de sud-est de 35 km/h avec rafales de 60, vagues de 1,50 mètre, houle de 2 à 4 mètres?
Je dois poursuivre, alors que la mer, dirait-on, éclate en sanglots autour de moi. Garder à chaque instant, grâce au gouvernail que j’actionne avec le palonnier, le meilleur angle d’attaque contre les lames. Prendre appui sur celles qui s’acharnent contre moi. Je ne suis pas même effrayé. Anesthésié plutôt, quoique vigilant. Pas un phoque, pas un pygargue, pas un cormoran. Plus de goélands. Je suis seul, totalement seul, dans ce qu’un novice qualifierait de tempête. Je songe à Gérard d’Aboville et à mes amis qui ont affronté l’océan, à certaines photos du détroit de Magellan où la mer, tourmentée, frémissante, n’a plus rien d’une plaine. Mon étrave s’enveloppe de paquets d’écume qui balaient le pont avant et bondissent jusqu’à mes lèvres desséchées : des milliards de litres d’eau autour de moi, 3 litres d’eau douce derrière mon siège, mais rien à boire ! Le brouillard commence à tomber. De loin en loin, je crois entendre la trompe du phare invisible. Je sors la boussole. En vain : la houle plaque l’aiguille aimantée contre le cadran. Une vaste trouée entre l’île Calvert et la côte échancrée de fjords et de baies devrait se présenter au nord. Emporté par le flux, je m’engouffre dans Smith Sound, de sinistre réputation aussi, avant de comprendre ma méprise.
De nouvelles déferlantes ourlent les rochers Dugout d’une crinière longue de plusieurs centaines de mètres. En dépit du danger, le contraste de l’écume et des eaux smaragdines me fascine, comme me fascine l’envolée des embruns. Parfois, une bourrasque soulève la pelle émergée de ma pagaie double, menaçant de l’arracher ou de me déséquilibrer. Au rythme lent de la poussée de mes bras défilent sur la rive les genévriers et les sapins rabougris. Sans hésitation, je traverse le débouché de Rivers Inlet. Au-devant, avec son cap, l’île Calvert et ses masses montagneuses épargnent à Fitz Hugh Sound les humeurs de l’océan. Je surfe sur les vagues, vers cette simple baie vaste comme la Gironde. À bâbord, en cette fin d’après-midi, je devine Safety Cove où, à l’été 1792, George Vancouver abrita ses vaisseaux, tandis que ses lieutenants achevaient au nord leur exploration en chaloupe. J’aperçois enfin le phare de l’île Addenbroke, à l’est de la baie, et pique droit sur lui. Qu’importe l’éloignement du rivage ? Que peut-il vous arriver quand vous avez échappé aux battures du cap Caution ?
Les deux gardiens du phare viennent à ma rencontre. Nous hissons le kayak jusqu’au ponton où un palan finit de rouiller. J’ai le plus grand mal à marcher. Douze heures durant, je suis resté assis, les pieds rivés au palonnier ; douze heures durant, j’ai pagayé sans le moindre répit, sans manger ni boire. Et grâce au vent et aux marées, j’ai couvert l’incroyable distance de 85 kilomètres ! Mais au mal de mer succède la nausée. Tout remue sous mes pieds tandis qu’une douleur lancinante me brûle le bras gauche. Après l’épreuve du détroit de la Reine-Charlotte, rien ne saurait être pareil : elle a valeur d’initiation. Toujours je comparerai les intempéries et les éléments rencontrés à ceux que j’ai affrontés ce jour-là. Je suis enfin entré dans mon voyage. »
(p. 57-61)
Rivière Swift, bassin de l’Anvik (p. 289-292)
Shishmaref, île Sarichef (p. 418-423)
Extrait court


