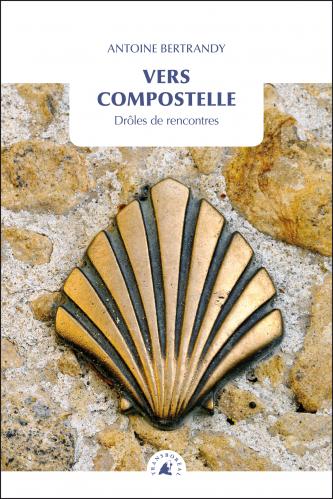
Le lâcher-prise :
« Les jours défilent, l’entraînement porte ses fruits et j’atteins enfin le bout de la Meseta. Elle aussi est venue à bout de moi. Il est temps enfin de regarder au-devant, d’envisager lucidement mes difficultés et, surtout, d’agir pour que les problèmes que je rencontre disparaissent pour de bon et cesser de maudire les obstacles qui se dressent au-dedans de moi. Agir pour enfin les franchir et écarter les barreaux de la peur.
Jusqu’à présent, j’ai tout calculé. Les distances parcourues, ma vitesse et le temps passé sur la route. C’est plus qu’un réflexe, c’est une manière d’anticiper le Chemin. Aujourd’hui, j’ai franchi telle distance ; demain, j’essaierai d’atteindre tel village ; comme cela, après-demain, je ferai halte dans celui-ci et, si tout se déroule bien, dans trois jours, je pourrai passer la nuit dans cette auberge, qui m’a été chaudement recommandée. Et, j’en suis convaincu, la majorité des marcheurs fait de même. Presque tout le monde a, à portée de main, un plan du chemin et une liste des refuges. Avec ça, rien ne peut nous arriver. Nous savons par avance où, chaque soir, nous dormirons et ne laissons que peu de place à l’imprévu. Que se passerait-il si nous nous perdions, si nous ne trouvions pas d’hébergement ? Il faudrait demander de l’aide à des inconnus? Trop effrayant ! Pour nous rassurer, nous serrons fort contre nous nos guides, les manuels de notre enfermement. Et nous vérifions deux fois plutôt qu’une que notre portefeuille bien garni est toujours à sa place. C’est la peur de nous perdre et la peur de dépendre de l’aide d’autrui. Le chemin de Compostelle, c’est aussi cela : une marche au long cours de laquelle on aurait soustrait l’incertitude et le risque, les ingrédients de l’aventure. Tout est finalement assez confortable et je ne suis pas le dernier à me vautrer dans des habitudes routinières, ces sages rituels reproduits quotidiennement par chaque pèlerin : j’arrive désormais tôt dans les refuges afin de laisser le temps à ma lessive de sécher au vent ; je considère désormais comme normal de ne payer que 9 euros pour un repas complet et 5 euros pour un lit et une douche chaude ; je fais le coq en racontant que je marche 30, 35 ou 40 kilomètres par jour. Ces rituels sont bien excusables, après tout, c’est cela aussi être un pèlerin moderne : c’est avoir peur que son slip ne soit pas sec quand on l’enfile le matin. À chaque époque ses dangers. En tout cas, ces usages m’exaspèrent moins pour eux-mêmes que pour la facilité avec laquelle je les adopte.
Les journées sont réglées comme du papier à musique et, faute de peur et de danger, elles en deviennent prévisibles. Les flèches jaunes sont un fil d’Ariane et mon chemin ressemble tantôt à un couloir infini, tantôt à un tapis roulant. La sécurité est partout. Quand on se perd, il y a toujours une bonne âme pour nous remettre sur la route ; impossible en cette saison de ne pas trouver un endroit où dormir ; impossible de rencontrer de réelles difficultés et, par conséquent, il est inutile de faire appel à ses ressources profondes. Tout est organisé pour se protéger, pour entretenir la gentille marche “ronronnante” des pèlerins. Je m’en rends compte désormais, c’est pour la majorité d’entre nous, victimes de rien d’autre que de la lancinante épreuve des ampoules aux pieds, l’aventure de patachons.
Comment nous comparer aux pèlerins du Moyen Âge avec nos vêtements “techniques”, nos chaussures souples et légères, nos connexions permanentes et nos ressources illimitées ? Je voudrais n’avoir plus comme richesse que mes pieds mais je conserve précieusement dans ma poche quelques billets, mon topoguide et ma carte Visa. Ce confort me pèse et j’en viens à regretter de ne pas avoir emporté de tente. Tout est réglé parfaitement et les habitudes de confort m’enferment. J’aspire à sortir des sentiers battus, loin de cette formalisation, mais je ne me sens pas encore prêt à me dépouiller de tout. D’ailleurs, le Chemin ne s’y prête pas. Comment serait en effet reçu par les Espagnols un marcheur qui viendrait leur mendier du pain et un endroit où dormir alors que nous sommes bien souvent l’unique carburant de l’économie des villages exsangues que nous traversons ? Je ne trouve rien d’autre à faire que d’abandonner dans l’auberge de Mansilla mes plans et guides. Au moins arrêterai-je de calculer la longueur de mes étapes et de m’enfermer dans un programme préétabli. C’est mon premier pas vers la perte de contrôle. »
Même les Bavarois peuvent être généreux (p. 127-130)
Au fond du trou, la lumière (p. 204-207)
Extrait court
« Les jours défilent, l’entraînement porte ses fruits et j’atteins enfin le bout de la Meseta. Elle aussi est venue à bout de moi. Il est temps enfin de regarder au-devant, d’envisager lucidement mes difficultés et, surtout, d’agir pour que les problèmes que je rencontre disparaissent pour de bon et cesser de maudire les obstacles qui se dressent au-dedans de moi. Agir pour enfin les franchir et écarter les barreaux de la peur.
Jusqu’à présent, j’ai tout calculé. Les distances parcourues, ma vitesse et le temps passé sur la route. C’est plus qu’un réflexe, c’est une manière d’anticiper le Chemin. Aujourd’hui, j’ai franchi telle distance ; demain, j’essaierai d’atteindre tel village ; comme cela, après-demain, je ferai halte dans celui-ci et, si tout se déroule bien, dans trois jours, je pourrai passer la nuit dans cette auberge, qui m’a été chaudement recommandée. Et, j’en suis convaincu, la majorité des marcheurs fait de même. Presque tout le monde a, à portée de main, un plan du chemin et une liste des refuges. Avec ça, rien ne peut nous arriver. Nous savons par avance où, chaque soir, nous dormirons et ne laissons que peu de place à l’imprévu. Que se passerait-il si nous nous perdions, si nous ne trouvions pas d’hébergement ? Il faudrait demander de l’aide à des inconnus? Trop effrayant ! Pour nous rassurer, nous serrons fort contre nous nos guides, les manuels de notre enfermement. Et nous vérifions deux fois plutôt qu’une que notre portefeuille bien garni est toujours à sa place. C’est la peur de nous perdre et la peur de dépendre de l’aide d’autrui. Le chemin de Compostelle, c’est aussi cela : une marche au long cours de laquelle on aurait soustrait l’incertitude et le risque, les ingrédients de l’aventure. Tout est finalement assez confortable et je ne suis pas le dernier à me vautrer dans des habitudes routinières, ces sages rituels reproduits quotidiennement par chaque pèlerin : j’arrive désormais tôt dans les refuges afin de laisser le temps à ma lessive de sécher au vent ; je considère désormais comme normal de ne payer que 9 euros pour un repas complet et 5 euros pour un lit et une douche chaude ; je fais le coq en racontant que je marche 30, 35 ou 40 kilomètres par jour. Ces rituels sont bien excusables, après tout, c’est cela aussi être un pèlerin moderne : c’est avoir peur que son slip ne soit pas sec quand on l’enfile le matin. À chaque époque ses dangers. En tout cas, ces usages m’exaspèrent moins pour eux-mêmes que pour la facilité avec laquelle je les adopte.
Les journées sont réglées comme du papier à musique et, faute de peur et de danger, elles en deviennent prévisibles. Les flèches jaunes sont un fil d’Ariane et mon chemin ressemble tantôt à un couloir infini, tantôt à un tapis roulant. La sécurité est partout. Quand on se perd, il y a toujours une bonne âme pour nous remettre sur la route ; impossible en cette saison de ne pas trouver un endroit où dormir ; impossible de rencontrer de réelles difficultés et, par conséquent, il est inutile de faire appel à ses ressources profondes. Tout est organisé pour se protéger, pour entretenir la gentille marche “ronronnante” des pèlerins. Je m’en rends compte désormais, c’est pour la majorité d’entre nous, victimes de rien d’autre que de la lancinante épreuve des ampoules aux pieds, l’aventure de patachons.
Comment nous comparer aux pèlerins du Moyen Âge avec nos vêtements “techniques”, nos chaussures souples et légères, nos connexions permanentes et nos ressources illimitées ? Je voudrais n’avoir plus comme richesse que mes pieds mais je conserve précieusement dans ma poche quelques billets, mon topoguide et ma carte Visa. Ce confort me pèse et j’en viens à regretter de ne pas avoir emporté de tente. Tout est réglé parfaitement et les habitudes de confort m’enferment. J’aspire à sortir des sentiers battus, loin de cette formalisation, mais je ne me sens pas encore prêt à me dépouiller de tout. D’ailleurs, le Chemin ne s’y prête pas. Comment serait en effet reçu par les Espagnols un marcheur qui viendrait leur mendier du pain et un endroit où dormir alors que nous sommes bien souvent l’unique carburant de l’économie des villages exsangues que nous traversons ? Je ne trouve rien d’autre à faire que d’abandonner dans l’auberge de Mansilla mes plans et guides. Au moins arrêterai-je de calculer la longueur de mes étapes et de m’enfermer dans un programme préétabli. C’est mon premier pas vers la perte de contrôle. »
(p. 209-212)
Même les Bavarois peuvent être généreux (p. 127-130)
Au fond du trou, la lumière (p. 204-207)
Extrait court


