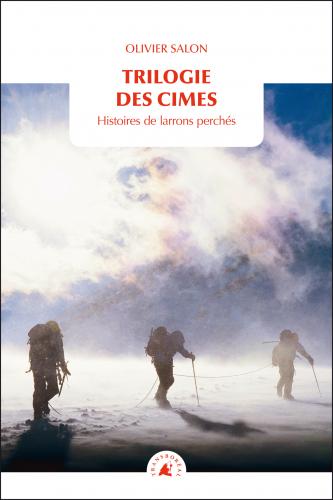
Midi-Plan :
« La peur nous a coupé la faim. Nous n’avons pas encore grignoté quoi que ce soit, mais nous attendons le moment propice pour le faire. Le moment propice, c’est le moment où nous serons sûrs de nous retrouver sur la terre ferme, sur le chemin sûr du retour, le moment où le risque aura disparu. Ce moment semble encore bien loin. Et puis, il y aura ce soir l’excellent dîner amical. Elle regarde sa montre. L’heure tourne sans que nous nous en apercevions. Déjà 15 heures ! Nos recherches, nos manœuvres de cordes, notre inquiétude mangent le temps.
Je n’ai plus d’anneau sur mon baudrier et je place maintenant, aux endroits judicieux, lors de la succession de nos courts rappels, des mousquetons. Je les laisse bien volontiers, abandonnant toutefois les mousquetons les plus vieux, ceux pour lesquels j’ai le moins d’estime. Chaque alpiniste est attaché à son matériel. Il est des mousquetons qui nous plaisent parce qu’ils sont beaux, d’autres ont un bruit de fermeture idéal, un petit claquement sec, comme celui des bons briquets. Je me souviens de cette ouvrière travaillant dans une chaîne de fabrication de briquets de luxe, et dont la fonction était de tester, à l’ouïe, le juste claquement lors de la fermeture de l’objet. Les briquets trop mous, trop ternes, trop lents étaient misérablement abandonnés, repartant sans doute pour une distribution dans un circuit parallèle. C’est aussi comme cela qu’on reconnaît les grandes voitures : le luxe véritable, c’est le son délicat, comme provenant d’une percussion musicale, de la fermeture de la portière. Un claquement peu sonore, bien sec, surtout pas bruyant ni agressif. Il en va de même pour les mousquetons. J’abandonne ainsi plusieurs mousquetons dont l’ouverture n’est pas souple ou précise. Mousquetons, attention à la fermeture automatique de vos doigts : en cas de doute, vous risquez l’abandon pur et simple sur une paroi bien peu fréquentée et ce sera la fin probable de votre carrière.
À force de délaisser mon matériel sur la paroi, nous perdons de l’altitude. C’est un peu comme si nous étions en montgolfière, sauf que c’est exactement le contraire. Finalement, une longue fissure dégoulinante nous ramène au glacier, dont la neige ne vient pas buter sur le rocher, mais s’en écarte, laissant un bon vide. Au bout de la corde, un petit saut et j’atterris enfin. La neige s’effondre immédiatement sous mon poids. C’est le retour à la réalité. Je patauge, parviens à me rassembler, à me ficher dans le sol et ma commère me rejoint.
Avec le retour à la neige revient l’inquiétude. À l’assaut qu’elle revient, l’inquiétude. Au pas de charge. Nous faisons le point. Juste en dessous de nous, reste à franchir un mur de neige toujours molle, mur vilainement troué mais qui semble bien daigner laisser par endroits place à une frêle cordée déjà bien secouée. Si elle se tient bien, si elle sait trouver l’itinéraire. Si elle n’est pas trop lourde. Si, si, si? Que de si pour nous ! Et puis le mur est fort raide. Beaucoup plus raide que plus haut. Quand nous aurons passé ce mur, nous verrons bien ce que nous verrons, car nous ne pouvons jamais voir la suite de notre itinéraire et nous rassurer. Notre course semble être une succession d’épreuves qu’il faut réussir les unes après les autres, sans connaissance aucune de celles qui nous attendent au-delà. C’est de cela que se nourrit notre inquiétude. J’essaie de conserver mon anxiété pour moi. Je songe à la folle équipée d’Eric Newby, grand aventurier britannique du début du XXe siècle ; lorsqu’il se lance avec un ami à l’assaut de l’Hindu Kush, une chaîne haute de 6 000 mètres dans ce qui est maintenant l’Afghanistan, aucun des deux compères n’entend avouer à l’autre que sa connaissance de la haute montagne est quasiment nulle.
Mais il est sûr que nous songeons et l’un et l’autre à ces béances monstrueuses qui nous entourent et ne demandent qu’à nous engouffrer, comme des chimères qu’il conviendrait de nourrir, comme le Minotaure dans son dédale et qui attend son dû annuel de jeunes filles et jeunes gens. Cela nous glace justement. L’idée de tomber dans un trou mine notre cheminement sur le glacier. Les conditions sont vraiment mauvaises : il a beaucoup neigé ces derniers temps et, même si le manteau s’est stabilisé quelque peu, il n’y a aucune trace pour nous aider. Nous devons trouver par nous-mêmes un juste itinéraire. Or les ponts de neige sont nombreux, les trous fréquents, les pièges innombrables.
Nous commençons alors notre prudente descente. Pour tester, mon équipière s’ancre tant qu’elle se peut dans la soupe, prête à me retenir. Aucun des deux ne sait si cela serait possible. Je marche sur des œufs. Des œufs en neige, naturellement. Je teste chaque pas et nous finissons par trouver un rythme d’avancée, bien lent certes. Nous effectuons de belles circonvolutions, des arabesques dans la pente, tournant, virevoltant, bombinant autour des pesanteurs cruelles. De temps à autre, l’un de nous laisse une jambe vivement s’enfoncer jusqu’au genou. On étouffe un cri, l’autre s’arc-boute et l’effroi augmente.
De temps à autre, un crampon se détache de la chaussure, on dirait que cette balade ne lui dit rien qui vaille. Mais on a beau le remettre en place et serrer les lanières au plus fort, il se détachera de nouveau, ajoutant de l’inquiétude à notre inquiétude. Nos crampons, il est vrai, ne sont de prime jeunesse : ils ont fait du chemin. Le système d’accroche est vieux, il faut faire le tour de la chaussure à la lanière, et plusieurs fois, et cette sangle peu à peu se détend, en dépit de mes objurgations itérées et de mes jurons intérieurs. Et surtout, nos crampons n’ont pas d’anti-bottes, et ça, c’est une grossière erreur dans un terrain pareil ! Les crampons de maintenant sont pourvus d’une simple lame de plastique sous le cadre métallique, qui empêche la neige de s’y coller. Or précisément, nous sommes seuls sur ce glacier infernal, et toute la neige qui n’a pas pu se coller depuis des semaines sous les crampons modernes des alpinistes bien équipés en profite (assez lâchement) pour faire des mottes énormes à chacun de nos pas, heureuse de pouvoir enfin adhérer à du matériel ancien. Si bien qu’il suffit qu’on ne les dégage pas suffisamment (en frappant la chaussure d’un coup sec de piolet à chaque pas) pour risquer de trébucher au pas suivant. Nous sommes peu de chose, et nous vivons à chaque instant la précarité de notre état. »
Huascarán (p. 60-63)
El Capitan (p. 114-115)
Extrait court
« La peur nous a coupé la faim. Nous n’avons pas encore grignoté quoi que ce soit, mais nous attendons le moment propice pour le faire. Le moment propice, c’est le moment où nous serons sûrs de nous retrouver sur la terre ferme, sur le chemin sûr du retour, le moment où le risque aura disparu. Ce moment semble encore bien loin. Et puis, il y aura ce soir l’excellent dîner amical. Elle regarde sa montre. L’heure tourne sans que nous nous en apercevions. Déjà 15 heures ! Nos recherches, nos manœuvres de cordes, notre inquiétude mangent le temps.
Je n’ai plus d’anneau sur mon baudrier et je place maintenant, aux endroits judicieux, lors de la succession de nos courts rappels, des mousquetons. Je les laisse bien volontiers, abandonnant toutefois les mousquetons les plus vieux, ceux pour lesquels j’ai le moins d’estime. Chaque alpiniste est attaché à son matériel. Il est des mousquetons qui nous plaisent parce qu’ils sont beaux, d’autres ont un bruit de fermeture idéal, un petit claquement sec, comme celui des bons briquets. Je me souviens de cette ouvrière travaillant dans une chaîne de fabrication de briquets de luxe, et dont la fonction était de tester, à l’ouïe, le juste claquement lors de la fermeture de l’objet. Les briquets trop mous, trop ternes, trop lents étaient misérablement abandonnés, repartant sans doute pour une distribution dans un circuit parallèle. C’est aussi comme cela qu’on reconnaît les grandes voitures : le luxe véritable, c’est le son délicat, comme provenant d’une percussion musicale, de la fermeture de la portière. Un claquement peu sonore, bien sec, surtout pas bruyant ni agressif. Il en va de même pour les mousquetons. J’abandonne ainsi plusieurs mousquetons dont l’ouverture n’est pas souple ou précise. Mousquetons, attention à la fermeture automatique de vos doigts : en cas de doute, vous risquez l’abandon pur et simple sur une paroi bien peu fréquentée et ce sera la fin probable de votre carrière.
À force de délaisser mon matériel sur la paroi, nous perdons de l’altitude. C’est un peu comme si nous étions en montgolfière, sauf que c’est exactement le contraire. Finalement, une longue fissure dégoulinante nous ramène au glacier, dont la neige ne vient pas buter sur le rocher, mais s’en écarte, laissant un bon vide. Au bout de la corde, un petit saut et j’atterris enfin. La neige s’effondre immédiatement sous mon poids. C’est le retour à la réalité. Je patauge, parviens à me rassembler, à me ficher dans le sol et ma commère me rejoint.
Avec le retour à la neige revient l’inquiétude. À l’assaut qu’elle revient, l’inquiétude. Au pas de charge. Nous faisons le point. Juste en dessous de nous, reste à franchir un mur de neige toujours molle, mur vilainement troué mais qui semble bien daigner laisser par endroits place à une frêle cordée déjà bien secouée. Si elle se tient bien, si elle sait trouver l’itinéraire. Si elle n’est pas trop lourde. Si, si, si? Que de si pour nous ! Et puis le mur est fort raide. Beaucoup plus raide que plus haut. Quand nous aurons passé ce mur, nous verrons bien ce que nous verrons, car nous ne pouvons jamais voir la suite de notre itinéraire et nous rassurer. Notre course semble être une succession d’épreuves qu’il faut réussir les unes après les autres, sans connaissance aucune de celles qui nous attendent au-delà. C’est de cela que se nourrit notre inquiétude. J’essaie de conserver mon anxiété pour moi. Je songe à la folle équipée d’Eric Newby, grand aventurier britannique du début du XXe siècle ; lorsqu’il se lance avec un ami à l’assaut de l’Hindu Kush, une chaîne haute de 6 000 mètres dans ce qui est maintenant l’Afghanistan, aucun des deux compères n’entend avouer à l’autre que sa connaissance de la haute montagne est quasiment nulle.
Mais il est sûr que nous songeons et l’un et l’autre à ces béances monstrueuses qui nous entourent et ne demandent qu’à nous engouffrer, comme des chimères qu’il conviendrait de nourrir, comme le Minotaure dans son dédale et qui attend son dû annuel de jeunes filles et jeunes gens. Cela nous glace justement. L’idée de tomber dans un trou mine notre cheminement sur le glacier. Les conditions sont vraiment mauvaises : il a beaucoup neigé ces derniers temps et, même si le manteau s’est stabilisé quelque peu, il n’y a aucune trace pour nous aider. Nous devons trouver par nous-mêmes un juste itinéraire. Or les ponts de neige sont nombreux, les trous fréquents, les pièges innombrables.
Nous commençons alors notre prudente descente. Pour tester, mon équipière s’ancre tant qu’elle se peut dans la soupe, prête à me retenir. Aucun des deux ne sait si cela serait possible. Je marche sur des œufs. Des œufs en neige, naturellement. Je teste chaque pas et nous finissons par trouver un rythme d’avancée, bien lent certes. Nous effectuons de belles circonvolutions, des arabesques dans la pente, tournant, virevoltant, bombinant autour des pesanteurs cruelles. De temps à autre, l’un de nous laisse une jambe vivement s’enfoncer jusqu’au genou. On étouffe un cri, l’autre s’arc-boute et l’effroi augmente.
De temps à autre, un crampon se détache de la chaussure, on dirait que cette balade ne lui dit rien qui vaille. Mais on a beau le remettre en place et serrer les lanières au plus fort, il se détachera de nouveau, ajoutant de l’inquiétude à notre inquiétude. Nos crampons, il est vrai, ne sont de prime jeunesse : ils ont fait du chemin. Le système d’accroche est vieux, il faut faire le tour de la chaussure à la lanière, et plusieurs fois, et cette sangle peu à peu se détend, en dépit de mes objurgations itérées et de mes jurons intérieurs. Et surtout, nos crampons n’ont pas d’anti-bottes, et ça, c’est une grossière erreur dans un terrain pareil ! Les crampons de maintenant sont pourvus d’une simple lame de plastique sous le cadre métallique, qui empêche la neige de s’y coller. Or précisément, nous sommes seuls sur ce glacier infernal, et toute la neige qui n’a pas pu se coller depuis des semaines sous les crampons modernes des alpinistes bien équipés en profite (assez lâchement) pour faire des mottes énormes à chacun de nos pas, heureuse de pouvoir enfin adhérer à du matériel ancien. Si bien qu’il suffit qu’on ne les dégage pas suffisamment (en frappant la chaussure d’un coup sec de piolet à chaque pas) pour risquer de trébucher au pas suivant. Nous sommes peu de chose, et nous vivons à chaque instant la précarité de notre état. »
(p. 190-194)
Huascarán (p. 60-63)
El Capitan (p. 114-115)
Extrait court


