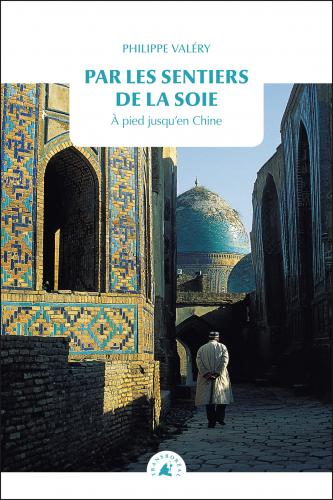
Afghanistan :
« Je marche parfois dans la pente au-dessus du fleuve, sautant de rocher en rocher quand la piste disparaît totalement avant de reprendre plus loin. Le 16 août, je progresse ainsi sur un sol rocailleux à proximité du village de Nichkhaur. Sous les cimes neigeuses des montagnes, des chameaux à poil épais reconstituent leurs bosses paresseuses qui s’affalent sur le côté. Je suis bientôt tiré de ce charme idyllique par un affluent de la rivière Pandj, d’une dizaine de mètres de large. Il n’est guère profond. Je m’attends à ce que l’eau me monte à mi-cuisse mais le fond est encombré de galets et de rochers qui rendent certainement l’équilibre difficile avec un courant très fort. Je le remonte pour trouver un passage plus favorable. C’est très en amont que je me décide à le traverser. J’enlève mes chaussures et les attache à mon sac à dos déjà lourd. J’avance dans l’eau. C’est facile au début. Le courant tourbillonne autour de mes jambes. Ma progression est plus lente. Au milieu du cours d’eau, je suis bloqué par la force du courant et le poids de mon sac. Je ne peux pratiquement plus bouger un pied, ni l’avancer ni le reculer. Ma stabilité est très précaire. Arrive ce qui devait arriver : comme je pose le pied sur une pierre, elle se dérobe. Je tombe sous mon poids. Comme la pierre, je suis emporté. Mes mains en accrochent d’autres, que j’entraîne. Mon sac se gorge d’eau et coule. Je redoute de me cogner la tête contre un rocher. J’ai conscience de dévaler rapidement vers le fleuve furieux à côté duquel mon torrent n’est qu’une plaisanterie. Dans son bouillon, je n’aurai aucune chance d’en réchapper. On pense beaucoup et vite dans ces cas-là. Je refuse de mourir ainsi. Ni mes parents, ni personne ne saura où je suis passé. Je n’ai pas le droit de finir comme cela. Je ne veux pas.
Dans ces circonstances, ce n’est pas toujours la vie qui vous lâche. C’est quelquefois l’homme qui la laisse partir. Confronté avec une certaine ironie à la mort dans un paysage magnifique, sous un soleil radieux, j’offre à la nature le spectacle de mon désastre. Elle me paraît horrible et narquoise en retour mais, moi, je sais bien à quel point je tiens à la vie. Ballotté par le courant, je m’accroche et lutte. Je ne sais guère comment mais je reviens vers le bord. Je respire tout en remarquant que je suis toujours du mauvais côté. J’ai eu très peur quoique je ne m’en sorte qu’avec le mollet qui saigne et quelques ecchymoses. Mes appareils photo sont intacts. Mes chaussures sont toujours bien attachées au sac mais celui-ci pèse maintenant des tonnes. Et il faut recommencer ! Comment vais-je faire ? Et voilà que survient la Providence, sous les traits de Khayam Big. Moustachu, il a un puissant torse de taureau et des jambes musclées de lutteur. Un vrai tank, âgé de 25 ans. Lui aussi veut traverser la rivière mais il en a l’habitude et a plus les qualités pour le faire que moi. J’essore mon maillot et vide un peu d’eau de mon sac. Il le prend sur son dos et nous décidons de traverser. Pour être plus stables, nous nous tenons par la main et, tant bien que mal, nous prenons pied sur l’autre rive. Je me demande comment se débrouillent les enfants et les personnes âgées qui doivent passer ainsi à la fonte des neiges. Bien sûr, c’est leur pays, ils apprennent cela tout jeunes et, bien sûr, ils ont un meilleur équilibre que moi mais, nom de Dieu, comment font-ils ? Khayam Big m’invite à me reposer dans son village, le temps d’un thé. J’étale mes habits, sac de couchage, allumettes et autres affaires mouillées au soleil pour les sécher.
Ma journée de marche – 25 kilomètres – n’est pas épuisante. J’arrive bien avant le coucher du soleil à Sarhad e Wakhan, le dernier village du Wakhan proprement dit. Il est à 200 kilomètres d’Echkachem et à 3 200 mètres d’altitude. Son chef militaire, Hafez Khan, barbe et cheveux châtains, couleur rare chez les adultes, pantalon afghan et veste de combat, est un homme de Massoud. Il est mandaté un peu à la manière d’un préfet chez nous. Son principal travail est de veiller à la sécurité de la frontière avec le Pakistan, mais il règne aussi sur les villageois ismaéliens. Sunnite, il s’est fait aménager un lieu de prière ouvert sur l’extérieur. Les ismaéliens, eux, n’ont pas de “maison de prière” et prient chez eux. Hafez Khan m’héberge et est heureux de m’emmener faire le tour du propriétaire. Il me demande mon avis sur la construction d’un bassin, où afflue une eau chaude à l’odeur soufrée et autour duquel il fait ériger des murs. Ma qualité d’Occidental me confère comme par essence divine le statut d’expert omniscient : médecin, vétérinaire, architecte, ingénieur des ponts et chaussées? Je suis parfois désolé de ne pouvoir honorer la confiance placée en moi. En l’espèce, le regard que je jette sur son ouvrage doit lui paraître approbateur car Hafez Khan me trouve un logement. »
Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie (p. 43-48)
Turkménistan (p. 333-336)
Extrait court
« Je marche parfois dans la pente au-dessus du fleuve, sautant de rocher en rocher quand la piste disparaît totalement avant de reprendre plus loin. Le 16 août, je progresse ainsi sur un sol rocailleux à proximité du village de Nichkhaur. Sous les cimes neigeuses des montagnes, des chameaux à poil épais reconstituent leurs bosses paresseuses qui s’affalent sur le côté. Je suis bientôt tiré de ce charme idyllique par un affluent de la rivière Pandj, d’une dizaine de mètres de large. Il n’est guère profond. Je m’attends à ce que l’eau me monte à mi-cuisse mais le fond est encombré de galets et de rochers qui rendent certainement l’équilibre difficile avec un courant très fort. Je le remonte pour trouver un passage plus favorable. C’est très en amont que je me décide à le traverser. J’enlève mes chaussures et les attache à mon sac à dos déjà lourd. J’avance dans l’eau. C’est facile au début. Le courant tourbillonne autour de mes jambes. Ma progression est plus lente. Au milieu du cours d’eau, je suis bloqué par la force du courant et le poids de mon sac. Je ne peux pratiquement plus bouger un pied, ni l’avancer ni le reculer. Ma stabilité est très précaire. Arrive ce qui devait arriver : comme je pose le pied sur une pierre, elle se dérobe. Je tombe sous mon poids. Comme la pierre, je suis emporté. Mes mains en accrochent d’autres, que j’entraîne. Mon sac se gorge d’eau et coule. Je redoute de me cogner la tête contre un rocher. J’ai conscience de dévaler rapidement vers le fleuve furieux à côté duquel mon torrent n’est qu’une plaisanterie. Dans son bouillon, je n’aurai aucune chance d’en réchapper. On pense beaucoup et vite dans ces cas-là. Je refuse de mourir ainsi. Ni mes parents, ni personne ne saura où je suis passé. Je n’ai pas le droit de finir comme cela. Je ne veux pas.
Dans ces circonstances, ce n’est pas toujours la vie qui vous lâche. C’est quelquefois l’homme qui la laisse partir. Confronté avec une certaine ironie à la mort dans un paysage magnifique, sous un soleil radieux, j’offre à la nature le spectacle de mon désastre. Elle me paraît horrible et narquoise en retour mais, moi, je sais bien à quel point je tiens à la vie. Ballotté par le courant, je m’accroche et lutte. Je ne sais guère comment mais je reviens vers le bord. Je respire tout en remarquant que je suis toujours du mauvais côté. J’ai eu très peur quoique je ne m’en sorte qu’avec le mollet qui saigne et quelques ecchymoses. Mes appareils photo sont intacts. Mes chaussures sont toujours bien attachées au sac mais celui-ci pèse maintenant des tonnes. Et il faut recommencer ! Comment vais-je faire ? Et voilà que survient la Providence, sous les traits de Khayam Big. Moustachu, il a un puissant torse de taureau et des jambes musclées de lutteur. Un vrai tank, âgé de 25 ans. Lui aussi veut traverser la rivière mais il en a l’habitude et a plus les qualités pour le faire que moi. J’essore mon maillot et vide un peu d’eau de mon sac. Il le prend sur son dos et nous décidons de traverser. Pour être plus stables, nous nous tenons par la main et, tant bien que mal, nous prenons pied sur l’autre rive. Je me demande comment se débrouillent les enfants et les personnes âgées qui doivent passer ainsi à la fonte des neiges. Bien sûr, c’est leur pays, ils apprennent cela tout jeunes et, bien sûr, ils ont un meilleur équilibre que moi mais, nom de Dieu, comment font-ils ? Khayam Big m’invite à me reposer dans son village, le temps d’un thé. J’étale mes habits, sac de couchage, allumettes et autres affaires mouillées au soleil pour les sécher.
Ma journée de marche – 25 kilomètres – n’est pas épuisante. J’arrive bien avant le coucher du soleil à Sarhad e Wakhan, le dernier village du Wakhan proprement dit. Il est à 200 kilomètres d’Echkachem et à 3 200 mètres d’altitude. Son chef militaire, Hafez Khan, barbe et cheveux châtains, couleur rare chez les adultes, pantalon afghan et veste de combat, est un homme de Massoud. Il est mandaté un peu à la manière d’un préfet chez nous. Son principal travail est de veiller à la sécurité de la frontière avec le Pakistan, mais il règne aussi sur les villageois ismaéliens. Sunnite, il s’est fait aménager un lieu de prière ouvert sur l’extérieur. Les ismaéliens, eux, n’ont pas de “maison de prière” et prient chez eux. Hafez Khan m’héberge et est heureux de m’emmener faire le tour du propriétaire. Il me demande mon avis sur la construction d’un bassin, où afflue une eau chaude à l’odeur soufrée et autour duquel il fait ériger des murs. Ma qualité d’Occidental me confère comme par essence divine le statut d’expert omniscient : médecin, vétérinaire, architecte, ingénieur des ponts et chaussées? Je suis parfois désolé de ne pouvoir honorer la confiance placée en moi. En l’espèce, le regard que je jette sur son ouvrage doit lui paraître approbateur car Hafez Khan me trouve un logement. »
(p. 470-473)
Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie (p. 43-48)
Turkménistan (p. 333-336)
Extrait court


