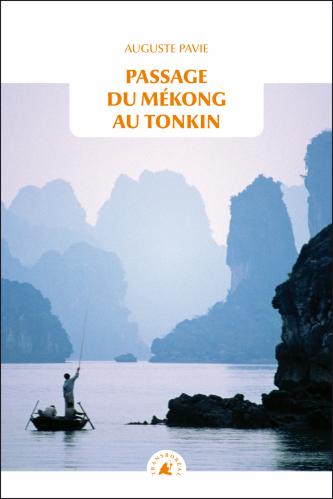
Première tentative :
« À midi, le 30 janvier 1887, les rameurs, de bons Laotiens ventres-noirs, tatoués des mollets au nombril, me regardèrent souriants, et arrêtèrent la barque. Le Mékong dont, à chaque coude, je cherchais depuis onze heures la vue, passe au loin devant nous ! Serpentant sur le plateau de Chiang Rai d’abord, puis entre des collines boisées insensiblement abaissées où le teck domine, le Nam Kok nous a descendus trois jours vers le puissant cours d’eau. Maintenant, comme pour le bien montrer, il coule en droite ligne ses derniers kilomètres, élargit son lit, élève ses berges, ralentit son allure, forme au confluent, de ses bords à pic, le cadre d’un tableau limité par la rive lointaine, en face à l’horizon. De quelle satisfaction émue je me sens pénétré à la vue de l’image tant souhaitée, premier but de ma marche ! Si la berge avait un sentier, je sauterais à terre afin d’aller jouir seul du développement progressif de ses détails et de l’ensemble.
Les rameurs, préparés par mes questions, lisent ma joie dans mes yeux, ils semblent tout heureux d’avoir par leurs efforts contribué à en approcher l’heure. Cependant, pour un peu, je leur reprocherais l’arrêt qui me semble inutile, et qu’il m’eût paru plus simple de faire à l’embouchure ; mais quand je les vois remplir leurs jarres puis se baigner, je me dis : “Après tout, c’est leur rivière, et peut-être en trouvent-ils l’eau meilleure que celle de notre fleuve là-bas.”
Les Cambodgiens, mes compagnons, sont joyeux bruyamment. Ils tâchent de reconnaître à cette grande distance si le Mékong est là bleu comme au Cambodge ou vert comme le Nam Kok, et refusent d’imiter les rameurs, comptant se rattraper bientôt au fleuve de leur pays !
On se remet en route. Quelle perspective magique, quel changement pour des yeux depuis trois mois habitués aux rivières étroites, encaissées, aux sentiers des forêts ! Bientôt la largeur du fleuve se devine. Les bambous sur sa berge, dont des collines décuplent cependant la hauteur, paraissent des grandes herbes, un vert gazon ! Puis la nappe se distingue, point luisante, presque terne malgré la grande lumière du jour, emportée en un courant unique, monstrueux, compact, que quelques tourbillons tachent par intermittence.
Amenés lentement, nous sommes tout à coup pris dans la masse de cette eau rougeâtre, fangeuse et rude, qui noie si bien le flot clair du Nam Kok qu’après qu’il l’a heurté, on n’en voit plus de traces. La sonde, avec 45 mètres de fil, n’arrive pas jusqu’au fond ! Le danger apparaît. Se maintenir à la rive devient toute l’affaire. Dès qu’ils y sont, les rameurs lâchent les avirons pour la manœuvre des perches. Sur le bord, des roches nues sortent d’un limon demi-liquide, la berge argileuse, à pic, semble prête à crouler sous le poids des arbres qui surplombent. Les Cambodgiens se taisent, déconcertés. Ils regardent, étonnés de voir combien le Mékong est ici différent de là-bas !
Les rameurs, indolents tout à l’heure, d’un bond debout, sont devenus alertes, attentifs. Remontant le courant vers Chiang Saen, ils font glisser la barque sans la choquer aux roches, la parcourent lestement par longues enjambées, retournent vivement leurs perches de 4 mètres sans qu’elles se touchent entre elles, faisant pencher l’esquif léger, au point de m’amener à reconnaître qu’il est vraiment bien frêle sur cette nappe énorme, d’allure vertigineuse, et que pour descendre vers Luang Prabang, une plus forte embarcation sera meilleure demain.
Comme ce voyage accompli du Cambodge vers Chiang Saen par la vallée voisine fait saisissante la comparaison du fleuve à ces deux points extrêmes ! Là-bas, en cette saison sèche, il étend majestueux son onde limpide et bleue entre des rives à peine, d’une à l’autre, perceptibles ; ici, torrent rude et sauvage, il passe devant nous sali et troublé autant que l’est son réservoir bourbeux, le grand lac Tonlé Sap, aux derniers jours de pêche.
Bientôt les bateliers stoppent pour reprendre haleine ; ils nous montrent les cases du village parmi les bananiers en face d’une grande île, et comme chacun de nous est silencieux, ils remarquent combien la vue du fleuve a fait les Cambodgiens surpris. D’un ton un peu moqueur, ils leur disent : “Il n’est donc pas ainsi chez vous ? Qu’attendez-vous pour vous baigner ou boire ?”
Aussitôt Kèo, comme si on lui reprochait un acte d’ingratitude, pique une tête dans l’eau. Il en sort effaré, criant : “Elle est très froide”, pendant qu’on l’aide à rentrer grelottant dans la barque. Je prends le thermomètre : il est 2 heures, il marque 27 °C, je le plonge dans l’eau, il tombe à 15 °C. La température de celle du Nam Kok était de 22 °C tout à l’heure.
Et j’explique que les neiges et les glaces des montagnes loin au nord, d’où sort le Mékong, lui ont donné la fraîcheur qu’une grande profondeur lui conserve et que nous lui verrons perdre en allant vers le sud, par l’action de l’air chaud et le mélange des affluents.
Comme mon petit monde, encore sous le coup d’un étonnement profond, est resté tout songeur, voulant voir s’il s’inquiète, je lui dis : “De même que notre fleuve vient de nous apparaître sous un aspect de déconcertante rudesse, les terres et les monts sur l’autre rive où nous allons pourront nous sembler sauvages, inaccessibles ! Après la promenade qui s’achève, il faut sans doute compter sur bien des marches pénibles ; avez-vous toujours le cœur pour me suivre partout ?”
Ngin, bourru mais souriant, répond, et ses camarades l’approuvent : “Que serions-nous venus faire avec vous sans cela ? Ensemble nous irons aux limites chinoises de l’ancien Empire khmer !”
Je reprends : “Les difficultés montreront les courages !” Et Kèo, ragaillardi par le soleil brûlant, lance à pleine gorge le cri guttural prolongé, que les autres répètent, et par lequel les Cambodgiens s’entraînent ! »
Au Cambodge (p. 85-88)
Seconde tentative (p. 500-504)
Extrait court
« À midi, le 30 janvier 1887, les rameurs, de bons Laotiens ventres-noirs, tatoués des mollets au nombril, me regardèrent souriants, et arrêtèrent la barque. Le Mékong dont, à chaque coude, je cherchais depuis onze heures la vue, passe au loin devant nous ! Serpentant sur le plateau de Chiang Rai d’abord, puis entre des collines boisées insensiblement abaissées où le teck domine, le Nam Kok nous a descendus trois jours vers le puissant cours d’eau. Maintenant, comme pour le bien montrer, il coule en droite ligne ses derniers kilomètres, élargit son lit, élève ses berges, ralentit son allure, forme au confluent, de ses bords à pic, le cadre d’un tableau limité par la rive lointaine, en face à l’horizon. De quelle satisfaction émue je me sens pénétré à la vue de l’image tant souhaitée, premier but de ma marche ! Si la berge avait un sentier, je sauterais à terre afin d’aller jouir seul du développement progressif de ses détails et de l’ensemble.
Les rameurs, préparés par mes questions, lisent ma joie dans mes yeux, ils semblent tout heureux d’avoir par leurs efforts contribué à en approcher l’heure. Cependant, pour un peu, je leur reprocherais l’arrêt qui me semble inutile, et qu’il m’eût paru plus simple de faire à l’embouchure ; mais quand je les vois remplir leurs jarres puis se baigner, je me dis : “Après tout, c’est leur rivière, et peut-être en trouvent-ils l’eau meilleure que celle de notre fleuve là-bas.”
Les Cambodgiens, mes compagnons, sont joyeux bruyamment. Ils tâchent de reconnaître à cette grande distance si le Mékong est là bleu comme au Cambodge ou vert comme le Nam Kok, et refusent d’imiter les rameurs, comptant se rattraper bientôt au fleuve de leur pays !
On se remet en route. Quelle perspective magique, quel changement pour des yeux depuis trois mois habitués aux rivières étroites, encaissées, aux sentiers des forêts ! Bientôt la largeur du fleuve se devine. Les bambous sur sa berge, dont des collines décuplent cependant la hauteur, paraissent des grandes herbes, un vert gazon ! Puis la nappe se distingue, point luisante, presque terne malgré la grande lumière du jour, emportée en un courant unique, monstrueux, compact, que quelques tourbillons tachent par intermittence.
Amenés lentement, nous sommes tout à coup pris dans la masse de cette eau rougeâtre, fangeuse et rude, qui noie si bien le flot clair du Nam Kok qu’après qu’il l’a heurté, on n’en voit plus de traces. La sonde, avec 45 mètres de fil, n’arrive pas jusqu’au fond ! Le danger apparaît. Se maintenir à la rive devient toute l’affaire. Dès qu’ils y sont, les rameurs lâchent les avirons pour la manœuvre des perches. Sur le bord, des roches nues sortent d’un limon demi-liquide, la berge argileuse, à pic, semble prête à crouler sous le poids des arbres qui surplombent. Les Cambodgiens se taisent, déconcertés. Ils regardent, étonnés de voir combien le Mékong est ici différent de là-bas !
Les rameurs, indolents tout à l’heure, d’un bond debout, sont devenus alertes, attentifs. Remontant le courant vers Chiang Saen, ils font glisser la barque sans la choquer aux roches, la parcourent lestement par longues enjambées, retournent vivement leurs perches de 4 mètres sans qu’elles se touchent entre elles, faisant pencher l’esquif léger, au point de m’amener à reconnaître qu’il est vraiment bien frêle sur cette nappe énorme, d’allure vertigineuse, et que pour descendre vers Luang Prabang, une plus forte embarcation sera meilleure demain.
Comme ce voyage accompli du Cambodge vers Chiang Saen par la vallée voisine fait saisissante la comparaison du fleuve à ces deux points extrêmes ! Là-bas, en cette saison sèche, il étend majestueux son onde limpide et bleue entre des rives à peine, d’une à l’autre, perceptibles ; ici, torrent rude et sauvage, il passe devant nous sali et troublé autant que l’est son réservoir bourbeux, le grand lac Tonlé Sap, aux derniers jours de pêche.
Bientôt les bateliers stoppent pour reprendre haleine ; ils nous montrent les cases du village parmi les bananiers en face d’une grande île, et comme chacun de nous est silencieux, ils remarquent combien la vue du fleuve a fait les Cambodgiens surpris. D’un ton un peu moqueur, ils leur disent : “Il n’est donc pas ainsi chez vous ? Qu’attendez-vous pour vous baigner ou boire ?”
Aussitôt Kèo, comme si on lui reprochait un acte d’ingratitude, pique une tête dans l’eau. Il en sort effaré, criant : “Elle est très froide”, pendant qu’on l’aide à rentrer grelottant dans la barque. Je prends le thermomètre : il est 2 heures, il marque 27 °C, je le plonge dans l’eau, il tombe à 15 °C. La température de celle du Nam Kok était de 22 °C tout à l’heure.
Et j’explique que les neiges et les glaces des montagnes loin au nord, d’où sort le Mékong, lui ont donné la fraîcheur qu’une grande profondeur lui conserve et que nous lui verrons perdre en allant vers le sud, par l’action de l’air chaud et le mélange des affluents.
Comme mon petit monde, encore sous le coup d’un étonnement profond, est resté tout songeur, voulant voir s’il s’inquiète, je lui dis : “De même que notre fleuve vient de nous apparaître sous un aspect de déconcertante rudesse, les terres et les monts sur l’autre rive où nous allons pourront nous sembler sauvages, inaccessibles ! Après la promenade qui s’achève, il faut sans doute compter sur bien des marches pénibles ; avez-vous toujours le cœur pour me suivre partout ?”
Ngin, bourru mais souriant, répond, et ses camarades l’approuvent : “Que serions-nous venus faire avec vous sans cela ? Ensemble nous irons aux limites chinoises de l’ancien Empire khmer !”
Je reprends : “Les difficultés montreront les courages !” Et Kèo, ragaillardi par le soleil brûlant, lance à pleine gorge le cri guttural prolongé, que les autres répètent, et par lequel les Cambodgiens s’entraînent ! »
(p. 117-121)
Au Cambodge (p. 85-88)
Seconde tentative (p. 500-504)
Extrait court


