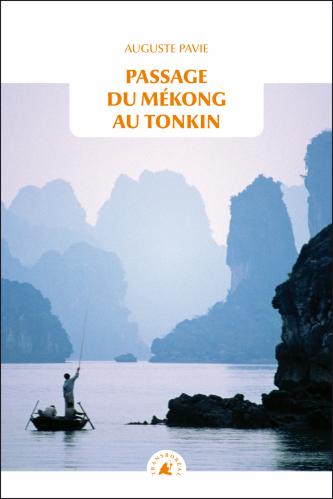
Au Cambodge :
« Dans le contact constant des indigènes, je me familiarisai avec l’idée de vivre complètement parmi eux. Du reste, voyant combien me plaisaient nos rapports communs, ils ne négligeaient aucune occasion de me rendre le séjour agréable. Ce n’était plus seulement aux fêtes qu’ils me conviaient ; j’étais prévenu de leurs chasses quand, dans la saison des pluies, la hauteur des eaux les rendait curieuses, de leurs pêches aux coquillages à l’époque des grandes marées et de ces cueillettes de fruits sauvages et de racines dans les forêts auxquelles ils se rendent par villages entiers afin de se mieux garder des tigres et aussi de la visite des éléphants, dont les troupeaux viennent à ce même moment tenter de fourrager dans les champs de canne à sucre, à la lisière des bois. Je me joignais à eux quand j’en avais le loisir, car je ne pouvais aller partout. Combien j’ai regretté, entre autres choses, de n’avoir pas fait visite à la retraite de Véal-Srè-Moroï, dont j’entendais souvent la description ! Sans doute quelqu’un, plus tard, voudra voir ce lieu solitaire qu’on faisait mystérieux ? Vus de Kampot, les monts Kamchay semblent, en se terminant, former comme un immense éventail ayant pour noyau le petit sommet de “l’autel”, dont le nom vient d’un colossal bloc de pierre qui gît tout en haut et sur lequel on invoque les génies des bois en leur demandant de protéger ceux qui vont parcourir les forêts. Si, du pied de cette montagne, on s’enfonce à l’ouest dans les ravins, on arrive, après plus d’une journée de marche, à un plateau très élevé, dominé par plusieurs pics. Dépourvu d’arbres, il est couvert de toutes petites plantes ; au milieu, un vaste étang regorgeant de poisson cache ses eaux claires sous des feuilles de lotus aussi larges que les roues des chariots. C’est à sa surface que naissent les nuages qu’on voit errer autour du mont Popokvil (“Nuages tournants”), le point culminant de la chaîne (1 200 mètres). Lorsque, fuyant devant les invasions siamoises, les populations affolées abandonnaient les villages, beaucoup de gens, se frayant à coups de hache un chemin à travers la forêt, couraient vers cette solitude chercher un asile et attendre que le calme fût rendu au pays. On lui avait donné le nom de Véal-Srè-Moroï (“Plaine des cent rizières”). Plus d’une fois déjà elle avait été troublée dans des circonstances analogues. Retraite sûre à l’heure du danger, elle a, peu à peu, pris aux yeux des Cambodgiens un caractère mystérieux, surnaturel, qui fait qu’en temps ordinaire ils redoutent de s’y aventurer. Là est la source de la rivière de Kampot ; du petit lac sort un torrent que cent autres grossissent. Si avancée que soit la sécheresse, il coule abondant sur les roches, et, tombant de ravins en ravins, vient à Kamchay, au bas des montagnes, s’étendre en une longue nappe transparente et profonde que les derniers rapides rompent bruyamment.
Je manquais rarement les occasions de pêche d’une coquille du genre Solen abondante sur la plage à l’embouchure de la rivière, dont les gens du pays sont friands et qu’ils mangent cuite ou mettent en saumure comme aliment de réserve.
Nous la prenions à marée basse en introduisant brusquement dans le trou qui dénonce la présence du mollusque une petite baguette aiguisée et dentelée ; au contact du bois, l’animal referme sa coquille en serrant ses valves sur la baguette et permet ainsi au pêcheur de l’amener à lui. À ces occasions, la plage était couverte d’hommes, de femmes et d’enfants qui emplissaient leurs paniers de ces coquillages dont la chair, au commencement de la saison sèche, est particulièrement délicate.
Dans ces courses, je m’habituai insensiblement à la nourriture à base de riz ; le pain ne me fut plus indispensable et je cessai peu à peu d’en faire. Depuis mon arrivée au Cambodge, j’étais en effet mon propre boulanger. En quittant la Cochinchine pour un pays où j’allais me trouver seul Européen, j’avais appris à préparer la pâte et à cuire le pain. Une fois installé, tous les trois jours revenait ce qui au commencement était une distraction. Alors je prenais d’infinies précautions pour la levée de la pâte ; je dorais, avec des œufs, mes pains que j’étendais en brioches sur des feuilles de bananier pour empêcher leur croûte de noircir au contact de mon four très grossier. C’était maintenant une corvée dont je fus heureux d’être débarrassé. Le besoin impérieux pour l’Européen de cet aliment, alors si souvent mal préparé dans les postes de l’intérieur de l’Indochine, s’était ainsi dissipé pour moi et j’avais reconnu que le riz est la vraie nourriture des pays tropicaux. Plus tard, quelques-uns de mes compagnons de mission m’ont confié au départ que leur souci était de pouvoir supporter la privation de pain. Ils en emportaient une forte provision avec du biscuit. Pendant les premiers jours, ils savouraient leur pain, puis il fallait le recuire et l’amollir à la vapeur de la soupe ou du carry, sur la fin ce n’était plus qu’une affreuse moisissure ; le dégoût faisait apprécier le riz éblouissant de blancheur au fumet agréable, et le biscuit lui-même ne servait plus qu’à amadouer les enfants des villages. »
Première tentative (p. 117-121)
Seconde tentative (p. 500-504)
Extrait court
« Dans le contact constant des indigènes, je me familiarisai avec l’idée de vivre complètement parmi eux. Du reste, voyant combien me plaisaient nos rapports communs, ils ne négligeaient aucune occasion de me rendre le séjour agréable. Ce n’était plus seulement aux fêtes qu’ils me conviaient ; j’étais prévenu de leurs chasses quand, dans la saison des pluies, la hauteur des eaux les rendait curieuses, de leurs pêches aux coquillages à l’époque des grandes marées et de ces cueillettes de fruits sauvages et de racines dans les forêts auxquelles ils se rendent par villages entiers afin de se mieux garder des tigres et aussi de la visite des éléphants, dont les troupeaux viennent à ce même moment tenter de fourrager dans les champs de canne à sucre, à la lisière des bois. Je me joignais à eux quand j’en avais le loisir, car je ne pouvais aller partout. Combien j’ai regretté, entre autres choses, de n’avoir pas fait visite à la retraite de Véal-Srè-Moroï, dont j’entendais souvent la description ! Sans doute quelqu’un, plus tard, voudra voir ce lieu solitaire qu’on faisait mystérieux ? Vus de Kampot, les monts Kamchay semblent, en se terminant, former comme un immense éventail ayant pour noyau le petit sommet de “l’autel”, dont le nom vient d’un colossal bloc de pierre qui gît tout en haut et sur lequel on invoque les génies des bois en leur demandant de protéger ceux qui vont parcourir les forêts. Si, du pied de cette montagne, on s’enfonce à l’ouest dans les ravins, on arrive, après plus d’une journée de marche, à un plateau très élevé, dominé par plusieurs pics. Dépourvu d’arbres, il est couvert de toutes petites plantes ; au milieu, un vaste étang regorgeant de poisson cache ses eaux claires sous des feuilles de lotus aussi larges que les roues des chariots. C’est à sa surface que naissent les nuages qu’on voit errer autour du mont Popokvil (“Nuages tournants”), le point culminant de la chaîne (1 200 mètres). Lorsque, fuyant devant les invasions siamoises, les populations affolées abandonnaient les villages, beaucoup de gens, se frayant à coups de hache un chemin à travers la forêt, couraient vers cette solitude chercher un asile et attendre que le calme fût rendu au pays. On lui avait donné le nom de Véal-Srè-Moroï (“Plaine des cent rizières”). Plus d’une fois déjà elle avait été troublée dans des circonstances analogues. Retraite sûre à l’heure du danger, elle a, peu à peu, pris aux yeux des Cambodgiens un caractère mystérieux, surnaturel, qui fait qu’en temps ordinaire ils redoutent de s’y aventurer. Là est la source de la rivière de Kampot ; du petit lac sort un torrent que cent autres grossissent. Si avancée que soit la sécheresse, il coule abondant sur les roches, et, tombant de ravins en ravins, vient à Kamchay, au bas des montagnes, s’étendre en une longue nappe transparente et profonde que les derniers rapides rompent bruyamment.
Je manquais rarement les occasions de pêche d’une coquille du genre Solen abondante sur la plage à l’embouchure de la rivière, dont les gens du pays sont friands et qu’ils mangent cuite ou mettent en saumure comme aliment de réserve.
Nous la prenions à marée basse en introduisant brusquement dans le trou qui dénonce la présence du mollusque une petite baguette aiguisée et dentelée ; au contact du bois, l’animal referme sa coquille en serrant ses valves sur la baguette et permet ainsi au pêcheur de l’amener à lui. À ces occasions, la plage était couverte d’hommes, de femmes et d’enfants qui emplissaient leurs paniers de ces coquillages dont la chair, au commencement de la saison sèche, est particulièrement délicate.
Dans ces courses, je m’habituai insensiblement à la nourriture à base de riz ; le pain ne me fut plus indispensable et je cessai peu à peu d’en faire. Depuis mon arrivée au Cambodge, j’étais en effet mon propre boulanger. En quittant la Cochinchine pour un pays où j’allais me trouver seul Européen, j’avais appris à préparer la pâte et à cuire le pain. Une fois installé, tous les trois jours revenait ce qui au commencement était une distraction. Alors je prenais d’infinies précautions pour la levée de la pâte ; je dorais, avec des œufs, mes pains que j’étendais en brioches sur des feuilles de bananier pour empêcher leur croûte de noircir au contact de mon four très grossier. C’était maintenant une corvée dont je fus heureux d’être débarrassé. Le besoin impérieux pour l’Européen de cet aliment, alors si souvent mal préparé dans les postes de l’intérieur de l’Indochine, s’était ainsi dissipé pour moi et j’avais reconnu que le riz est la vraie nourriture des pays tropicaux. Plus tard, quelques-uns de mes compagnons de mission m’ont confié au départ que leur souci était de pouvoir supporter la privation de pain. Ils en emportaient une forte provision avec du biscuit. Pendant les premiers jours, ils savouraient leur pain, puis il fallait le recuire et l’amollir à la vapeur de la soupe ou du carry, sur la fin ce n’était plus qu’une affreuse moisissure ; le dégoût faisait apprécier le riz éblouissant de blancheur au fumet agréable, et le biscuit lui-même ne servait plus qu’à amadouer les enfants des villages. »
(p. 85-88)
Première tentative (p. 117-121)
Seconde tentative (p. 500-504)
Extrait court


