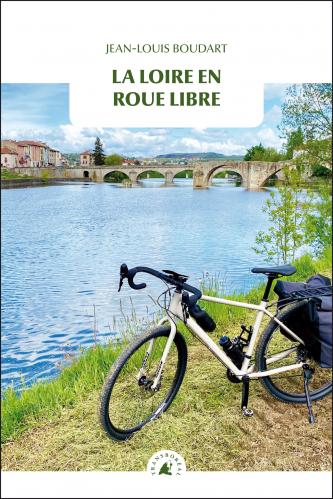
Sur les hautes terres :
« Depuis mon départ du Gerbier, je n’ai parcouru que 20 kilomètres et les filets d’eau des sources de la Loire se sont déjà transformés en une belle rivière qui se jette dans un lac artificiel d’un beau bleu profond. Une vraie carte postale. Afin de développer le tourisme dans ce coin perdu de la montagne ardéchoise, ses rives ont été aménagées en un vaste espace de loisirs, avec tables de pique-nique, jeux pour les enfants et aire de stationnement pour les camping-cars. Mais en cette saison, les touristes ne sont pas encore là. Quelques kilomètres plus loin, ayant pris de la hauteur, je découvre l’envers du décor : un gigantesque mur de béton construit en pleine nature ! C’est le barrage EDF de La Palisse. Haut de 55 mètres, l’édifice gris et massif est d’une laideur monstrueuse. Dans ce paysage naturel de toute beauté, la vision est vraiment brutale. Et le barrage ne fait pas que retenir l’eau de la Loire, il en détourne aussi la plus grande partie vers le Rhône afin d’alimenter une centrale hydroélectrique. Jusqu’à La Palisse, la Loire était joyeuse et pleine de vie. À cause du mur monumental qui confisque ses eaux, elle se voit réduite à un ruisseau ridicule s’écoulant, à peine visible, au fond du ravin où je n’entends plus aucun bruit. Désormais, la rivière a perdu son entrain, son insouciance et toute sa force. S’enfonçant dans la vallée encaissée qu’elle a creusée depuis des millénaires lorsqu’elle était encore libre, elle se cache désormais pour échapper à nos regards et pleurer en silence sur la brutalité des hommes.
Préférant oublier le barrage de La Palisse, je grimpe sans m’arrêter jusqu’à la première vraie difficulté de la journée : l’ascension du col de Gage. L’un des passages obligés de l’Ardéchoise, une épreuve cycliste rassemblant chaque année quinze mille concurrents venus de toute l’Europe. Robert Marchand en fut longtemps la mascotte ; le sportif centenaire le plus célèbre de France a participé à dix-neuf éditions de l’Ardéchoise. Ce phénomène est devenu champion du monde de cyclisme sur piste à 105 ans ! Je pense à lui en arrivant au pied du col de Gage. Cela me met du baume au cœur. Je n’ai que 64 ans ; il me reste encore un peu de marge. Deux kilomètres et demi d’une montée ininterrompue m’attendent maintenant. Qui a dit que les bords de Loire étaient plats ? L’ascension est courte mais plutôt raide. Un panneau indique 6 % de pente moyenne et quelques passages à 10 % ! J’appuie sur les pédales de manière souple et régulière, sans mettre pied à terre malgré le poids des sacoches. Parvenu au col, à 1 098 mètres d’altitude, je suis à la fois à bout de souffle et ébloui par la vue magnifique sur le lac d’Issarlès, un ancien cratère volcanique large de 5 kilomètres, dont les eaux limpides plongent à plus de 130 mètres de profondeur. En été, baigneurs et touristes viennent y chercher un peu de fraîcheur à l’ombre des grands pins. Je redescends vers Issarlès à travers une forêt de grands hêtres dont le feuillage se découpe en ombres chinoises sur les eaux bleues du lac en formant une superbe dentelle végétale. Un joli traveling de cinéma ! Sur les bords du lac, j’aperçois une plage de sable blond et un pêcheur solitaire. C’est le premier être humain que je vois depuis le matin.
En franchissant le ruisseau de l’Orcival, je quitte l’Ardèche pour entrer en Haute-Loire. En remontant doucement vers Salettes, je croise deux ânes gris dans un pré qui regardent passer mon vélo avec leurs grands yeux doux. Ils tournent la tête vers moi en même temps ; je dois sans doute être leur seule distraction de la journée. Il n’y a personne sur la route. Comme beaucoup de villages de la région, Salettes a vu sa population diminuer régulièrement. Tous fils et filles d’agriculteurs, les jeunes sont partis vers Le Puy-en-Velay, Saint-Étienne ou Lyon. Les fermes ont disparu les unes après les autres. À la fin des années 1960, Salettes comptait une cinquantaine de paysans. Aujourd’hui, ils ne sont plus que six à s’accrocher à leur terre. Parmi eux, Jean-Louis Abeillon, l’œil bleu, la moustache fine et la soixantaine passée. Il cultive quelques hectares de céréales et élève des moutons dans sa bergerie de Bordeyrac qui domine la haute vallée de la Loire. C’est là que je le retrouve. Ce matin, il mène son troupeau pâturer dans la prairie. Je pose ma bicyclette sur le bord d’un pré. “Les herbes sont trop hautes, me dit-il en regardant ses brebis. Les anciens disaient que, quand le mouton broute, il ne doit pas se mouiller les oreilles. Avec la rosée, l’herbe est trempée et il la digère moins bien.” Jean-Louis Abeillon a appris le métier d’agriculteur avec son père. Mais il ne sait pas encore qui va reprendre l’exploitation. “J’ai deux filles. Elles ont 29 et 32 ans. Mais aucune des deux ne veut prendre la suite. Trop dur, qu’elles disent? Alors elles sont parties à la ville. L’une est infirmière et l’autre assistance sociale. Du coup, je n’ai pas trop envie de partir à la retraite et de tout vendre, vous comprenez ?” L’agriculteur s’arrête un instant, regarde les brebis qui paissent devant nous. Un voile passe dans son regard. “Trouver un jeune pour prendre ma place ? Je ne serais pas contre, mais je ne trouve personne. Il faudrait qu’il s’endette. Moi j’ai été farci d’emprunts toute ma vie. Je viens à peine de finir de payer mon dernier crédit. Vous savez combien ça coûte un tracteur ? Même un petit, avec un moteur de 80 CV ? Il y en a pour 60 000 euros !”
Sur les hautes terres au-dessus de Salettes, un vent froid souffle sur la prairie. La vue sur la ligne des monts d’Auvergne est magnifique. Nous semblons être seuls au monde. Tandis que nous parlions, le troupeau de Jean-Louis est passé de l’autre côté du vallon. Avant de me quitter pour le rejoindre, l’agriculteur reprend d’une voix un peu lasse. “C’est dur ce métier, vous savez? J’ai vu partir tous mes collègues les uns après les autres, pour travailler à la Poste ou chez Michelin. Et puis la santé s’en ressent. Douze heures de travail par jour, ça use. Cet après-midi, je vais à un enterrement. Un copain agriculteur? victime d’une rupture d’anévrisme. Il avait 55 ans.” Je laisse Jean-Louis Abeillon rejoindre ses bêtes. “J’espère que le temps va se remettre debout. Avec la météo, on est toujours un peu stressé”, ajoute-t-il en scrutant les nuages qui traversent le ciel. Avant de disparaître lui aussi derrière le vallon, il m’adresse un signe de la main. Combien restera-t-il d’agriculteurs à Salettes l’an prochain ? »
La Grenadière (p. 193-196)
Vers le grand large (p. 266-269)
Extrait court
« Depuis mon départ du Gerbier, je n’ai parcouru que 20 kilomètres et les filets d’eau des sources de la Loire se sont déjà transformés en une belle rivière qui se jette dans un lac artificiel d’un beau bleu profond. Une vraie carte postale. Afin de développer le tourisme dans ce coin perdu de la montagne ardéchoise, ses rives ont été aménagées en un vaste espace de loisirs, avec tables de pique-nique, jeux pour les enfants et aire de stationnement pour les camping-cars. Mais en cette saison, les touristes ne sont pas encore là. Quelques kilomètres plus loin, ayant pris de la hauteur, je découvre l’envers du décor : un gigantesque mur de béton construit en pleine nature ! C’est le barrage EDF de La Palisse. Haut de 55 mètres, l’édifice gris et massif est d’une laideur monstrueuse. Dans ce paysage naturel de toute beauté, la vision est vraiment brutale. Et le barrage ne fait pas que retenir l’eau de la Loire, il en détourne aussi la plus grande partie vers le Rhône afin d’alimenter une centrale hydroélectrique. Jusqu’à La Palisse, la Loire était joyeuse et pleine de vie. À cause du mur monumental qui confisque ses eaux, elle se voit réduite à un ruisseau ridicule s’écoulant, à peine visible, au fond du ravin où je n’entends plus aucun bruit. Désormais, la rivière a perdu son entrain, son insouciance et toute sa force. S’enfonçant dans la vallée encaissée qu’elle a creusée depuis des millénaires lorsqu’elle était encore libre, elle se cache désormais pour échapper à nos regards et pleurer en silence sur la brutalité des hommes.
Préférant oublier le barrage de La Palisse, je grimpe sans m’arrêter jusqu’à la première vraie difficulté de la journée : l’ascension du col de Gage. L’un des passages obligés de l’Ardéchoise, une épreuve cycliste rassemblant chaque année quinze mille concurrents venus de toute l’Europe. Robert Marchand en fut longtemps la mascotte ; le sportif centenaire le plus célèbre de France a participé à dix-neuf éditions de l’Ardéchoise. Ce phénomène est devenu champion du monde de cyclisme sur piste à 105 ans ! Je pense à lui en arrivant au pied du col de Gage. Cela me met du baume au cœur. Je n’ai que 64 ans ; il me reste encore un peu de marge. Deux kilomètres et demi d’une montée ininterrompue m’attendent maintenant. Qui a dit que les bords de Loire étaient plats ? L’ascension est courte mais plutôt raide. Un panneau indique 6 % de pente moyenne et quelques passages à 10 % ! J’appuie sur les pédales de manière souple et régulière, sans mettre pied à terre malgré le poids des sacoches. Parvenu au col, à 1 098 mètres d’altitude, je suis à la fois à bout de souffle et ébloui par la vue magnifique sur le lac d’Issarlès, un ancien cratère volcanique large de 5 kilomètres, dont les eaux limpides plongent à plus de 130 mètres de profondeur. En été, baigneurs et touristes viennent y chercher un peu de fraîcheur à l’ombre des grands pins. Je redescends vers Issarlès à travers une forêt de grands hêtres dont le feuillage se découpe en ombres chinoises sur les eaux bleues du lac en formant une superbe dentelle végétale. Un joli traveling de cinéma ! Sur les bords du lac, j’aperçois une plage de sable blond et un pêcheur solitaire. C’est le premier être humain que je vois depuis le matin.
En franchissant le ruisseau de l’Orcival, je quitte l’Ardèche pour entrer en Haute-Loire. En remontant doucement vers Salettes, je croise deux ânes gris dans un pré qui regardent passer mon vélo avec leurs grands yeux doux. Ils tournent la tête vers moi en même temps ; je dois sans doute être leur seule distraction de la journée. Il n’y a personne sur la route. Comme beaucoup de villages de la région, Salettes a vu sa population diminuer régulièrement. Tous fils et filles d’agriculteurs, les jeunes sont partis vers Le Puy-en-Velay, Saint-Étienne ou Lyon. Les fermes ont disparu les unes après les autres. À la fin des années 1960, Salettes comptait une cinquantaine de paysans. Aujourd’hui, ils ne sont plus que six à s’accrocher à leur terre. Parmi eux, Jean-Louis Abeillon, l’œil bleu, la moustache fine et la soixantaine passée. Il cultive quelques hectares de céréales et élève des moutons dans sa bergerie de Bordeyrac qui domine la haute vallée de la Loire. C’est là que je le retrouve. Ce matin, il mène son troupeau pâturer dans la prairie. Je pose ma bicyclette sur le bord d’un pré. “Les herbes sont trop hautes, me dit-il en regardant ses brebis. Les anciens disaient que, quand le mouton broute, il ne doit pas se mouiller les oreilles. Avec la rosée, l’herbe est trempée et il la digère moins bien.” Jean-Louis Abeillon a appris le métier d’agriculteur avec son père. Mais il ne sait pas encore qui va reprendre l’exploitation. “J’ai deux filles. Elles ont 29 et 32 ans. Mais aucune des deux ne veut prendre la suite. Trop dur, qu’elles disent? Alors elles sont parties à la ville. L’une est infirmière et l’autre assistance sociale. Du coup, je n’ai pas trop envie de partir à la retraite et de tout vendre, vous comprenez ?” L’agriculteur s’arrête un instant, regarde les brebis qui paissent devant nous. Un voile passe dans son regard. “Trouver un jeune pour prendre ma place ? Je ne serais pas contre, mais je ne trouve personne. Il faudrait qu’il s’endette. Moi j’ai été farci d’emprunts toute ma vie. Je viens à peine de finir de payer mon dernier crédit. Vous savez combien ça coûte un tracteur ? Même un petit, avec un moteur de 80 CV ? Il y en a pour 60 000 euros !”
Sur les hautes terres au-dessus de Salettes, un vent froid souffle sur la prairie. La vue sur la ligne des monts d’Auvergne est magnifique. Nous semblons être seuls au monde. Tandis que nous parlions, le troupeau de Jean-Louis est passé de l’autre côté du vallon. Avant de me quitter pour le rejoindre, l’agriculteur reprend d’une voix un peu lasse. “C’est dur ce métier, vous savez? J’ai vu partir tous mes collègues les uns après les autres, pour travailler à la Poste ou chez Michelin. Et puis la santé s’en ressent. Douze heures de travail par jour, ça use. Cet après-midi, je vais à un enterrement. Un copain agriculteur? victime d’une rupture d’anévrisme. Il avait 55 ans.” Je laisse Jean-Louis Abeillon rejoindre ses bêtes. “J’espère que le temps va se remettre debout. Avec la météo, on est toujours un peu stressé”, ajoute-t-il en scrutant les nuages qui traversent le ciel. Avant de disparaître lui aussi derrière le vallon, il m’adresse un signe de la main. Combien restera-t-il d’agriculteurs à Salettes l’an prochain ? »
(p.32-37)
La Grenadière (p. 193-196)
Vers le grand large (p. 266-269)
Extrait court


