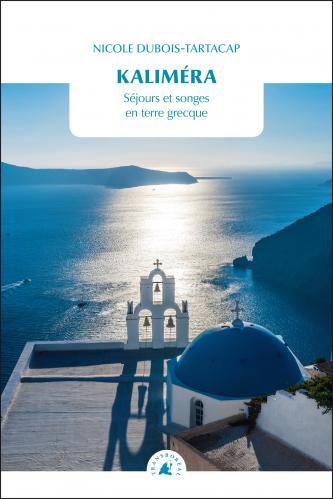
Ithaque, Cûˋphalonie :
« On ûˋtudie l’Odyssûˋe en sixiû´me, et dans l’imagination de l’enfant que nous sommes se dessinent, à travers les pûˋripûˋties qui ûˋmaillent le long retour d’Ulysse vers son royaume d’Ithaque, les contours d’une ûÛle de lûˋgende forcûˋment plus belle que toutes les autres ûÛles, puisque le hûˋros, pour la retrouver, brave tous les dangers et renonce à toutes tentations. Puis un jour, en scrutant une carte, on dûˋcouvre qu’Ithaque existe vraiment, et cette rûˋvûˋlation procure une ûˋmotion intense, un mûˋlange d’enthousiasme et d’incrûˋdulitûˋ. Du moins l’ai-je vûˋcu ainsi : soudain, le mythe prenait forme, prenait vie. Il s’ancrait dans la rûˋalitûˋ.
J’ai vu bien d’autres ûÛles avant d’accoster à Ithaque. Elle ne se trouvait jamais sur nos itinûˋraires. Mais au fond, ûˋtait-ce bien la raison ?
Enfin, ce jour est venu.
Les paysages d’Ithaque sont parmi les plus beaux et les plus vierges qu’il m’ait ûˋtûˋ donnûˋ de voir sur une ûÛle grecque. Cela tient à sa taille, petite, à son faible peuplement, au nombre trû´s restreint de touristes, à son relief accidentûˋ, à ses vignes, à la fraûÛcheur de ses forûˆts de pins et de cyprû´s, à ses criques et à ses petits ports qui jalonnent la cûÇte nord – quelques tavernes, pas plus, au ras de l’eau? Mais surtout, cela tient à sa configuration unique : une longue bande de terre sur laquelle courent deux chaûÛnes de montagnes, l’une au nord, l’autre au sud, resserrûˋe en son centre sur une crûˆte rocheuse, isthme ûˋtroit sur lequel serpente la route, si mince que vous vous retrouvez suspendu entre ciel et mer, noyûˋ dans un ocûˋan de bleu s’ûˋtendant, à l’ouest, jusqu’à Cûˋphalonie, à l’est, jusqu’aux cûÇtes de Grû´ce occidentale. Ithaque est admirable.
Alors, d’oû¿ vient que je n’aie pas ressenti, ici, cette vibration qui m’est venue à la vue d’autres sites – Mycû´nes, le temple d’Aphaû₤a, Mystra? ? Est-ce d’avoir cru trop fort, jadis, à un mythe trop grand pour qu’il puisse ûˆtre un jour confrontûˋ à la rûˋalitûˋ ? Ou est-ce parce qu’à Ithaque je n’ai trouvûˋ aucune pierre, aucun lieu oû¿ ancrer les images que je portais en moi, nul endroit oû¿ rencontrer Pûˋnûˋlope, Eumûˋe, Tûˋlûˋmaque ou Ulysse ? On parle bien d’une grotte oû¿ ce dernier aurait cachûˋ le trûˋsor offert par les Phûˋaciens, d’une source oû¿ il aurait rencontrûˋ, habillûˋ en mendiant, le porcher Eumûˋe? Mais du palais d’Ulysse, de la plage sur laquelle il a dûˋbarquûˋ, de la cabane du porcher, aucune trace, aucun indice mûˆme qui permette raisonnablement de se dire : c’ûˋtait là. Pire : aucune preuve qu’il s’agisse bien de cette ûÛle et non, peut-ûˆtre, de sa voisine Cûˋphalonie – ce que je me refuse à envisager.
Comme pour Ulysse touchant enfin aux rivages tant de fois espûˋrûˋs, une brume s’interpose entre Ithaque et moi, qui brouille les pistes et m’empûˆche de reconnaûÛtre l’ûÛle qui prit forme en moi lorsque j’ûˋtais enfant. Mais finalement, quelle importance ?
“Quand tu prendras le chemin d’Ithaque, ûˋcrit le poû´te, souhaite que la route soit longue./Que nombreux soient les matins d’ûˋtûˋ/oû¿ avec quel plaisir et quelle joie !/tu dûˋcouvriras des ports que tu n’as jamais vus./[?] Garde toujours Ithaque prûˋsente à ton esprit./Y parvenir est ta destination finale./Mais ne te hûÂte surtout pas dans ton voyage./Mieux vaut le prolonger pendant des annûˋes ;/et n’aborder dans l’ûÛle que dans ta vieillesse,/riche de ce que tu auras gagnûˋ en chemin,/sans attendre d’Ithaque aucun autre bienfait./Ithaque t’a offert le beau voyage./Sans elle, tu n’aurais pas pris la route./Elle n’a rien de plus à t’apporter?” (Constantin Cavafis)
Un simple dûˋtroit sûˋpare Ithaque de Cûˋphalonie. On le franchit sur l’un des bateaux qui partent du port de Pisaetos, sur la cûÇte ouest d’Ithaque, et qui, mettant le cap vers l’ouest, accostent, une demi-heure plus tard, à Sami. La capitale, Argostoli, est situûˋe de l’autre cûÇtûˋ de l’ûÛle.
Une longue prûˋsence vûˋnitienne commune à toutes les ûÛles ioniennes, et qui ne s’acheva qu’au XVIIIe siû´cle, avait marquûˋ l’architecture de Cûˋphalonie. Argostoli fut belle et ûˋlûˋgante, à l’image de Corfou peut-ûˆtre. Il n’en reste rien : le terrible sûˋisme de 1953, qui toucha ûˋgalement Ithaque et Zante, l’a ûˋradiquûˋe d’un coup. Sa force fut telle qu’elle modifia jusqu’au relief de l’ûÛle. Le hasard avait amenûˋ Maurice Grandazzi à Argostoli quelques jours plus tûÇt. C’ûˋtait, ûˋcrira-t-il à son retour dans les Annales de gûˋographie, comme si une scie gûˋante fendait les rochers, comme si un train, dans un fracas qui s’amplifiait, franchissait sous terre un grand pont mûˋtallique, puis passait de l’autre cûÇtûˋ de l’ûÛle et s’enfonûÏait au cœur de la montagne. La nuit suivante, un vent violent se leva, la mer se fit houleuse, les chiens commencû´rent à hurler, les ûÂnes à braire, les coqs à chanter. La terre bougeait encore. Lorsque le jour se leva, les secousses reprirent de plus belle. La crûˆte des montagnes semblait se replier sur elle-mûˆme. “La terre ûˋclatait comme un fruit mû£r. Un nuage de poussiû´re, celui qui s’ûˋtait ûˋlevûˋ d’Argostoli abattue en quelques secondes comme un chûÂteau de cartes, retombait sur nous. L’obscuritûˋ devint telle qu’à 3 mû´tres l’un de l’autre, nous ne pouvions plus nous deviner. [?] Puis le soleil brilla de nouveau.” Argostoli n’existait plus. L’ûÛle de Solal n’ûˋtait qu’un champ de ruines. On compta les morts par centaines, et c’est par milliers que les habitants quittû´rent l’ûÛle.
Aujourd’hui, comme dans toutes les zones à risque, ceux qui y vivent encore composent entre fatalisme et crainte, sachant bien qu’à tout moment leur vie peut ûˆtre pulvûˋrisûˋe par un mouvement d’humeur venu des trûˋfonds de la terre. Ce fut de nouveau le cas en janvier 2014 lorsqu’un autre sûˋisme, heureusement de moindre importance, ravagea de nombreux bûÂtiments et jeta à la rue des centaines de familles.
En 1953, seule une poignûˋe de villages fut ûˋpargnûˋe par le cataclysme. Parmi eux, Fiskardo, à la pointe nord de l’ûÛle, se trouvait à l’opposûˋ de l’ûˋpicentre. C’ûˋtait un hameau de pûˆcheurs autour d’un petit port, à peine un Saint-Tropez, peut-ûˆtre, d’avant Brigitte Bardot, avec ce je-ne-sais-quoi qui enchante au premier regard. L’authenticitûˋ de tels lieux est toujours vouûˋe à la disparition : aprû´s les dûˋcouvreurs viennent les artistes, puis les yachts, puis les foules. Fiskardo n’a pas ûˋchappûˋ à la rû´gle. Dans les annûˋes 1960, les hippies en avaient fait leur repaire. Installûˋs dans la maisonnette du gardien de phare, ils grattaient sans faûÏon la guitare avec les villageois. Puis ils partirent, et c’est dans le cafûˋ de Kyria Irini, le premier kafûˋnio-ouzerie-taverne du port, que l’on continua à faire la fûˆte. D’autres cafûˋs et restaurants suivirent, dont celui des parents de Tasia Dendrinou, dans les annûˋes 1970. Tasia avait 12 ans. Le village n’avait pas l’ûˋlectricitûˋ, et pour se rendre à la capitale distante de 50 kilomû´tres, on mettait au minimum quatre heures !
Lorsqu’on la voit pour la premiû´re fois dans son restaurant, assise un peu à l’ûˋcart avec sa parûˋa, cheveux trû´s noirs, corpulence de bonne vivante, ûˋclats de rire explosifs et verbe haut, on sait d’emblûˋe qui, ici, est le maûÛtre. Tasia est une star, une Maû₤tûˋ grecque connue dans tout le pays pour ses ûˋmissions culinaires à la tûˋlûˋvision. Un caractû´re. Un personnage. Une Loxandra en terre ionienne.
Loxandra, la vraie, vivait à Constantinople au XIXe siû´cle. C’ûˋtait une femme du peuple dûˋbordante de vie et d’ûˋnergie, gûˋnûˋreuse, excellente cuisiniû´re, aimante, simple et forte. Sa petite-fille, la romanciû´re Maria Iordanidou, en fit le personnage central d’un roman qui connut un immense succû´s. Loxandra, devenue emblûˋmatique d’une ûˋpoque et d’un lieu, cristallisera toute la nostalgie des Grecs pour Constantinople et l’hellûˋnisme d’Asie Mineure, et deviendra une vûˋritable figure de la littûˋrature grecque.
Tout ce que Cûˋphalonie, rendue cûˋlû´bre par le film Capitaine Corelli, compte de cûˋlûˋbritûˋs – Tom Hanks, Giorgio Armani, Fernando Botero – se donne rendez-vous ici, à Fiskardo, chez Tasia. Cela ne la change ni ne l’impressionne. Avec les vedettes ou avec les inconnus, Tasia est Tasia, ronde, ouverte, gûˋnûˋreuse, truculente.
Le dernier soir de notre sûˋjour à Fiskardo, nous avions commandûˋ, à la fin du repas, un entremets à l’orange qui m’avait tant rûˋjouie que le lendemain matin, je me suis rûˋveillûˋe avec le souvenir de sa fraûÛcheur et l’obsession d’en connaûÛtre la recette. Nous habitions un hameau à quelques kilomû´tres du village, mais avant de partir, nous devions y passer pour faire des courses. Le port, à 10 heures du matin, ûˋmergeait à peine de sa lûˋthargie, mais Tasia ûˋtait dûˋjà là, campûˋe derriû´re ses fourneaux. Je doutais qu’elle me donne sa recette mais aprû´s tout? Les choses n’ont pas traûÛnûˋ : à peine ma requûˆte formulûˋe, je me suis retrouvûˋe propulsûˋe derriû´re les grandes marmites, prûˋcûˋdûˋe d’une Tasia pûˋremptoire : “Prenez ce papier ! Vous avez un stylo ? Écrivez !” Elle ûˋnumûˋrait : les oranges, le jus, le sucre, la cornflower? Elle dictait les proportions à toute vitesse, à moitiûˋ en grec, à moitiûˋ en anglais. Ce faisant, elle soulevait les couvercles et me prûˋsentait ce qu’elle mijotait dûˋjà pour le repas de midi, une ratatouille “faite avec les lûˋgumes que j’ai apportûˋs ce matin du jardin ! ûla Yanni ! Prends deux assiettes !? Je vais vous faire goû£ter. Asseyez-vous dehors !” Et nous voilà installûˋs devant deux grandes assiettes d’une ratatouille sublime, suivie de deux verres de liqueur maison. “Vous aimez ? Vous voulez la recette ??” »
Un condensûˋ de l’histoire grecque (p. 21-26)
MaûÛtres d’œuvre, musiciens et bergers (p. 212-216)
Extrait court
« On ûˋtudie l’Odyssûˋe en sixiû´me, et dans l’imagination de l’enfant que nous sommes se dessinent, à travers les pûˋripûˋties qui ûˋmaillent le long retour d’Ulysse vers son royaume d’Ithaque, les contours d’une ûÛle de lûˋgende forcûˋment plus belle que toutes les autres ûÛles, puisque le hûˋros, pour la retrouver, brave tous les dangers et renonce à toutes tentations. Puis un jour, en scrutant une carte, on dûˋcouvre qu’Ithaque existe vraiment, et cette rûˋvûˋlation procure une ûˋmotion intense, un mûˋlange d’enthousiasme et d’incrûˋdulitûˋ. Du moins l’ai-je vûˋcu ainsi : soudain, le mythe prenait forme, prenait vie. Il s’ancrait dans la rûˋalitûˋ.
J’ai vu bien d’autres ûÛles avant d’accoster à Ithaque. Elle ne se trouvait jamais sur nos itinûˋraires. Mais au fond, ûˋtait-ce bien la raison ?
Enfin, ce jour est venu.
Les paysages d’Ithaque sont parmi les plus beaux et les plus vierges qu’il m’ait ûˋtûˋ donnûˋ de voir sur une ûÛle grecque. Cela tient à sa taille, petite, à son faible peuplement, au nombre trû´s restreint de touristes, à son relief accidentûˋ, à ses vignes, à la fraûÛcheur de ses forûˆts de pins et de cyprû´s, à ses criques et à ses petits ports qui jalonnent la cûÇte nord – quelques tavernes, pas plus, au ras de l’eau? Mais surtout, cela tient à sa configuration unique : une longue bande de terre sur laquelle courent deux chaûÛnes de montagnes, l’une au nord, l’autre au sud, resserrûˋe en son centre sur une crûˆte rocheuse, isthme ûˋtroit sur lequel serpente la route, si mince que vous vous retrouvez suspendu entre ciel et mer, noyûˋ dans un ocûˋan de bleu s’ûˋtendant, à l’ouest, jusqu’à Cûˋphalonie, à l’est, jusqu’aux cûÇtes de Grû´ce occidentale. Ithaque est admirable.
Alors, d’oû¿ vient que je n’aie pas ressenti, ici, cette vibration qui m’est venue à la vue d’autres sites – Mycû´nes, le temple d’Aphaû₤a, Mystra? ? Est-ce d’avoir cru trop fort, jadis, à un mythe trop grand pour qu’il puisse ûˆtre un jour confrontûˋ à la rûˋalitûˋ ? Ou est-ce parce qu’à Ithaque je n’ai trouvûˋ aucune pierre, aucun lieu oû¿ ancrer les images que je portais en moi, nul endroit oû¿ rencontrer Pûˋnûˋlope, Eumûˋe, Tûˋlûˋmaque ou Ulysse ? On parle bien d’une grotte oû¿ ce dernier aurait cachûˋ le trûˋsor offert par les Phûˋaciens, d’une source oû¿ il aurait rencontrûˋ, habillûˋ en mendiant, le porcher Eumûˋe? Mais du palais d’Ulysse, de la plage sur laquelle il a dûˋbarquûˋ, de la cabane du porcher, aucune trace, aucun indice mûˆme qui permette raisonnablement de se dire : c’ûˋtait là. Pire : aucune preuve qu’il s’agisse bien de cette ûÛle et non, peut-ûˆtre, de sa voisine Cûˋphalonie – ce que je me refuse à envisager.
Comme pour Ulysse touchant enfin aux rivages tant de fois espûˋrûˋs, une brume s’interpose entre Ithaque et moi, qui brouille les pistes et m’empûˆche de reconnaûÛtre l’ûÛle qui prit forme en moi lorsque j’ûˋtais enfant. Mais finalement, quelle importance ?
“Quand tu prendras le chemin d’Ithaque, ûˋcrit le poû´te, souhaite que la route soit longue./Que nombreux soient les matins d’ûˋtûˋ/oû¿ avec quel plaisir et quelle joie !/tu dûˋcouvriras des ports que tu n’as jamais vus./[?] Garde toujours Ithaque prûˋsente à ton esprit./Y parvenir est ta destination finale./Mais ne te hûÂte surtout pas dans ton voyage./Mieux vaut le prolonger pendant des annûˋes ;/et n’aborder dans l’ûÛle que dans ta vieillesse,/riche de ce que tu auras gagnûˋ en chemin,/sans attendre d’Ithaque aucun autre bienfait./Ithaque t’a offert le beau voyage./Sans elle, tu n’aurais pas pris la route./Elle n’a rien de plus à t’apporter?” (Constantin Cavafis)
Un simple dûˋtroit sûˋpare Ithaque de Cûˋphalonie. On le franchit sur l’un des bateaux qui partent du port de Pisaetos, sur la cûÇte ouest d’Ithaque, et qui, mettant le cap vers l’ouest, accostent, une demi-heure plus tard, à Sami. La capitale, Argostoli, est situûˋe de l’autre cûÇtûˋ de l’ûÛle.
Une longue prûˋsence vûˋnitienne commune à toutes les ûÛles ioniennes, et qui ne s’acheva qu’au XVIIIe siû´cle, avait marquûˋ l’architecture de Cûˋphalonie. Argostoli fut belle et ûˋlûˋgante, à l’image de Corfou peut-ûˆtre. Il n’en reste rien : le terrible sûˋisme de 1953, qui toucha ûˋgalement Ithaque et Zante, l’a ûˋradiquûˋe d’un coup. Sa force fut telle qu’elle modifia jusqu’au relief de l’ûÛle. Le hasard avait amenûˋ Maurice Grandazzi à Argostoli quelques jours plus tûÇt. C’ûˋtait, ûˋcrira-t-il à son retour dans les Annales de gûˋographie, comme si une scie gûˋante fendait les rochers, comme si un train, dans un fracas qui s’amplifiait, franchissait sous terre un grand pont mûˋtallique, puis passait de l’autre cûÇtûˋ de l’ûÛle et s’enfonûÏait au cœur de la montagne. La nuit suivante, un vent violent se leva, la mer se fit houleuse, les chiens commencû´rent à hurler, les ûÂnes à braire, les coqs à chanter. La terre bougeait encore. Lorsque le jour se leva, les secousses reprirent de plus belle. La crûˆte des montagnes semblait se replier sur elle-mûˆme. “La terre ûˋclatait comme un fruit mû£r. Un nuage de poussiû´re, celui qui s’ûˋtait ûˋlevûˋ d’Argostoli abattue en quelques secondes comme un chûÂteau de cartes, retombait sur nous. L’obscuritûˋ devint telle qu’à 3 mû´tres l’un de l’autre, nous ne pouvions plus nous deviner. [?] Puis le soleil brilla de nouveau.” Argostoli n’existait plus. L’ûÛle de Solal n’ûˋtait qu’un champ de ruines. On compta les morts par centaines, et c’est par milliers que les habitants quittû´rent l’ûÛle.
Aujourd’hui, comme dans toutes les zones à risque, ceux qui y vivent encore composent entre fatalisme et crainte, sachant bien qu’à tout moment leur vie peut ûˆtre pulvûˋrisûˋe par un mouvement d’humeur venu des trûˋfonds de la terre. Ce fut de nouveau le cas en janvier 2014 lorsqu’un autre sûˋisme, heureusement de moindre importance, ravagea de nombreux bûÂtiments et jeta à la rue des centaines de familles.
En 1953, seule une poignûˋe de villages fut ûˋpargnûˋe par le cataclysme. Parmi eux, Fiskardo, à la pointe nord de l’ûÛle, se trouvait à l’opposûˋ de l’ûˋpicentre. C’ûˋtait un hameau de pûˆcheurs autour d’un petit port, à peine un Saint-Tropez, peut-ûˆtre, d’avant Brigitte Bardot, avec ce je-ne-sais-quoi qui enchante au premier regard. L’authenticitûˋ de tels lieux est toujours vouûˋe à la disparition : aprû´s les dûˋcouvreurs viennent les artistes, puis les yachts, puis les foules. Fiskardo n’a pas ûˋchappûˋ à la rû´gle. Dans les annûˋes 1960, les hippies en avaient fait leur repaire. Installûˋs dans la maisonnette du gardien de phare, ils grattaient sans faûÏon la guitare avec les villageois. Puis ils partirent, et c’est dans le cafûˋ de Kyria Irini, le premier kafûˋnio-ouzerie-taverne du port, que l’on continua à faire la fûˆte. D’autres cafûˋs et restaurants suivirent, dont celui des parents de Tasia Dendrinou, dans les annûˋes 1970. Tasia avait 12 ans. Le village n’avait pas l’ûˋlectricitûˋ, et pour se rendre à la capitale distante de 50 kilomû´tres, on mettait au minimum quatre heures !
Lorsqu’on la voit pour la premiû´re fois dans son restaurant, assise un peu à l’ûˋcart avec sa parûˋa, cheveux trû´s noirs, corpulence de bonne vivante, ûˋclats de rire explosifs et verbe haut, on sait d’emblûˋe qui, ici, est le maûÛtre. Tasia est une star, une Maû₤tûˋ grecque connue dans tout le pays pour ses ûˋmissions culinaires à la tûˋlûˋvision. Un caractû´re. Un personnage. Une Loxandra en terre ionienne.
Loxandra, la vraie, vivait à Constantinople au XIXe siû´cle. C’ûˋtait une femme du peuple dûˋbordante de vie et d’ûˋnergie, gûˋnûˋreuse, excellente cuisiniû´re, aimante, simple et forte. Sa petite-fille, la romanciû´re Maria Iordanidou, en fit le personnage central d’un roman qui connut un immense succû´s. Loxandra, devenue emblûˋmatique d’une ûˋpoque et d’un lieu, cristallisera toute la nostalgie des Grecs pour Constantinople et l’hellûˋnisme d’Asie Mineure, et deviendra une vûˋritable figure de la littûˋrature grecque.
Tout ce que Cûˋphalonie, rendue cûˋlû´bre par le film Capitaine Corelli, compte de cûˋlûˋbritûˋs – Tom Hanks, Giorgio Armani, Fernando Botero – se donne rendez-vous ici, à Fiskardo, chez Tasia. Cela ne la change ni ne l’impressionne. Avec les vedettes ou avec les inconnus, Tasia est Tasia, ronde, ouverte, gûˋnûˋreuse, truculente.
Le dernier soir de notre sûˋjour à Fiskardo, nous avions commandûˋ, à la fin du repas, un entremets à l’orange qui m’avait tant rûˋjouie que le lendemain matin, je me suis rûˋveillûˋe avec le souvenir de sa fraûÛcheur et l’obsession d’en connaûÛtre la recette. Nous habitions un hameau à quelques kilomû´tres du village, mais avant de partir, nous devions y passer pour faire des courses. Le port, à 10 heures du matin, ûˋmergeait à peine de sa lûˋthargie, mais Tasia ûˋtait dûˋjà là, campûˋe derriû´re ses fourneaux. Je doutais qu’elle me donne sa recette mais aprû´s tout? Les choses n’ont pas traûÛnûˋ : à peine ma requûˆte formulûˋe, je me suis retrouvûˋe propulsûˋe derriû´re les grandes marmites, prûˋcûˋdûˋe d’une Tasia pûˋremptoire : “Prenez ce papier ! Vous avez un stylo ? Écrivez !” Elle ûˋnumûˋrait : les oranges, le jus, le sucre, la cornflower? Elle dictait les proportions à toute vitesse, à moitiûˋ en grec, à moitiûˋ en anglais. Ce faisant, elle soulevait les couvercles et me prûˋsentait ce qu’elle mijotait dûˋjà pour le repas de midi, une ratatouille “faite avec les lûˋgumes que j’ai apportûˋs ce matin du jardin ! ûla Yanni ! Prends deux assiettes !? Je vais vous faire goû£ter. Asseyez-vous dehors !” Et nous voilà installûˋs devant deux grandes assiettes d’une ratatouille sublime, suivie de deux verres de liqueur maison. “Vous aimez ? Vous voulez la recette ??” »
(p. 243-249)
Un condensûˋ de l’histoire grecque (p. 21-26)
MaûÛtres d’œuvre, musiciens et bergers (p. 212-216)
Extrait court


