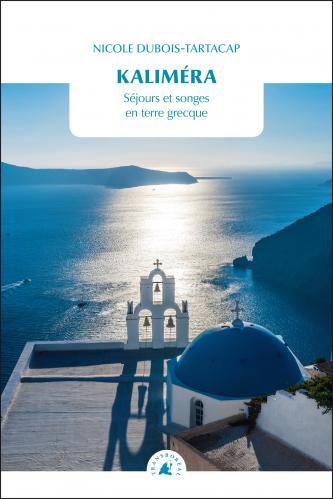
Un condensé de l’histoire grecque :
« Du pont du bateau, on voit se profiler, au loin, la courbe du port et la coupole blanche de la chapelle Saint-Nicolas, au bout de la jetée. Depuis le jour où j’ai découvert Égine – je n’avais pas 20 ans –, cette vue suscite toujours en moi la même émotion, le même sentiment de plénitude heureuse, l’impression d’arriver enfin “chez moi”. Je devine, à l’ombre de la chapelle, les pêcheurs courbés sur la masse jaune et orange de leurs filets, en train de les ravauder de leurs doigts épais avec des gestes étonnamment précis, silencieux, patients, visages penchés marqués par le soleil et le vent, âpres et beaux comme ce pays que j’aime.
Pourquoi choisir, pour débuter cette promenade grecque, une île peu touristique au point d’être bien souvent négligée des étrangers tout autant que des Grecs en vacances ? Peut-être parce qu’Égine est la première île grecque que j’ai connue, et même la première île, tout simplement, et que les premières fois sont toujours les plus belles. Certes, elle n’a pas la blancheur de Naxos ou de Paros, elle n’est pas aussi pittoresque qu’Hydra ou aussi spectaculaire que Santorin, ni aussi imposante que Rhodes ; elle n’a pas non plus la douceur de Cos ou de Samos, et pourtant, je n’ai pas oublié l’émotion ressentie lorsque, accoudée au bastingage, j’ai découvert, derrière la perfection de son port arrondi, les façades colorées des maisons néoclassiques et celle, toute blanche, de l’hôtel Brown, les palmiers, l’alignement des cafés et des boutiques, et, entourée d’arbres, la silhouette byzantine de la Panayitsa, avec son clocher carré et ses coupoles dominant le quai? De tout cela se dégageait une impression d’harmonie, de paix, de sérénité joyeuse.
Et puis il y eut la découverte du temple d’Aphaïa.
Je m’étais assise dans le bus du côté opposé au soleil, suivie de trois ou quatre vieilles femmes habillées de noir et flanquées de leurs paniers. C’était un bus poussiéreux, au confort rudimentaire. Au rétroviseur était accrochée toute une quincaillerie de porte-bonheur, mélange hétéroclite de médailles pieuses, pendeloques et komboloyia (ces chapelets n’ayant pour les Grecs aucune connotation religieuse), complétée par quelques icônes posées sur le tableau de bord. Était arrivé un groupe d’écoliers, bavards et rieurs comme tous les écoliers du monde, puis un vieillard qui s’était isolé tout au fond, et une famille de touristes allemands en route pour la plage. Vint alors un pope (mon premier !), longue barbe grisonnante et soutane d’une propreté douteuse, le tout surmonté d’un couvre-chef noir en forme de cylindre. On lui céda immédiatement une place qu’il accepta sans remercier, comme si on lui accordait son dû. À l’heure pile, le chauffeur avait mis le contact. Qui a dit que les autobus et les bateaux grecs ne partent jamais à l’heure ? Dans tous les déplacements, nombreux, que j’ai effectués par la suite, bateaux, autobus et cars ont toujours respecté les horaires à la minute près – sauf lorsqu’une tempête retardait un navire, bien sûr !
Le bus longea un moment la mer, dépassa une colonne dorique de marbre blanc surplombant, solitaire, une plage ombragée plantée d’eucalyptus et de tamaris, avant d’obliquer vers l’intérieur des terres. Le contrôleur passait de siège en siège, distribuait les tickets, collectait la monnaie et empilait les pièces dans un trieur métallique accroché à sa ceinture. Nous arrivions aux faubourgs d’Égine et aux premières plantations de pistachiers. Des murets de pierres sèches délimitaient les parcelles de terrain au sol sableux, légèrement grisâtre, minutieusement sarclé et irrigué. La route, étroite et sinueuse, traversait des hameaux dispersés. Ici, un petit pont enjambait un cours d’eau asséché. Plus loin, une énième chapelle (il y en a tant en Grèce, jusque dans le chaos des sommets rocailleux et déserts), toit rond bleu saphir surmonté d’une croix blanche, se lovait au creux d’un virage. Au fur et à mesure des arrêts, fréquents, le bus se délestait des écoliers, du couple, des vieilles et des paniers. “Fiyé !” (vas-y !), criait le contrôleur, et le bus repartait. Il descendait plus de voyageurs qu’il n’en montait. Nous avions maintenant dépassé le bourg de Mésagros. Au loin, le mont Oros s’affaissait en pente douce vers la mer. Bordée de yuccas et d’énormes figuiers de Barbarie dont les rameaux bardés d’épines, plats comme des raquettes, éclataient en une multitude de fleurs jaunes, la route dévoilait des paysages de collines plantées d’oliviers. Nous grimpions à présent à travers une forêt de pins. L’odeur de la résine envahit soudain l’espace. Plus tard, je retrouverais cette odeur si caractéristique dans le retsina – un vin qu’à ma connaissance on ne produit qu’en Grèce et certainement depuis l’Antiquité, lorsqu’on le conservait dans de grandes amphores dont on enduisait les parois de résine pour les rendre étanches. Plus tard, l’usage des tonneaux rendit ce procédé inutile, mais on prit l’habitude d’ajouter au moût quelques morceaux de gomme pour conserver au vin sa saveur particulière.
Dans certaines tavernes, ce vin blanc sec est encore tiré au tonneau et servi dans des pichets d’aluminium rouge ou doré. On en commande un kilo, un demi-kilo ou un quart de kilo. Servi très frais, c’est un régal? pour qui l’aime ! Pour les autres, légion y compris parmi les Grecs, son goût plus ou moins prononcé de résine le rend proprement imbuvable. “J’ai connu bon nombre de voyageurs, relatait Edmond About au milieu du XIXe siècle, qui rejetaient avec indignation leur première gorgée de vin résiné, et qui aimaient tout autant boire de la poix liquide. J’en ai vu beaucoup d’autres, sans me compter, qui s’accoutumaient à ce breuvage, très hygiénique du reste et qui, à force d’étude, parvenaient à faire abstraction de la résine et à deviner la saveur du vin sous ce malheureux déguisement.” Certes? Mais outre que mieux vaut ne pas trop rechercher la saveur d’un vin qui, bien souvent, est loin d’être exceptionnel, faire abstraction de la résine, c’est tout simplement ne pas aimer le retsina ! Pour ma part, je ne cherche pas à oublier ce bouquet, bien au contraire ! Car dès que j’approche de mes lèvres un verre de ce vin si étonnant, où que je sois et pour peu que je ferme les yeux, son parfum puis sa saveur m’imprègnent tout entière, me transportant d’un coup sur cette route d’Égine qui serpente au milieu des pins et conduit, au milieu d’un concert de cigales, au temple d’Aphaïa.
Au sommet de la colline, le bus marqua l’arrêt pour moi seule. Le temple était en cours de restauration. Il n’y avait ni gardien ni droit d’entrée? ni visiteurs ! La blancheur des colonnes cannelées éclatait sur un ciel d’un bleu sans faille. En contrebas, la mer s’étendait, lisse et calme, d’un bleu tout aussi absolu, jusqu’aux côtes de l’Attique. Peut-être est-ce à ce moment précis, dans la lumière tremblante et le silence immobile de ce jour d’été lointain, enveloppée de l’odeur des pins, que je suis tombée définitivement amoureuse de la Grèce et d’Égine. Pour et par Aphaïa.
Je suis restée là des heures. J’y suis revenue les jours suivants, seule toujours, et j’éprouvais dans la proximité du temple, adossée entre ses colonnes contre la fraîcheur de la pierre, une plénitude absolue. Patrick Leigh Fermor parle admirablement du message de paix qui survit dans les ruines des anciens temples grecs, lorsque, au milieu des chapiteaux écroulés, on laisse le temps s’écouler et son esprit se vider. Alors, dit-il, “une sorte de rayonnement, un sentiment de calme prend sa place [?]. Il semble suggérer que toute vie, lorsqu’on la laisse se déployer sans obstacle et sans contrainte, [?] peut s’écouler infiniment heureuse.”
Par la suite, le site a été aménagé. Le terrain a été clôturé, l’accès au temple a été filtré par un gardien, les touristes sont venus. Alors, ayant perdu cette intimité première qui m’avait liée à lui, je m’en suis éloignée. Infidèle, je l’ai remplacé par les vestiges de la ville abandonnée de Palaiochora, petite Mystra discrète posée sur une colline, entre la ville d’Égine et le temple. »
Maîtres d’œuvre, musiciens et bergers (p. 212-216)
Ithaque, Céphalonie (p. 243-249)
Extrait court
« Du pont du bateau, on voit se profiler, au loin, la courbe du port et la coupole blanche de la chapelle Saint-Nicolas, au bout de la jetée. Depuis le jour où j’ai découvert Égine – je n’avais pas 20 ans –, cette vue suscite toujours en moi la même émotion, le même sentiment de plénitude heureuse, l’impression d’arriver enfin “chez moi”. Je devine, à l’ombre de la chapelle, les pêcheurs courbés sur la masse jaune et orange de leurs filets, en train de les ravauder de leurs doigts épais avec des gestes étonnamment précis, silencieux, patients, visages penchés marqués par le soleil et le vent, âpres et beaux comme ce pays que j’aime.
Pourquoi choisir, pour débuter cette promenade grecque, une île peu touristique au point d’être bien souvent négligée des étrangers tout autant que des Grecs en vacances ? Peut-être parce qu’Égine est la première île grecque que j’ai connue, et même la première île, tout simplement, et que les premières fois sont toujours les plus belles. Certes, elle n’a pas la blancheur de Naxos ou de Paros, elle n’est pas aussi pittoresque qu’Hydra ou aussi spectaculaire que Santorin, ni aussi imposante que Rhodes ; elle n’a pas non plus la douceur de Cos ou de Samos, et pourtant, je n’ai pas oublié l’émotion ressentie lorsque, accoudée au bastingage, j’ai découvert, derrière la perfection de son port arrondi, les façades colorées des maisons néoclassiques et celle, toute blanche, de l’hôtel Brown, les palmiers, l’alignement des cafés et des boutiques, et, entourée d’arbres, la silhouette byzantine de la Panayitsa, avec son clocher carré et ses coupoles dominant le quai? De tout cela se dégageait une impression d’harmonie, de paix, de sérénité joyeuse.
Et puis il y eut la découverte du temple d’Aphaïa.
Je m’étais assise dans le bus du côté opposé au soleil, suivie de trois ou quatre vieilles femmes habillées de noir et flanquées de leurs paniers. C’était un bus poussiéreux, au confort rudimentaire. Au rétroviseur était accrochée toute une quincaillerie de porte-bonheur, mélange hétéroclite de médailles pieuses, pendeloques et komboloyia (ces chapelets n’ayant pour les Grecs aucune connotation religieuse), complétée par quelques icônes posées sur le tableau de bord. Était arrivé un groupe d’écoliers, bavards et rieurs comme tous les écoliers du monde, puis un vieillard qui s’était isolé tout au fond, et une famille de touristes allemands en route pour la plage. Vint alors un pope (mon premier !), longue barbe grisonnante et soutane d’une propreté douteuse, le tout surmonté d’un couvre-chef noir en forme de cylindre. On lui céda immédiatement une place qu’il accepta sans remercier, comme si on lui accordait son dû. À l’heure pile, le chauffeur avait mis le contact. Qui a dit que les autobus et les bateaux grecs ne partent jamais à l’heure ? Dans tous les déplacements, nombreux, que j’ai effectués par la suite, bateaux, autobus et cars ont toujours respecté les horaires à la minute près – sauf lorsqu’une tempête retardait un navire, bien sûr !
Le bus longea un moment la mer, dépassa une colonne dorique de marbre blanc surplombant, solitaire, une plage ombragée plantée d’eucalyptus et de tamaris, avant d’obliquer vers l’intérieur des terres. Le contrôleur passait de siège en siège, distribuait les tickets, collectait la monnaie et empilait les pièces dans un trieur métallique accroché à sa ceinture. Nous arrivions aux faubourgs d’Égine et aux premières plantations de pistachiers. Des murets de pierres sèches délimitaient les parcelles de terrain au sol sableux, légèrement grisâtre, minutieusement sarclé et irrigué. La route, étroite et sinueuse, traversait des hameaux dispersés. Ici, un petit pont enjambait un cours d’eau asséché. Plus loin, une énième chapelle (il y en a tant en Grèce, jusque dans le chaos des sommets rocailleux et déserts), toit rond bleu saphir surmonté d’une croix blanche, se lovait au creux d’un virage. Au fur et à mesure des arrêts, fréquents, le bus se délestait des écoliers, du couple, des vieilles et des paniers. “Fiyé !” (vas-y !), criait le contrôleur, et le bus repartait. Il descendait plus de voyageurs qu’il n’en montait. Nous avions maintenant dépassé le bourg de Mésagros. Au loin, le mont Oros s’affaissait en pente douce vers la mer. Bordée de yuccas et d’énormes figuiers de Barbarie dont les rameaux bardés d’épines, plats comme des raquettes, éclataient en une multitude de fleurs jaunes, la route dévoilait des paysages de collines plantées d’oliviers. Nous grimpions à présent à travers une forêt de pins. L’odeur de la résine envahit soudain l’espace. Plus tard, je retrouverais cette odeur si caractéristique dans le retsina – un vin qu’à ma connaissance on ne produit qu’en Grèce et certainement depuis l’Antiquité, lorsqu’on le conservait dans de grandes amphores dont on enduisait les parois de résine pour les rendre étanches. Plus tard, l’usage des tonneaux rendit ce procédé inutile, mais on prit l’habitude d’ajouter au moût quelques morceaux de gomme pour conserver au vin sa saveur particulière.
Dans certaines tavernes, ce vin blanc sec est encore tiré au tonneau et servi dans des pichets d’aluminium rouge ou doré. On en commande un kilo, un demi-kilo ou un quart de kilo. Servi très frais, c’est un régal? pour qui l’aime ! Pour les autres, légion y compris parmi les Grecs, son goût plus ou moins prononcé de résine le rend proprement imbuvable. “J’ai connu bon nombre de voyageurs, relatait Edmond About au milieu du XIXe siècle, qui rejetaient avec indignation leur première gorgée de vin résiné, et qui aimaient tout autant boire de la poix liquide. J’en ai vu beaucoup d’autres, sans me compter, qui s’accoutumaient à ce breuvage, très hygiénique du reste et qui, à force d’étude, parvenaient à faire abstraction de la résine et à deviner la saveur du vin sous ce malheureux déguisement.” Certes? Mais outre que mieux vaut ne pas trop rechercher la saveur d’un vin qui, bien souvent, est loin d’être exceptionnel, faire abstraction de la résine, c’est tout simplement ne pas aimer le retsina ! Pour ma part, je ne cherche pas à oublier ce bouquet, bien au contraire ! Car dès que j’approche de mes lèvres un verre de ce vin si étonnant, où que je sois et pour peu que je ferme les yeux, son parfum puis sa saveur m’imprègnent tout entière, me transportant d’un coup sur cette route d’Égine qui serpente au milieu des pins et conduit, au milieu d’un concert de cigales, au temple d’Aphaïa.
Au sommet de la colline, le bus marqua l’arrêt pour moi seule. Le temple était en cours de restauration. Il n’y avait ni gardien ni droit d’entrée? ni visiteurs ! La blancheur des colonnes cannelées éclatait sur un ciel d’un bleu sans faille. En contrebas, la mer s’étendait, lisse et calme, d’un bleu tout aussi absolu, jusqu’aux côtes de l’Attique. Peut-être est-ce à ce moment précis, dans la lumière tremblante et le silence immobile de ce jour d’été lointain, enveloppée de l’odeur des pins, que je suis tombée définitivement amoureuse de la Grèce et d’Égine. Pour et par Aphaïa.
Je suis restée là des heures. J’y suis revenue les jours suivants, seule toujours, et j’éprouvais dans la proximité du temple, adossée entre ses colonnes contre la fraîcheur de la pierre, une plénitude absolue. Patrick Leigh Fermor parle admirablement du message de paix qui survit dans les ruines des anciens temples grecs, lorsque, au milieu des chapiteaux écroulés, on laisse le temps s’écouler et son esprit se vider. Alors, dit-il, “une sorte de rayonnement, un sentiment de calme prend sa place [?]. Il semble suggérer que toute vie, lorsqu’on la laisse se déployer sans obstacle et sans contrainte, [?] peut s’écouler infiniment heureuse.”
Par la suite, le site a été aménagé. Le terrain a été clôturé, l’accès au temple a été filtré par un gardien, les touristes sont venus. Alors, ayant perdu cette intimité première qui m’avait liée à lui, je m’en suis éloignée. Infidèle, je l’ai remplacé par les vestiges de la ville abandonnée de Palaiochora, petite Mystra discrète posée sur une colline, entre la ville d’Égine et le temple. »
(p. 21-26)
Maîtres d’œuvre, musiciens et bergers (p. 212-216)
Ithaque, Céphalonie (p. 243-249)
Extrait court


