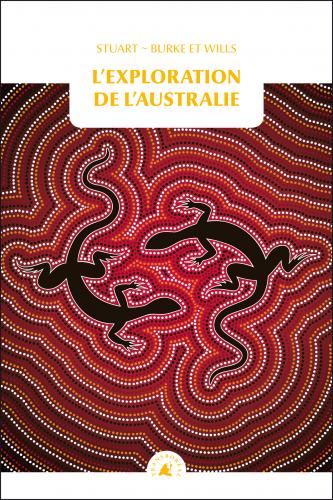
Exploration de l’Australie (L’), Précédé de « Aventures dans le continent austral »
Robert O’Hara Burke, John McDouall Stuart & John Wills
En 1861 est accompli l’un des plus audacieux voyages entrepris par voie terrestre dans l’hémisphère Sud : Robert O’Hara Burke et William John Wills, après des mois de marche et de privations, achèvent la première traversée sud/nord de l’Australie. L’exploit est toutefois terni par la mort des deux Britanniques lors du retour. L’année suivante, l’Écossais John McDouall Stuart réussit à son tour la traversée, selon un autre axe. De ces odyssées concurrentes, L’Exploration de l’Australie retient les moments remarquables, extraits des carnets de route de l’époque : la progression vers le « Centre rouge », la rencontre avec les Aborigènes, la faim, la soif, la solitude et l’absence d’échappatoire au milieu du bush, l’émotion, enfin, lorsque sont atteints les rivages de l’océan Indien. Une introduction d’Henri Blerzy précède ces aventures en les resituant dans l’histoire générale de l’exploration du sous-continent.
Avec le soutien de : Ambassade d’Australie à Paris
Traduit de l’anglais par : Dominique Boniface,Louis Chapalay
Avec une préface par : François Lantz
« L’année 1861 est fondamentale dans l’histoire de l’exploration. C’est en 1861, en effet, que l’un des voyages les plus audacieux jamais entrepris par voie terrestre dans l’hémisphère Sud fut accompli. Cette année-là, Robert O’Hara Burke, William John Wills et deux autres compagnons réussirent, après des mois de marche et de privations, la première traversée sud/nord de l’Australie, entre Melbourne et le golfe de Carpentarie. L’exploit – plus de 2 000 kilomètres à travers des contrées inexplorées – fut toutefois terni par la mort de trois des quatre explorateurs lors du voyage de retour.
La même année, suivant un itinéraire différent (entre Adélaïde et Darwin), John McDouall Stuart échouait dans sa deuxième tentative. Obligé de renoncer à cause du manque d’eau et de vivres qui menaçait l’expédition, il allait tout de même marquer l’histoire en devenant le premier Européen à atteindre le centre du sous-continent et en rééditant, en 1862, l’exploit de Burke et Wills, sans déplorer aucune perte humaine.
Ces deux expéditions, concurrentes à bien des égards, n’ont pas seulement tenu en haleine les amateurs de courses vers l’inconnu, elles ont aussi permis de résoudre quelques-unes des grandes énigmes géographiques du XIXe siècle, notamment la question de savoir s’il existait une mer intérieure au centre du sous-continent. Stuart, Burke et Wills sont aujourd’hui considérés comme des héros et des figures majeures de l’exploration en Australie. Leurs carnets révèlent des personnalités hors du commun – courageuses, déterminées, mais plus ou moins prêtes à affronter les périls du désert central –, et leur histoire rappelle avec un demi-siècle d’avance celle de Scott et Amundsen au pôle Sud.
Si la découverte et la reconnaissance des côtes australiennes ont déjà fait l’objet de nombreuses publications en France, en raison de la participation de navigateurs français à cette aventure maritime, l’exploration de l’intérieur du sous-continent reste pour le public français un chapitre méconnu de l’histoire des voyages. Pour combler cette lacune, les éditions Transboréal ont entrepris de réunir pour la première fois des extraits des carnets de Stuart et les notes retrouvées de Burke et Wills après leur tragique expédition de 1860-1861. Au-delà de leur intérêt historique, ces textes forment le cœur d’une impressionnante épopée. Un texte introductif d’Henri Blerzy, paru dans la Revue des Deux Mondes en 1864, resitue d’abord ces différents voyages dans l’histoire plus générale de l’exploration de l’Australie. Récit de gloires, de désastres et de désillusions, l’article de Blerzy donne la mesure des difficultés auxquelles était confrontée toute expédition qui envisageait de pénétrer à l’intérieur du “continent austral” au XIXe siècle. Ces difficultés se retrouvent bien sûr, plus vives que jamais, dans les récits des expéditions de Stuart et de Burke et Wills. Il ne fallut d’ailleurs pas moins de trois tentatives à Stuart – sans compter deux excursions préparatoires – pour réussir à traverser le sous-continent. De ces trois voyages, L’Exploration de l’Australie propose les moments les plus remarquables : la progression vers le “Centre rouge” (1860), la rencontre avec des Aborigènes et le conflit qui s’ensuivit (1860), la faim, la soif, la solitude et l’impossibilité de trouver une échappatoire au milieu du bush (1861), l’émotion, enfin, lorsque l’expédition atteint les rivages de l’océan Indien, le 25 juillet 1862. En proposant de longs extraits des trois grands voyages de Stuart, ainsi que les notes retrouvées de Burke et Wills, ce recueil offre pour la première fois en langue française le fabuleux récit de la traversée sud/nord du sous-continent.
Ce projet n’aurait pu aboutir sans le soutien de l’ambassade d’Australie en France ni l’intérêt qu’il a suscité auprès de son attachée culturelle, Harriet O’Malley. Qu’elles en soient ici remerciées, ainsi que la rédaction de la Revue des Deux Mondes, particulièrement sa directrice, Valérie Toranian, et Aurélie Julia, de nous avoir ouvert ses archives. »
Introduction par : Henri Blerzy
Établissement du texte par : François Lantz
Rédaction des notes par : François Lantz
Avec une postface par : Eddie Mittelette
« Une mémoire volée
La majorité des livres et des archives traitant de l’histoire australienne, parus jusqu’à l’aube du XXIe siècle, dépeignent un établissement britannique glorieux et pacifique, sur une terre inoccupée, sans heurts majeurs. Dans les écoles, l’histoire fut longtemps narrée comme une saga héroïque, dans laquelle de courageux explorateurs et pionniers sacrifièrent corps et âme à la nation. Leur vie était faite de labeur, d’un combat contre leur seul et unique ennemi : la nature. Les enseignants expliquaient parfois aux écoliers que les “sauvages” qui peuplaient le bush avaient davantage en commun avec la faune qu’avec l’espèce humaine ; que ces êtres “laids et inoffensifs” ne s’opposèrent que mollement à la colonisation ; ce qui justifiait sans doute leur incapacité à vivre dans des maisons ! Somme toute, les valeurs patriotiques que l’on trouvait admirables, qu’une partie des citoyens remettait en cause, conditionnèrent le discernement de plusieurs générations d’Australiens. Ces principes se retrouvaient autant dans les livres qu’à la télévision ou à la radio, et cette période n’est qu’à un jet de pierre de nous?
Si le mythe d’une Terra nullius séduit toujours un certain nombre d’adeptes, il fonda les bases d’une société brutale, qui souffre d’un déni endémique et persistant à l’égard des Aborigènes. Solidement ancrée dans la conscience collective, cette croyance récuse implicitement tout idéal de conquête, et ce, depuis la promulgation, en 1788, de la colonie pénitentiaire de la Nouvelle-Galles du Sud. Effectivement, le fait de désigner l’invasion qui eut lieu comme un simple “établissement” fut un moyen de refuser toute légitimité aux autochtones que l’on spoliait. D’ailleurs, aucun traité ne fut signé entre les deux partis. Car le style de vie nomade ne constituait pas, pour les Européens, un titre de propriété du sol. Les raisons principales qui furent avancées résident dans l’absence d’habitat permanent, mais aussi dans la foi profonde que les Aborigènes étaient inaptes à tirer profit de la terre, compte tenu de l’inexistence de pratiques agricoles – deux préalables à l’occupation tangible d’un territoire, selon les Occidentaux.
Par la suite, les études archéologiques tordirent le cou à ces constatations. Si leur culture différait de la nôtre, les Aborigènes avaient adopté en revanche une gestion durable des ressources, grâce notamment aux brûlis sur Spinifex – la graminée épineuse et très répandue était un cauchemar pour les explorateurs, mais elle fournissait à la fois les graines pour la confection du nardoo et, après transformation, une colle puissante pour les outils et les armes. Outre la fumée, qui facilitait la communication à distance, les feux de broussaille et d’herbe sèche permettaient à la nature de se régénérer et aux végétaux chétifs de reverdir. Le brûlis favorisait aussi la capture d’animaux. Les flammes chassaient les reptiles de leurs terriers tandis que le gros gibier se retrouvait piégé. À l’heure actuelle, cette pratique – vécue par Stuart comme inutile et provocatrice – est toujours utilisée. Ainsi, il est prouvé que, sans l’occupation indigène, des espèces animales comme le bilby auraient disparu de certaines zones désertiques. Un constat émaillé d’ironie lorsque l’on songe à la responsabilité des colons dans la destruction des écosystèmes tels que les forêts primaires, dans tout le sous-continent.
Dans le cas des habitations, le récit de Burke et Wills dément le discours colonial avec l’existence des gunyah. Tous les Aborigènes érigeaient ces abris, recouverts d’écorce de gommier ou de branchages et de Spinifex. La présence de fondations, et donc d’habitats semi-sédentaires, était davantage répandue chez les peuples des lacs et des rivières, en raison d’une nourriture abondante et accessible : les Gunditjmara s’abritaient sous des cabanes basses en pierre volcanique, dont on retrouve aujourd’hui les vestiges, aux abords du lac Condah, dans le sud-ouest de l’État du Victoria.
Les prémices de la colonie et les massacres perpétrés à l’encontre des Aborigènes donnent un éclairage sur le rapport ambigu qu’entretient l’Australie avec son histoire – du moins, ces événements permettent-ils de comprendre les raisons qui poussèrent les historiens à réécrire le grand roman national en cultivant le mythe de l’installation pacifique.
Le premier d’une longue série d’assassinats de masse prit place sur les rives de la baie Botany, au sud de l’actuelle Sydney, lieu du débarquement de la “première flotte” qui fut menée en 1788 par le gouverneur Arthur Phillip. Guère plus de cinquante années suffirent aux colons pour faire passer la tribu qui y vivait de quatre cents âmes à seulement quatre, sous l’effet combiné des maladies importées, de l’alcool – les Aborigènes n’en distillaient pas ! – et des nombreux meurtres. Les tribus voisines subirent un sort analogue à mesure que l’occupation de la Nouvelle-Galles du Sud progressait et que la Couronne cédait des terres cultivables aux prisonniers affranchis.
Bien qu’il existât des cas où les relations cordiales prévalaient, les conflits entre fermiers et autochtones demeuraient constitutifs de la vie quotidienne. La loi britannique s’appliquait cependant peu ou prou à mesure que l’on s’éloignait des villages. L’isolement offrait une impunité relative, voire un permis de tuer. La justice fermait les yeux sur les exactions commises si les indigènes se montraient agressifs ou menaçaient l’intégrité des stations d’élevage – selon les dires des propriétaires terriens, dont la parole était rarement remise en cause. D’ailleurs, leur réponse à cette prétendue menace était disproportionnée face aux Aborigènes qui, en représailles, se vengeaient des brutalités ou des viols commis sur leurs femmes. Dans certains cas, des conflits éclatèrent à la suite du prélèvement d’un simple mouton ou d’un bœuf, car les zones de pâture empiétaient sur les territoires de chasse traditionnels, privant les groupes de leur unique moyen de subsistance. La mort d’un seul Blanc, fût-il coupable, pouvait entraîner l’extermination de plusieurs dizaines de Natifs, sans distinction d’âge ni de sexe. La lance et le killing stick ne faisaient pas le poids face aux fusils. Dans la majorité des cas, les heurts s’achevaient dans un bain de sang.
Selon les estimations fondées sur les documents officiels, pas moins de 20 000 Aborigènes périrent par le simple fait de la présence européenne, et ce, avant la proclamation des États fédéraux, en 1901. Postérieurement, les massacres se poursuivirent et d’autres victimes s’ajoutèrent à ce constat sous-évalué. Parmi les pires tueries, celles de Forrest River (1926) et de Coniston (1928), qui firent plus tard l’objet d’ouvrages historiques par Bruce Elder, Neville Green, Geoffrey Bolton, Bill Wilson et Justin O’Brien – pour ne citer qu’eux. Le massacre de Forrest River, sur le plateau de Kimberley, fut une réponse excessive au meurtre d’un bouvier blanc par un vieil Aborigène, qui eut pour seul tort de se défendre. L’expédition punitive qui s’ensuivit causa des centaines de morts chez les Gadjerong, Djangada, Wurangangari et Wiladjau. Le massacre de Coniston, dans le Territoire du Nord, fut lui aussi causé par le décès d’un Blanc, un chasseur de dingos. Il y eut près de 170 victimes parmi les Warlpiri, Kaytetye et Anmatyerre. Cette affaire fut l’une des dernières à être sanctionnées par la justice, qui condamna les coupables? avant de les acquitter.
Persuadés de détenir un droit de vie ou de mort sur les Noirs, et que leurs actes ne relevaient pas de l’illégalité, les auteurs d’assassinats se vantaient de leurs méfaits dans la presse et les pubs. Sans exprimer de remords, ils livraient même des détails sorbides afin de distraire leur auditoire, signe manifeste que le sentiment d’impunité était prégnant dans la société. Un recensement non exhaustif des conflits indique que chaque arpent de territoire colonisé est taché du sang de son peuple. Néanmoins, il est difficile d’évaluer, de manière précise, l’ampleur des meurtres depuis le massacre tristement fameux de Myall Creek, qui eut lieu en juin 1838, à 600 kilomètres au nord-est de Sydney (à ne pas confondre avec l’hydronyme situé en Australie-Méridionale, que Stuart traversa lors de sa quatrième expédition, le 22 mars 1860). Cet événement marqua un tournant dans l’histoire australienne, tant dans la manière qu’eurent les journaux de relater l’actualité que dans l’attitude de la population vis-à-vis des Aborigènes.
Les faits se déroulèrent dans une station proche de Myall Creek. Une quarantaine de membres de la tribu kwiambal avait installé un camp provisoire, dans l’intention d’effectuer des travaux fermiers en échange de denrées alimentaires. Les relations avec les travailleurs blancs y étaient amicales de longue date. Puis, sans raison apparente, les Kwiambal furent la cible d’une expédition punitive ourdie par onze bushmen. Mus par un esprit de revanche aveugle, ces hommes pourchassaient un groupe aborigène dont ils ignoraient tout, mais qu’ils tenaient pour responsable du détournement d’un troupeau plus au sud. Bien armés, et sans aucune forme de procès, ils capturèrent puis exécutèrent vingt-huit Kwiambal. Hommes, femmes, enfants et vieillards furent décapités, démembrés puis brûlés. Les jours suivants, les autres membres de la tribu, qui s’étaient enfuis, furent retrouvés et froidement abattus.
L’affaire se répandit dans la colonie comme une traînée de poudre. Face à pareille brutalité, George Gipps, le gouverneur de la Nouvelle-Galles du Sud, saisit l’opportunité de renforcer son autorité au travers de la loi britannique, qui ne trouvait plus suffisamment d’écho dans les zones reculées. Pourtant, la majorité des citoyens de la Nouvelle-Galles du Sud se rangèrent du côté des bushmen, estimant qu’un Blanc, eût-il des antécédents judiciaires, ne pouvait être condamné pour le meurtre d’un Noir. Malgré la pression de l’opinion générale, la justice rendit un verdict inédit, au terme d’une série de rebondissements qui tinrent la colonie en haleine : parmi les onze meurtriers, sept furent condamnés à la pendaison.
La sentence prononcée créa un véritable précédent et eut des répercussions durant les cinquante années qui suivirent. Dissuadés par la menace des condamnations à la peine capitale, les citoyens désireux d’appliquer eux-mêmes la loi ne firent plus étalage de leurs sombres exploits. La plupart des massacres qui eurent lieu postérieurement à celui de Myall Creek ne furent ni relayés ni consignés dans les registres. Ils devinrent clandestins et commis sous des prétextes fallacieux. Sous couvert de la régulation des populations de dingos, des Aborigènes furent empoisonnés massivement à l’aide d’appâts disséminés dans le bush – ce qui a entraîné une grande méfiance à l’égard des Blancs lors des explorations tardives du continent.
Un autre effet pervers de l’application systématique de la loi fut la création, dès 1839, d’une “police des frontières” ; puis, en 1848, de brigades indigènes connues sous le nom de Native Police. Composées d’Aborigènes, elles étaient destinées à punir le détournement d’animaux et à rétablir l’ordre dans les zones isolées. L’ambition de telles forces reposait sur le talent inégalable des pisteurs noirs. Pourvu qu’il disposât d’un cheval, d’un uniforme, d’un fusil et de nourriture en abondance, on présumait qu’un Aborigène serait plus efficace qu’un Européen pour retrouver la trace de ses semblables – mais de tribus différentes – puis, le cas échéant, de les “disperser”. Il s’agissait bien là de dispersion des corps? Ce terme, empreint de cynisme, reflète la barbarie qui caractérisait ces épisodes sanglants de la colonisation. Rétive à consigner ses assassinats, la Native Police était réputée pour sa cruauté et son sadisme, et sa simple évocation suffisait à instiller l’effroi parmi les populations indigènes.
Qu’elle découle de la honte ou de l’omission, délibérée ou inconsciente, l’invisibilité des Aborigènes dans les récits historiques, entre 1900 et 1960, traduit la volonté de masquer le véritable visage de la nation, de reléguer cette question à la seule époque coloniale pour ne plus être contraint d’y répondre. Le culte de l’oubli est une composante du début du XXe siècle, qui coïncide avec l’émergence du patriotisme qui accompagna la Fédération de 1901. Les historiens nationalistes furent plus enclins à louer l’héroïsme des pionniers qu’à soulever les problèmes éthiques du processus de colonisation. Ainsi, les citoyens furent privés des éléments de réflexion permettant de saisir la complexité de leur relation avec les Aborigènes. “Le mal est fait, il faut oublier et passer à autre chose” : tel est le sentiment qui perdure dans l’Australie contemporaine, n’en déplaise aux voix humanistes qui s’amplifient et retentissent au-delà des frontières. Ce rejet latent explique la reconnaissance tardive des Aborigènes avec leur inscription dans la constitution. Le gouvernement consentit à leur attribuer la citoyenneté à l’occasion du référendum national du 27 mai 1967, ce qui lui permit par la suite de légiférer librement sur leur sort.
En revanche, davantage de temps fut nécessaire à la société pour dépasser les doctrines que les manuels scolaires avaient ancrées dans les esprits. Peut-être prendra-t-elle la mesure, en affrontant son passé, de la contribution colossale qu’apportèrent les Aborigènes à l’économie moderne. Sa richesse et son mode de vie furent acquis comme une conséquence directe de la dépossession des autochtones – souvent au prix de leurs existences : ils guidèrent les explorateurs ; ils servirent dans l’armée australienne durant les deux guerres mondiales ; ils s’employèrent comme plongeurs dans l’industrie de la perle et des holothuries (concombres de mer) dans le nord-ouest du continent ; ils furent domestiques, bouviers et ouvriers agricoles dans les fermes isolées du bush ; ils assistèrent la police comme pisteurs. Recevant de la farine, du sucre et du tabac pour tout salaire.
Malgré cela, la société s’approprie les codes de la culture qu’elle a soumise, et n’hésite pas à se réclamer de l’héritage indigène en lui empruntant ses mots, ses symboles et ses motifs. Ses efforts investis dans la valorisation des arts aborigènes donnent l’illusion d’un multiculturalisme apaisé. Il s’agit là d’une démarche contradictoire, destinée au renfort de l’identité australienne, qui vise surtout à redorer son image et à la sortir de l’ombre que projette toujours sur elle l’Empire britannique.
Sans réellement y parvenir, l’Australie tente de faire oublier ses politiques d’assimilation successives. Elle peine notamment à gérer les conséquences de plus d’un siècle de génocide, dénoncé en 1997 par le rapport Bringing them home de la Commission des droits de l’homme, connu sous le nom de stolen générations – “générations volées”. De 1869 à 1970, les enfants métis, issus de pères européens et de mères aborigènes, furent officiellement retirés de force et enfermés dans des institutions gouvernementales et religieuses. On les supposait instables, attardés et physiquement déficients. Selon leur sexe, ils étaient formés à devenir des domestiques ou de la main-d’œuvre mais subissaient brimades et violences sexuelles régulières. Ces mesures eugénistes, destinées à l’origine à les “détribaliser” afin de leur offrir un avenir, laissèrent des blessures profondes au sein d’une population aborigène qui, aujourd’hui encore, ne parvient pas à s’en relever. Selon les estimations, entre 50 000 et 100 000 enfants furent ainsi contraints de renier leurs racines et, pour la plupart, ne revirent jamais leur famille. L’éminent historien Henry Reynolds leur a consacré son ouvrage Nowhere People, dans lequel il porte un regard perspicace sur le processus institutionnalisé d’acculturation des “sang-mêlé”. En dépit des excuses nationales, prononcées en 2008 par le Premier ministre travailliste Kevin Rudd, le Département des services communautaires (DOCS) procède toujours au retrait d’enfants, dans des proportions inédites, lorsqu’il considère les familles inaptes à les éduquer. Ainsi, le nombre d’enlèvements serait supérieur de nos jours à celui de la période des “générations volées”.
Les conséquences de tels traitements, conjuguées au chômage et à l’apartheid systémique, précipitent les Aborigènes, reclus dans les faubourgs, dans un désœuvrement considérable. Leurs conditions de vie sont souvent alarmantes et l’accès aux logements décents, aux soins et à l’éducation est entravé par l’immobilisme politique. En outre, la jeunesse est durement touchée. Dénués de repères et de perspectives d’avenir, des adolescents, pour desserrer l’étau du désespoir, se noient dans l’alcool, se droguent, reniflent de l’essence – le petrol sniffing est si répandu que BP Australia a développé en 2005 l’OPAL, un carburant peu volatil et à faible teneur aromatique, que le gouvernement a imposé dans l’arrière-pays pour endiguer le fléau. Pareillement, le peuple aborigène détient le triste record mondial de suicides juvéniles – le taux est en constante augmentation. Il n’est par rare que des Aborigènes s’ôtent la vie dès l’âge de 8 ans, du fait des violences familiales ou sociales et du traumatisme transgénérationnel.
D’autre part, leur incarcération est permise par la loi, parfois pour de menus larcins. À l’échelle du pays, les enfants aborigènes, âgés de 10 à 17 ans, sont 24 fois plus susceptibles d’être emprisonnés que les jeunes Australiens – le ratio s’élève à 52 pour l’État d’Australie-Occidentale. S’ajoutant aux nombreux cas de décès d’adultes en garde à vue, de récents événements survenus dans le Territoire du Nord ont dévoilé la pratique de la torture, au sein du centre de détention juvénile de Don Dale. L’affaire a déclenché l’émoi sur tout le continent et a bénéficié d’un traitement médiatique international. Avec le monde pour témoin, cette énième dérive doit exhorter l’Australie à réenvisager les questions de discrimination raciale et d’autodétermination.
Bien que ces événements ne laissent guère entrevoir de meilleurs lendemains, ils ne doivent en revanche pas masquer les actions positives que mènent les Aborigènes, parfois avec le soutien d’organisations non gouvernementales. Des programmes sont mis en place, en particulier dans les régions reculées, afin de favoriser la transmission des savoirs traditionnels entre les Aînés et une jeunesse de plus en plus attirée par les chimères de la société de consommation. Cela se traduit, d’une part, par l’initiation des jeunes à leur culture, en lien direct avec le milieu naturel. D’autre part, par la formation de rangers issus des communautés, qui ont pour mission d’entretenir les zones désertiques et leurs écosystèmes. Ces emplois valorisants permettent aux familles d’acquérir leur indépendance vis-à-vis des subsides de l’État, mais également de vivre près de leur lieu de naissance et d’y célébrer les cérémonies. De plus, ils jouent un rôle primordial dans la cohésion communautaire.
Sur le plan politique, un nombre croissant d’hommes et de femmes indigènes siège dans les gouvernements locaux, au parlement fédéral ou à la chambre des députés. Bien que les Aborigènes composent 3 % de la population australienne, ils ne sont toujours pas représentés en conséquence. Malgré tout, leur voix pèse davantage sur les décisions qui les concernent, notamment depuis l’adoption du Native Title Act. Cette loi, votée en 1993 à la suite de l’affaire Eddie Mabo, permet aux peuples dépossédés de réclamer leurs terres et d’obtenir, au terme d’un âpre combat judiciaire, un acte de propriété conditionnel. Au-delà de ces restitutions de bon augure, des débats en faveur de l’autodétermination sont en cours, et l’issue pourrait mener à la signature d’un traité.
Enfin, le domaine culturel est celui dans lequel les Aborigènes trouvent un écho à travers le monde. Bien que leur desert reggae demeure méconnu, des artistes comme le guitariste et chanteur Geoffrey Gurrumul Yunupingu, fondateur du groupe Yothu Yindi, s’imposent sur la scène world music. Des poètes et des écrivains tels Kath Walker, Kim Scott, Alexis Wright ou Mudrooroo font entendre la voix de leur peuple dans une littérature de premier plan. Des réalisateurs et des acteurs de talent, à l’image de David Gulpilil, produisent un cinéma militant de qualité : leurs films concourent dans de prestigieux festivals et remportent de nombreux prix. Pareillement, la peinture aborigène fait l’objet d’expositions dans les galeries des capitales mondiales, en particulier les œuvres d’artistes de la Terre d’Arnhem et du désert de l’Ouest. Souhaitons que ce rayonnement international et l’émergence de leaders politiques suscite un sursaut des consciences dans la société, au regard des outrages passés et présents, vers une souveraineté aborigène. »


