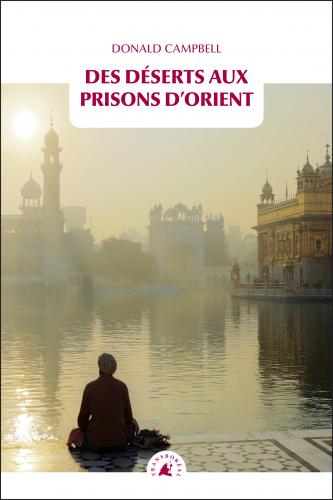
Chapitre IX – Traitements amers :
« On me fit bientôt reparaître devant le même officier qui m’avait déjà intimé les intentions d’Hyat Sahib. Il me demanda si j’avais réfléchi à l’importance des offres qu’il m’avait faites et aux suites qu’un refus obstiné de ma part pourrait avoir. Il me représenta que ce n’était point une médiocre faveur qu’un emploi qui mettait cinq mille hommes sous mes ordres et que les premiers rajahs de l’empire seraient jaloux de posséder.
Je répondis que j’étais pleinement convaincu de toute l’importance du poste qu’on voulait me confier, “mais, ajoutai-je, Hyder Ali étant depuis longtemps l’ennemi déclaré de mon pays, je ne puis l’accepter sans me déshonorer. Je sais que quelques-uns de mes compatriotes, séduits par les promesses et les faveurs d’Hyder Ali, ont eu la lâcheté de quitter leur drapeau pour s’engager à son service, mais je ne suivrai point leur exemple. Ce que je dois à mon nom, au sang dont je suis sorti et, plus que tout cela, les principes que je me suis faits et dont je ne me départirai jamais, ne me permettent point d’accéder à vos propositions. J’en appelle à Hyat Sahib lui-même : Hyder Ali serait-il prudent de confier un emploi de cette importance à un homme qui, pour un vil intérêt, aurait pu se déterminer à trahir tous ses devoirs et à porter les armes contre sa patrie ?”
Malgré ces représentations, Hyat Sahib ne s’en montra pas moins ardent à employer tous les moyens de persuasion qu’il pût imaginer pour me faire changer de résolution. Mais tous ses efforts furent inutiles. L’attachement que je portais à mon pays et à ma famille l’emporta sur toute autre considération. Je lui intimai mes intentions d’un ton à le persuader que ma détermination était irrévocable.
Ne pouvant rien gagner par les promesses, Hyat Sahib eut recours aux menaces. Chaque jour, on me retranchait quelque chose de ma ration ordinaire. On me resserra plus étroitement, puis on m’attacha à un arbre, par une corde qu’on me passa autour du cou. Tous ces mauvais traitements, au lieu d’ébranler mon courage, ne firent que me raffermir dans la résolution que j’avais prise.
M. Hall partageait toutes mes peines. L’intérêt qu’il y prenait me les rendait moins sensibles. Une seule réflexion nous consolait, c’est que, notre malheureuse destinée n’étant connue ni de nos parents ni de nos amis, leur bonheur du moins n’était pas troublé par les souffrances qu’on nous faisait essuyer.
Plusieurs mois s’écoulèrent ainsi sans que rien ne changeât à notre situation. Nous prêtions l’oreille aux rapports contradictoires qu’on faisait circuler sur les victoires remportées tantôt par les Anglais, tantôt par les troupes d’Hyder Ali. Nous ne trouvions de consolation que dans nos propres réflexions et dans notre attention réciproque à nous encourager et à nous distraire. À toutes nos peines se joignait encore l’affligeant spectacle de tous les mauvais traitements qu’on faisait essuyer aux malheureux prisonniers qu’on avait enfermés avec nous. Leur nourriture leur était le plus souvent soustraite, tantôt par l’avarice de leurs gardiens, tantôt par le caprice des chefs. Il s’en trouvait cependant, parmi ces gardiens, qui marquaient de la commisération et de l’humanité. On avait défendu de nous donner des plumes, de l’encre et du papier. On ne nous permettait que très rarement de nous raser et de changer de linge. Cependant, pour ne point nous laisser exposés aux injures de l’air, on nous construisit une espèce de petite cellule qui, étant étroite et humide, ne servit qu’à rendre notre situation encore plus douloureuse.
Dans un noir cachot, pratiqué en face de notre cellule, se trouvait enfermé l’ancien gouverneur du Bednore. Nous étions parvenus à nous entendre par signes et à nous communiquer ainsi toutes nos pensées. Comme il était du pays, il lui était plus facile de se mettre au courant de toutes les nouvelles et il ne nous laissait rien ignorer de ce qui pouvait intéresser les malheureux Européens qu’il avait pour compagnons d’infortune. Nous trouvâmes aussi le moyen de nous faire tenir des lettres par les cipayes que nous avions alternativement pour gardiens.
Quelques lueurs d’espérance vinrent réchauffer nos esprits abattus. Je conçus qu’il ne serait pas impossible de m’évader et même de nous créer un parti dans la ville. Je savais qu’Hyder Ali, ainsi qu’Hyat Sahib, étaient abhorrés, et que la crainte seule empêchait le mécontentement d’éclater. J’avais appris que l’ancien commandant du Bednore était aimé et que le souvenir de sa première élévation lui conservait encore beaucoup d’amis et de partisans. Dans notre prison se trouvait un grand nombre de cipayes avec leurs officiers, dont quelques-uns avaient été attachés au régiment que j’avais commandé comme auxiliaire du nabab d’Arcate. Enfin, j’avais entendu dire qu’il n’y avait pas de prison dans le monde connu d’où un Anglais n’eût trouvé le moyen de se sauver.
Rempli de ces idées, je résolus de sonder les officiers cipayes et de m’instruire par eux s’il n’était pas possible de trouver quelque moyen d’évasion. La nature a donné à l’homme un si ardent amour pour la liberté et une telle horreur pour toute espèce d’esclavage que je les trouvai tous disposés à me seconder. Je commençai à me flatter que le moment n’était peut-être pas éloigné où je pourrais me venger de mes tyrans et leur faire maudire le jour où les orages nous avaient jetés sur leurs côtes.
Après avoir ainsi sondé l’intention de tous ceux que je croyais n’être pas éloignés d’entrer dans mon projet, il me restait à trouver les moyens de le mettre à exécution. Cette partie de l’entreprise présentait toutes sortes de difficultés. Il fallait user de la plus grande adresse et de la plus profonde dissimulation pour tromper la vigilance de nos gardiens. Le moindre changement dans nos habitudes et dans nos liaisons pouvait leur donner l’éveil et leur inspirer des soupçons. Cependant, il fallait communiquer et délibérer sur le parti qu’il y avait à prendre. Il fallait connaître le fort et toutes ses issues, recueillir et concerter toutes les idées pour asseoir un plan qui offrît quelque espérance de succès. Autrement on ne pouvait rien tenter sans courir les plus grands risques. M. Hall et moi tînmes plusieurs fois conseil sur les mesures qu’il y avait à adopter. Nous imaginâmes divers plans que nous désapprouvâmes successivement sans pour cela perdre courage.
Je crus que je pourrais tirer beaucoup de lumières de l’ancien gouverneur du Bednore qui, ayant été commandant de la place, devait connaître l’esprit qui y régnait. Je le mis dans la confidence du projet que nous avions conçu et le priai de nous aider de ses conseils. Tout était déjà arrangé à notre satisfaction et paraissait nous promettre le plus heureux succès, lorsqu’un événement survint qui détruisit tout à coup nos espérances. »
Chapitre V – Vers Bagdad (p. 87-91)
Carmelo, le cycliste solitaire (p. 249-255)
Extrait court
« On me fit bientôt reparaître devant le même officier qui m’avait déjà intimé les intentions d’Hyat Sahib. Il me demanda si j’avais réfléchi à l’importance des offres qu’il m’avait faites et aux suites qu’un refus obstiné de ma part pourrait avoir. Il me représenta que ce n’était point une médiocre faveur qu’un emploi qui mettait cinq mille hommes sous mes ordres et que les premiers rajahs de l’empire seraient jaloux de posséder.
Je répondis que j’étais pleinement convaincu de toute l’importance du poste qu’on voulait me confier, “mais, ajoutai-je, Hyder Ali étant depuis longtemps l’ennemi déclaré de mon pays, je ne puis l’accepter sans me déshonorer. Je sais que quelques-uns de mes compatriotes, séduits par les promesses et les faveurs d’Hyder Ali, ont eu la lâcheté de quitter leur drapeau pour s’engager à son service, mais je ne suivrai point leur exemple. Ce que je dois à mon nom, au sang dont je suis sorti et, plus que tout cela, les principes que je me suis faits et dont je ne me départirai jamais, ne me permettent point d’accéder à vos propositions. J’en appelle à Hyat Sahib lui-même : Hyder Ali serait-il prudent de confier un emploi de cette importance à un homme qui, pour un vil intérêt, aurait pu se déterminer à trahir tous ses devoirs et à porter les armes contre sa patrie ?”
Malgré ces représentations, Hyat Sahib ne s’en montra pas moins ardent à employer tous les moyens de persuasion qu’il pût imaginer pour me faire changer de résolution. Mais tous ses efforts furent inutiles. L’attachement que je portais à mon pays et à ma famille l’emporta sur toute autre considération. Je lui intimai mes intentions d’un ton à le persuader que ma détermination était irrévocable.
Ne pouvant rien gagner par les promesses, Hyat Sahib eut recours aux menaces. Chaque jour, on me retranchait quelque chose de ma ration ordinaire. On me resserra plus étroitement, puis on m’attacha à un arbre, par une corde qu’on me passa autour du cou. Tous ces mauvais traitements, au lieu d’ébranler mon courage, ne firent que me raffermir dans la résolution que j’avais prise.
M. Hall partageait toutes mes peines. L’intérêt qu’il y prenait me les rendait moins sensibles. Une seule réflexion nous consolait, c’est que, notre malheureuse destinée n’étant connue ni de nos parents ni de nos amis, leur bonheur du moins n’était pas troublé par les souffrances qu’on nous faisait essuyer.
Plusieurs mois s’écoulèrent ainsi sans que rien ne changeât à notre situation. Nous prêtions l’oreille aux rapports contradictoires qu’on faisait circuler sur les victoires remportées tantôt par les Anglais, tantôt par les troupes d’Hyder Ali. Nous ne trouvions de consolation que dans nos propres réflexions et dans notre attention réciproque à nous encourager et à nous distraire. À toutes nos peines se joignait encore l’affligeant spectacle de tous les mauvais traitements qu’on faisait essuyer aux malheureux prisonniers qu’on avait enfermés avec nous. Leur nourriture leur était le plus souvent soustraite, tantôt par l’avarice de leurs gardiens, tantôt par le caprice des chefs. Il s’en trouvait cependant, parmi ces gardiens, qui marquaient de la commisération et de l’humanité. On avait défendu de nous donner des plumes, de l’encre et du papier. On ne nous permettait que très rarement de nous raser et de changer de linge. Cependant, pour ne point nous laisser exposés aux injures de l’air, on nous construisit une espèce de petite cellule qui, étant étroite et humide, ne servit qu’à rendre notre situation encore plus douloureuse.
Dans un noir cachot, pratiqué en face de notre cellule, se trouvait enfermé l’ancien gouverneur du Bednore. Nous étions parvenus à nous entendre par signes et à nous communiquer ainsi toutes nos pensées. Comme il était du pays, il lui était plus facile de se mettre au courant de toutes les nouvelles et il ne nous laissait rien ignorer de ce qui pouvait intéresser les malheureux Européens qu’il avait pour compagnons d’infortune. Nous trouvâmes aussi le moyen de nous faire tenir des lettres par les cipayes que nous avions alternativement pour gardiens.
Quelques lueurs d’espérance vinrent réchauffer nos esprits abattus. Je conçus qu’il ne serait pas impossible de m’évader et même de nous créer un parti dans la ville. Je savais qu’Hyder Ali, ainsi qu’Hyat Sahib, étaient abhorrés, et que la crainte seule empêchait le mécontentement d’éclater. J’avais appris que l’ancien commandant du Bednore était aimé et que le souvenir de sa première élévation lui conservait encore beaucoup d’amis et de partisans. Dans notre prison se trouvait un grand nombre de cipayes avec leurs officiers, dont quelques-uns avaient été attachés au régiment que j’avais commandé comme auxiliaire du nabab d’Arcate. Enfin, j’avais entendu dire qu’il n’y avait pas de prison dans le monde connu d’où un Anglais n’eût trouvé le moyen de se sauver.
Rempli de ces idées, je résolus de sonder les officiers cipayes et de m’instruire par eux s’il n’était pas possible de trouver quelque moyen d’évasion. La nature a donné à l’homme un si ardent amour pour la liberté et une telle horreur pour toute espèce d’esclavage que je les trouvai tous disposés à me seconder. Je commençai à me flatter que le moment n’était peut-être pas éloigné où je pourrais me venger de mes tyrans et leur faire maudire le jour où les orages nous avaient jetés sur leurs côtes.
Après avoir ainsi sondé l’intention de tous ceux que je croyais n’être pas éloignés d’entrer dans mon projet, il me restait à trouver les moyens de le mettre à exécution. Cette partie de l’entreprise présentait toutes sortes de difficultés. Il fallait user de la plus grande adresse et de la plus profonde dissimulation pour tromper la vigilance de nos gardiens. Le moindre changement dans nos habitudes et dans nos liaisons pouvait leur donner l’éveil et leur inspirer des soupçons. Cependant, il fallait communiquer et délibérer sur le parti qu’il y avait à prendre. Il fallait connaître le fort et toutes ses issues, recueillir et concerter toutes les idées pour asseoir un plan qui offrît quelque espérance de succès. Autrement on ne pouvait rien tenter sans courir les plus grands risques. M. Hall et moi tînmes plusieurs fois conseil sur les mesures qu’il y avait à adopter. Nous imaginâmes divers plans que nous désapprouvâmes successivement sans pour cela perdre courage.
Je crus que je pourrais tirer beaucoup de lumières de l’ancien gouverneur du Bednore qui, ayant été commandant de la place, devait connaître l’esprit qui y régnait. Je le mis dans la confidence du projet que nous avions conçu et le priai de nous aider de ses conseils. Tout était déjà arrangé à notre satisfaction et paraissait nous promettre le plus heureux succès, lorsqu’un événement survint qui détruisit tout à coup nos espérances. »
(p. 145-149)
Chapitre V – Vers Bagdad (p. 87-91)
Carmelo, le cycliste solitaire (p. 249-255)
Extrait court


