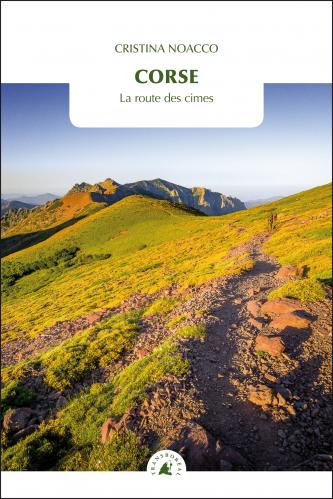
Sur les hauteurs de Calvi :
« Je marche tranquillement sous la pluie ; je chantonne et, soudain, un double arc-en-ciel embrasse dans une courbe harmonieuse tout le paysage : il émerge de la forêt et plonge dans la mer. Étonnant chemin de lumière, palette d’artiste qui déploie tout un nuancier de couleurs. Le soleil est revenu, mais il pleut encore et d’infimes gouttelettes scintillent dans la lumière. Un peu plus haut, les fougères s’inclinent sous la pluie et de petites perles – ou de petits diamants – brillent suspendues aux pointes des feuilles, “gouttes d’argent d’orfèvrerie”. Le spectacle de la vie se renouvelle et le maquis, à présent, a laissé la place aux bois.
Marcher au cœur de la forêt donne l’impression de remonter le temps, de retrouver les origines et de renouer avec l’état sauvage, de plonger dans les profondeurs de la vie. Dans Walden ou La Vie dans les bois (1854), Henry David Thoreau écrivait : “Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiels de la vie, voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu’elle avait à m’enseigner, et non pas découvrir à l’heure de ma mort que je n’avais pas vécu.”
La vie, ici, s’apprécie grâce au voyage lent, à pas d’homme. Il s’agit de couvrir 20 à 25 kilomètres par jour tout au plus, distance qui se réduit considérablement quand le terrain est accidenté et le dénivelé important. Il s’agit aussi d’accomplir un voyage dans le temps, par une approche nouvelle de la durée. C’est ainsi que le vol plané d’un rapace, quoiqu’il ne dure que quelques secondes à peine, déchire le temps et se grave dans l’esprit comme un fragment d’éternité. C’est le temps vécu, non le temps mesuré, qui compte. En chemin, tout est événement mémorable, comme le bruissement de ce qui nous effleure l’espace d’une respiration. C’est pourquoi j’aime m’isoler, pour aiguiser mes sens et m’ouvrir pleinement au spectacle de la nature.
Le murmure d’une source se fait entendre. Elle coule dissimulée parmi les herbes et les fougères ; une araignée a élu domicile juste à l’embouchure du jet d’eau. Je fais une halte et échange le contenu de ma gourde contre un peu de son eau fraîche, tout en saluant les marcheurs qui me doublent.
J’observe ce que je décris ; j’écris pour mieux inventorier le monde. Comme le dessin, l’écriture aiguise l’attention et les sens. Tout détail devient important ; c’est pourquoi la marche convient parfaitement à l’écriture, ainsi qu’à la contemplation : la cadence des pas s’accorde au cheminement de la pensée et au rythme de la main, tandis que le stylo sillonne son pré immaculé. Telle a été la démarche de Jean-Jacques Rousseau : dans Les Rêveries du promeneur solitaire, l’image de la promenade renvoie à la réflexion. »
Au paradis des chevaux sauvages : le Lavu di u Ninu (p. 78-79)
Double étape (p. 177-179)
Extrait court
« Je marche tranquillement sous la pluie ; je chantonne et, soudain, un double arc-en-ciel embrasse dans une courbe harmonieuse tout le paysage : il émerge de la forêt et plonge dans la mer. Étonnant chemin de lumière, palette d’artiste qui déploie tout un nuancier de couleurs. Le soleil est revenu, mais il pleut encore et d’infimes gouttelettes scintillent dans la lumière. Un peu plus haut, les fougères s’inclinent sous la pluie et de petites perles – ou de petits diamants – brillent suspendues aux pointes des feuilles, “gouttes d’argent d’orfèvrerie”. Le spectacle de la vie se renouvelle et le maquis, à présent, a laissé la place aux bois.
Marcher au cœur de la forêt donne l’impression de remonter le temps, de retrouver les origines et de renouer avec l’état sauvage, de plonger dans les profondeurs de la vie. Dans Walden ou La Vie dans les bois (1854), Henry David Thoreau écrivait : “Je suis parti dans les bois parce que je désirais vivre de manière réfléchie, affronter seulement les faits essentiels de la vie, voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu’elle avait à m’enseigner, et non pas découvrir à l’heure de ma mort que je n’avais pas vécu.”
La vie, ici, s’apprécie grâce au voyage lent, à pas d’homme. Il s’agit de couvrir 20 à 25 kilomètres par jour tout au plus, distance qui se réduit considérablement quand le terrain est accidenté et le dénivelé important. Il s’agit aussi d’accomplir un voyage dans le temps, par une approche nouvelle de la durée. C’est ainsi que le vol plané d’un rapace, quoiqu’il ne dure que quelques secondes à peine, déchire le temps et se grave dans l’esprit comme un fragment d’éternité. C’est le temps vécu, non le temps mesuré, qui compte. En chemin, tout est événement mémorable, comme le bruissement de ce qui nous effleure l’espace d’une respiration. C’est pourquoi j’aime m’isoler, pour aiguiser mes sens et m’ouvrir pleinement au spectacle de la nature.
Le murmure d’une source se fait entendre. Elle coule dissimulée parmi les herbes et les fougères ; une araignée a élu domicile juste à l’embouchure du jet d’eau. Je fais une halte et échange le contenu de ma gourde contre un peu de son eau fraîche, tout en saluant les marcheurs qui me doublent.
J’observe ce que je décris ; j’écris pour mieux inventorier le monde. Comme le dessin, l’écriture aiguise l’attention et les sens. Tout détail devient important ; c’est pourquoi la marche convient parfaitement à l’écriture, ainsi qu’à la contemplation : la cadence des pas s’accorde au cheminement de la pensée et au rythme de la main, tandis que le stylo sillonne son pré immaculé. Telle a été la démarche de Jean-Jacques Rousseau : dans Les Rêveries du promeneur solitaire, l’image de la promenade renvoie à la réflexion. »
(p. 27-28)
Au paradis des chevaux sauvages : le Lavu di u Ninu (p. 78-79)
Double étape (p. 177-179)
Extrait court


