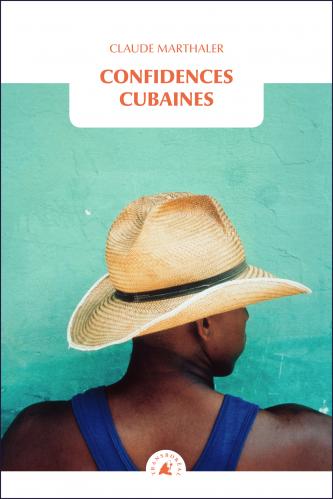
Le chameau cubain :
« Cuba est une énigme temporelle qui ne vit jamais à l’heure du monde, une île étrange qui, au nom d’une idéologie, s’est extirpée des méridiens pour produire son propre décalage horaire. Une folle dérive qui me fait souvent penser à l’Afrique où, avec moins, on fait plus. C’est une île aux courtes distances mais au temps allongé. Un pays à bout de souffle qui fonctionne au ralenti. Les habitants en ont pris de la graine : là où l’on a appris à perdre son temps, rien ne sert de s’exciter au travail puisque l’on ne gagne jamais suffisamment d’argent pour vivre. En conséquence logique, le taux d’absentéisme est élevé et le rythme du travail diminué. Sans les 100 000 barils de pétrole par jour en provenance du Venezuela et les prêts chinois, le pays s’immobiliserait. Cuba échappe ainsi à la motorisation effrénée que connaît le reste de la planète, non pas par conscience écologique, mais par pénurie chronique de carburant. En contrepartie, pour les voyageurs à vélo, hormis le défaut d’entretien, les routes désertes représentent un paradis, tandis que, pour les habitants, le manque de moyens de transport est un véritable enfer. Et quand passe enfin un bus, il est bondé ou trop cher. Les gens font malgré eux partie des inventeurs de la dernière chance : “Quand il n’y a plus rien d’humain, il y a encore le Cubain !”
Les Cubains emploient à tout bout de champ l’expression Hay que inventar ! Hay que resolver ! – “Inventons ! Résolvons !”, version caribéenne de la célèbre maxime de Raymond Devos : “En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées !”
“Si tu es cubain, tu n’as pas besoin de te rendre au Moyen-Orient ni de subir la chaleur du désert pour voir un chameau”, me dit-on. L’idée d’importer des chameaux a été soulevée dans la troisième décennie du XIXe siècle afin de transporter la canne à sucre des champs à l’usine. En 1841, trente et un chameaux pâturaient ainsi à Santa Ignacio. Mais la futilité du projet et la présence d’aoûtats, qui pondaient leurs œufs dans les soles de l’animal, ont eu raison des camélidés dans les champs de Matanzas. Blague à part, le chameau cubain n’a rien à voir avec l’ongulé des régions désertiques de l’Asie ; il n’a jamais possédé deux bosses de masse graisseuse qui lui servent de réserves en cas de pénurie. Tout au contraire : le camello est né en réponse aux pénuries de carburant du début des années 1990, lorsque l’Union soviétique s’est effondrée. La Russie coupa le cordon ombilical et l’île perdit sa subvention annuelle de 6 milliards d’euros, soit 35 % de son budget national ! Surnommé guagua (prononcer “wuawua”), le camello provient de l’imagination féconde de mécaniciens et de techniciens. Ces mutants de fer à 18 roues, d’une vingtaine de mètres de longueur, ont une capacité semblable à celle d’un Airbus A340 (mais seulement 75 places assises !). Ces artefacts sont le résultat d’une copulation entre deux bus de l’ère soviétique soudés ensemble sur une plate-forme, remorqués par une tête de camion, ce qui, avec leurs deux bosses, leur confère une anatomie de chameau propre à l’imagination créole. Les étages supérieurs ont été immédiatement appelés barbecues, en référence aux mezzanines construites spontanément par les habitants de La Havane dans leurs maisons, afin de répondre à la crise du logement en doublant miraculeusement leur capacité.
Jusqu’en 2008, ces véhicules sillonnaient encore les avenues de la capitale. Aujourd’hui, quelque mille bêtes en voie d’extinction s’ébrouent dans un grondement métallique et traversent le pays sur des routes souvent cahoteuses. Ces camellos ne possèdent toujours pas d’amortisseurs. Personne ne sait comment 300 à 500 humains trouvent place dans un chameau sans affecter son métabolisme !
“Les camellos bourrés à craquer font que, quelquefois, tu descends à l’arrêt que tu ne voulais pas, car la masse des gens t’éjecte sans prévenir ! me rapporte une femme. À l’inverse, parfois, tu as juste pu monter dans le bus, coincé dans la porte, avec la moitié du corps resté dehors ; et ceci, malgré l’aide d’un pousseur, comme dans le métro de Tokyo ! On te dit alors Eres venido en el escenarío, ‘Tu es monté sur scène’.” La concentration humaine au sein des camellos fait penser aux trains de Mumbai à l’heure de pointe.
Sueur des corps dégoulinants et nourriture en décomposition : en l’absence d’air conditionné, la chaleur tropicale devient vite insupportable et la puanteur s’installe dans les guaguas, sauf si l’on a la chance de glisser sa tête par la fenêtre. Les passagers coincés comme des sardines tirent le meilleur parti de l’espace disponible. L’ambiance est caliente ! On dit que les vols à la tire et les mains hardies sont légion durant les houleux voyages “en chameau” que les femmes redoutent tant. Certains passagers disent avoir perdu montre ou portefeuille dans les couloirs étroits, d’autres y ont trouvé une amitié? voire l’amour !
En 2008, Raúl Castro prend enfin la mesure du fléau et ressuscite un système de transports publics au bord de l’effondrement. Cuba dépense alors 2 milliards de dollars pour les moderniser en important 3 000 autobus modernes chinois Yutong pour la capitale. Les tarifs atteignent le double de ceux d’un camello, mais offrent davantage de places assises, de confort et de maniabilité. Même si d’aucuns pensent déjà que “quand les nouveaux autobus tomberont en panne, ils feront revenir les camellos”, qui ne sont d’ailleurs consignés dans aucun document historique.
Sur la route, la crise est si aiguë que les camions et les bétaillères remorquées par des tracteurs ou les charrettes attelées à des chevaux ont été réquisitionnés pour être utilisés comme transports publics. Hors de la capitale, les school buses canadiens, de couleur jaune, viennent également à la rescousse. Les camions de chantier recueillent dans leur benne les gens qui font signe en bord de route, de façon à arrondir les fins de mois du chauffeur. Dans bien des villes, les bicitaxis prennent le relais. Que vaut la révolution avec ses systèmes d’éducation et de santé “gratuits” et sa sécurité, lorsque les salaires ne permettent pas de vivre et les transports de se déplacer ?
Je redoute le panache noir de diesel des camellos et prends à nouveau conscience de la liberté de rouler seul et au grand air sur une simple bicyclette. Avec sa vitesse minimum requise pour atteindre le point d’équilibre et son allure maximum peu élevée, elle est la modération même. Son silence restitue la parole au paysage. »
Havana blues (p. 41-44)
Carmelo, le cycliste solitaire (p. 249-255)
Extrait court
« Cuba est une énigme temporelle qui ne vit jamais à l’heure du monde, une île étrange qui, au nom d’une idéologie, s’est extirpée des méridiens pour produire son propre décalage horaire. Une folle dérive qui me fait souvent penser à l’Afrique où, avec moins, on fait plus. C’est une île aux courtes distances mais au temps allongé. Un pays à bout de souffle qui fonctionne au ralenti. Les habitants en ont pris de la graine : là où l’on a appris à perdre son temps, rien ne sert de s’exciter au travail puisque l’on ne gagne jamais suffisamment d’argent pour vivre. En conséquence logique, le taux d’absentéisme est élevé et le rythme du travail diminué. Sans les 100 000 barils de pétrole par jour en provenance du Venezuela et les prêts chinois, le pays s’immobiliserait. Cuba échappe ainsi à la motorisation effrénée que connaît le reste de la planète, non pas par conscience écologique, mais par pénurie chronique de carburant. En contrepartie, pour les voyageurs à vélo, hormis le défaut d’entretien, les routes désertes représentent un paradis, tandis que, pour les habitants, le manque de moyens de transport est un véritable enfer. Et quand passe enfin un bus, il est bondé ou trop cher. Les gens font malgré eux partie des inventeurs de la dernière chance : “Quand il n’y a plus rien d’humain, il y a encore le Cubain !”
Les Cubains emploient à tout bout de champ l’expression Hay que inventar ! Hay que resolver ! – “Inventons ! Résolvons !”, version caribéenne de la célèbre maxime de Raymond Devos : “En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées !”
“Si tu es cubain, tu n’as pas besoin de te rendre au Moyen-Orient ni de subir la chaleur du désert pour voir un chameau”, me dit-on. L’idée d’importer des chameaux a été soulevée dans la troisième décennie du XIXe siècle afin de transporter la canne à sucre des champs à l’usine. En 1841, trente et un chameaux pâturaient ainsi à Santa Ignacio. Mais la futilité du projet et la présence d’aoûtats, qui pondaient leurs œufs dans les soles de l’animal, ont eu raison des camélidés dans les champs de Matanzas. Blague à part, le chameau cubain n’a rien à voir avec l’ongulé des régions désertiques de l’Asie ; il n’a jamais possédé deux bosses de masse graisseuse qui lui servent de réserves en cas de pénurie. Tout au contraire : le camello est né en réponse aux pénuries de carburant du début des années 1990, lorsque l’Union soviétique s’est effondrée. La Russie coupa le cordon ombilical et l’île perdit sa subvention annuelle de 6 milliards d’euros, soit 35 % de son budget national ! Surnommé guagua (prononcer “wuawua”), le camello provient de l’imagination féconde de mécaniciens et de techniciens. Ces mutants de fer à 18 roues, d’une vingtaine de mètres de longueur, ont une capacité semblable à celle d’un Airbus A340 (mais seulement 75 places assises !). Ces artefacts sont le résultat d’une copulation entre deux bus de l’ère soviétique soudés ensemble sur une plate-forme, remorqués par une tête de camion, ce qui, avec leurs deux bosses, leur confère une anatomie de chameau propre à l’imagination créole. Les étages supérieurs ont été immédiatement appelés barbecues, en référence aux mezzanines construites spontanément par les habitants de La Havane dans leurs maisons, afin de répondre à la crise du logement en doublant miraculeusement leur capacité.
Jusqu’en 2008, ces véhicules sillonnaient encore les avenues de la capitale. Aujourd’hui, quelque mille bêtes en voie d’extinction s’ébrouent dans un grondement métallique et traversent le pays sur des routes souvent cahoteuses. Ces camellos ne possèdent toujours pas d’amortisseurs. Personne ne sait comment 300 à 500 humains trouvent place dans un chameau sans affecter son métabolisme !
“Les camellos bourrés à craquer font que, quelquefois, tu descends à l’arrêt que tu ne voulais pas, car la masse des gens t’éjecte sans prévenir ! me rapporte une femme. À l’inverse, parfois, tu as juste pu monter dans le bus, coincé dans la porte, avec la moitié du corps resté dehors ; et ceci, malgré l’aide d’un pousseur, comme dans le métro de Tokyo ! On te dit alors Eres venido en el escenarío, ‘Tu es monté sur scène’.” La concentration humaine au sein des camellos fait penser aux trains de Mumbai à l’heure de pointe.
Sueur des corps dégoulinants et nourriture en décomposition : en l’absence d’air conditionné, la chaleur tropicale devient vite insupportable et la puanteur s’installe dans les guaguas, sauf si l’on a la chance de glisser sa tête par la fenêtre. Les passagers coincés comme des sardines tirent le meilleur parti de l’espace disponible. L’ambiance est caliente ! On dit que les vols à la tire et les mains hardies sont légion durant les houleux voyages “en chameau” que les femmes redoutent tant. Certains passagers disent avoir perdu montre ou portefeuille dans les couloirs étroits, d’autres y ont trouvé une amitié? voire l’amour !
En 2008, Raúl Castro prend enfin la mesure du fléau et ressuscite un système de transports publics au bord de l’effondrement. Cuba dépense alors 2 milliards de dollars pour les moderniser en important 3 000 autobus modernes chinois Yutong pour la capitale. Les tarifs atteignent le double de ceux d’un camello, mais offrent davantage de places assises, de confort et de maniabilité. Même si d’aucuns pensent déjà que “quand les nouveaux autobus tomberont en panne, ils feront revenir les camellos”, qui ne sont d’ailleurs consignés dans aucun document historique.
Sur la route, la crise est si aiguë que les camions et les bétaillères remorquées par des tracteurs ou les charrettes attelées à des chevaux ont été réquisitionnés pour être utilisés comme transports publics. Hors de la capitale, les school buses canadiens, de couleur jaune, viennent également à la rescousse. Les camions de chantier recueillent dans leur benne les gens qui font signe en bord de route, de façon à arrondir les fins de mois du chauffeur. Dans bien des villes, les bicitaxis prennent le relais. Que vaut la révolution avec ses systèmes d’éducation et de santé “gratuits” et sa sécurité, lorsque les salaires ne permettent pas de vivre et les transports de se déplacer ?
Je redoute le panache noir de diesel des camellos et prends à nouveau conscience de la liberté de rouler seul et au grand air sur une simple bicyclette. Avec sa vitesse minimum requise pour atteindre le point d’équilibre et son allure maximum peu élevée, elle est la modération même. Son silence restitue la parole au paysage. »
(p. 89-93)
Havana blues (p. 41-44)
Carmelo, le cycliste solitaire (p. 249-255)
Extrait court


