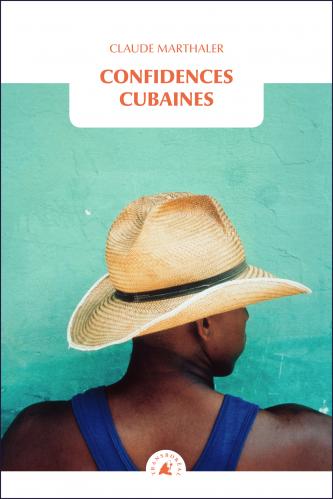
Havana blues :
« On connaît bien sûr les pluies diluviennes et les cyclones qui ravagent régulièrement l’île, mais on oublie parfois son aridité en matière d’informations. Dans un monde qui a accès à l’électricité, à peu d’exceptions près, Internet a révolutionné nos vies d’une manière irréversible. À Cuba, très rares sont les lieux publics disponibles, où la connexion reste très lente, malgré l’existence de la fibre optique en provenance du Venezuela, et où la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. Les tarifs pratiqués sont excessivement élevés : une heure équivaut à un demi-salaire mensuel, parfois même au salaire mensuel d’un travailleur. Une façon d’interdire de manière non formelle. Les casas particulares, par exemple, ne peuvent proposer qu’un service d’accès à la messagerie électronique.
Mon arrêt forcé me condamne à un saut dans le passé, dans un monde qui ailleurs n’existe plus. Me voici donc privé de contacts extérieurs et de liens virtuels, ce qui pour certains voyageurs pourrait représenter un privilège et pour d’autres un malaise. Cette situation involontaire me confirme bienheureusement ma non-dépendance à Internet et me rappelle aussi mes années passées à voyager avant son existence. J’ose à peine imaginer ce qu’une véritable assignation à résidence signifie pour un dissident.
Ce désert artificiel en matière d’informations, qui a pour but de maintenir les habitants dans l’ignorance et de taire toute contestation du pouvoir en place, renforce ma conviction que les découvertes scientifiques reformulent le monde d’une manière irrévocable, contrairement aux régimes politiques ou aux empires “immuables”, qui vieillissent mal et finissent tôt ou tard par s’écrouler d’eux-mêmes. Dans 1984, Orwell dit : “Les masses ne se révoltent jamais de leur propre mouvement, et elles ne se révoltent jamais par le seul fait qu’elles sont opprimées. Aussi longtemps qu’elles n’ont pas d’élément de comparaison, elles ne se rendent jamais compte qu’elles sont opprimées.”
Máximo, père de trois enfants, est un vendeur à la sauvette. Chaque jour, il propose les galettes à l’ail qu’il a confectionnées au pied de l’Edificio Fosca, un immeuble en béton de 39 étages achevé en 1956 en un temps record. À l’époque, c’était la deuxième plus grande construction de ce type au monde, et elle fut récompensée en 1997 comme “l’une des sept merveilles de l’ingénierie cubaine” par l’Union nationale des architectes et des ingénieurs de la construction de Cuba. De nombreux employés déambulent au pied de cette tour, qui fut aussi la première à contenir un centre commercial à La Havane.
Máximo travaille ouvertement, aux côtés de jeunes en âge d’être scolarisés qui proposent des lunettes de soleil et d’un vendeur illégal de brioches. Tout à coup, il repère un inspecteur : “Regarde, il se trouve juste derrière toi. Tu peux le reconnaître à la sacoche qu’il porte sur le côté. Ce mec-là peut t’infliger une amende de 1 500 pesos, même si tu possèdes une licence qui vaut à elle seule de l’ordre de 18 CUC, selon le métier.” Rompu à une telle situation, Máximo me demande aussitôt d’ouvrir son sac de tissu pour y glisser ses sachets de galettes et les cacher momentanément.
Il est de ceux qui vouent une haine sans bornes au régime et il ne mâche pas ses mots. Tout en jaugeant un éventuel client ou un inspecteur parmi les badauds, il prend soin de n’être écouté par personne, car parler à un étranger l’expose à la délation, l’un des piliers du régime. Je ne connaîtrai jamais le véritable métier de Máximo, qui déclare sans retenue : “Fidel est un tyran qui, au début de la révolution, plaçait des bombes dans les cinémas ; Che est un assassin, qui participait au travail volontaire pour changer son image, mais a fait fusiller des centaines d’hommes de Batista. Camilo Cienfuegos, qui s’opposait à un régime communiste, perdit prétendument la vie dans un vol à destination de La Havane en octobre 1959 : Raúl et Fidel l’ont tué.” Máximo a de la famille aux États-Unis et taille à coups de machette un portrait peu complaisant de son pays : “Crois-moi, Cuba est une prison : sa configuration géographique d’île ne laisse aucune échappatoire. Qui ne rêve de partir d’ici ? Les salaires sont extrêmement bas : les travailleurs gagnent 12 dollars par mois, les docteurs 20 à 25 dollars mensuels et les prostituées 20 dollars la nuit avec un étranger. J’en suis réduit à faire vendre mes galettes dans différents lieux de la ville.” Il n’est guère optimiste pour l’avenir : “Ce sera pire ! Nos dirigeants ont tous des antennes satellites, Internet, mais ils en limitent sévèrement l’accès pour maintenir les gens dans l’ignorance.” Ce que confirme un dicton local : Quien hace la ley hace la trampa, “Celui qui fait la loi sait aussi la contourner”. Et de conclure : “Cela me fait souffrir de dire du mal de mon pays !” »
Le chameau cubain (p. 89-93)
Carmelo, le cycliste solitaire (p. 249-255)
Extrait court
« On connaît bien sûr les pluies diluviennes et les cyclones qui ravagent régulièrement l’île, mais on oublie parfois son aridité en matière d’informations. Dans un monde qui a accès à l’électricité, à peu d’exceptions près, Internet a révolutionné nos vies d’une manière irréversible. À Cuba, très rares sont les lieux publics disponibles, où la connexion reste très lente, malgré l’existence de la fibre optique en provenance du Venezuela, et où la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. Les tarifs pratiqués sont excessivement élevés : une heure équivaut à un demi-salaire mensuel, parfois même au salaire mensuel d’un travailleur. Une façon d’interdire de manière non formelle. Les casas particulares, par exemple, ne peuvent proposer qu’un service d’accès à la messagerie électronique.
Mon arrêt forcé me condamne à un saut dans le passé, dans un monde qui ailleurs n’existe plus. Me voici donc privé de contacts extérieurs et de liens virtuels, ce qui pour certains voyageurs pourrait représenter un privilège et pour d’autres un malaise. Cette situation involontaire me confirme bienheureusement ma non-dépendance à Internet et me rappelle aussi mes années passées à voyager avant son existence. J’ose à peine imaginer ce qu’une véritable assignation à résidence signifie pour un dissident.
Ce désert artificiel en matière d’informations, qui a pour but de maintenir les habitants dans l’ignorance et de taire toute contestation du pouvoir en place, renforce ma conviction que les découvertes scientifiques reformulent le monde d’une manière irrévocable, contrairement aux régimes politiques ou aux empires “immuables”, qui vieillissent mal et finissent tôt ou tard par s’écrouler d’eux-mêmes. Dans 1984, Orwell dit : “Les masses ne se révoltent jamais de leur propre mouvement, et elles ne se révoltent jamais par le seul fait qu’elles sont opprimées. Aussi longtemps qu’elles n’ont pas d’élément de comparaison, elles ne se rendent jamais compte qu’elles sont opprimées.”
Máximo, père de trois enfants, est un vendeur à la sauvette. Chaque jour, il propose les galettes à l’ail qu’il a confectionnées au pied de l’Edificio Fosca, un immeuble en béton de 39 étages achevé en 1956 en un temps record. À l’époque, c’était la deuxième plus grande construction de ce type au monde, et elle fut récompensée en 1997 comme “l’une des sept merveilles de l’ingénierie cubaine” par l’Union nationale des architectes et des ingénieurs de la construction de Cuba. De nombreux employés déambulent au pied de cette tour, qui fut aussi la première à contenir un centre commercial à La Havane.
Máximo travaille ouvertement, aux côtés de jeunes en âge d’être scolarisés qui proposent des lunettes de soleil et d’un vendeur illégal de brioches. Tout à coup, il repère un inspecteur : “Regarde, il se trouve juste derrière toi. Tu peux le reconnaître à la sacoche qu’il porte sur le côté. Ce mec-là peut t’infliger une amende de 1 500 pesos, même si tu possèdes une licence qui vaut à elle seule de l’ordre de 18 CUC, selon le métier.” Rompu à une telle situation, Máximo me demande aussitôt d’ouvrir son sac de tissu pour y glisser ses sachets de galettes et les cacher momentanément.
Il est de ceux qui vouent une haine sans bornes au régime et il ne mâche pas ses mots. Tout en jaugeant un éventuel client ou un inspecteur parmi les badauds, il prend soin de n’être écouté par personne, car parler à un étranger l’expose à la délation, l’un des piliers du régime. Je ne connaîtrai jamais le véritable métier de Máximo, qui déclare sans retenue : “Fidel est un tyran qui, au début de la révolution, plaçait des bombes dans les cinémas ; Che est un assassin, qui participait au travail volontaire pour changer son image, mais a fait fusiller des centaines d’hommes de Batista. Camilo Cienfuegos, qui s’opposait à un régime communiste, perdit prétendument la vie dans un vol à destination de La Havane en octobre 1959 : Raúl et Fidel l’ont tué.” Máximo a de la famille aux États-Unis et taille à coups de machette un portrait peu complaisant de son pays : “Crois-moi, Cuba est une prison : sa configuration géographique d’île ne laisse aucune échappatoire. Qui ne rêve de partir d’ici ? Les salaires sont extrêmement bas : les travailleurs gagnent 12 dollars par mois, les docteurs 20 à 25 dollars mensuels et les prostituées 20 dollars la nuit avec un étranger. J’en suis réduit à faire vendre mes galettes dans différents lieux de la ville.” Il n’est guère optimiste pour l’avenir : “Ce sera pire ! Nos dirigeants ont tous des antennes satellites, Internet, mais ils en limitent sévèrement l’accès pour maintenir les gens dans l’ignorance.” Ce que confirme un dicton local : Quien hace la ley hace la trampa, “Celui qui fait la loi sait aussi la contourner”. Et de conclure : “Cela me fait souffrir de dire du mal de mon pays !” »
(p. 41-44)
Le chameau cubain (p. 89-93)
Carmelo, le cycliste solitaire (p. 249-255)
Extrait court


