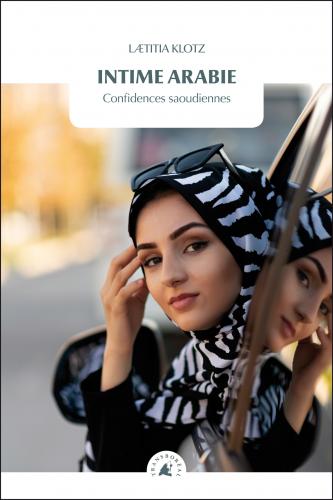
Le camp :
« Je m’arrête à hauteur d’un coquet jardin intérieur. Je ne peux m’empêcher d’être surprise de constater que les jeunes filles évoluent à visage voire à cheveux découverts. Protégées du regard des hommes, elles n’ont plus à se dissimuler. Je découvre un univers exclusivement féminin où les têtes sont nues et où l’harmonie de visages juvéniles prend forme. Ils sont offerts à mon regard et je les vois comme ils sont partout : poupons, durs et sérieux, outrageusement maquillés ou douloureusement acnéiques, sûrs d’eux ou secrets ; visages de jeunes filles en quête de soi qui ne portent pas nécessairement l’abaya ni le voile. Elles évoluent librement, en jupe longue ou pantalon de survêtement, un livre sous le bras ou des écouteurs aux oreilles. Il y a comme un relâchement inattendu dans les tenues et les démarches ; comme un espace privé où les codes de l’extérieur n’ont pas lieu d’être. C’est pour moi la découverte d’un lieu nouveau dont la décontraction simple me surprend. La première image qui me vient est celle des couloirs de lycée à l’américaine comme on les voit dans les séries B chez nous. Sauf que cette fois-ci, il n’y a pas de garçon. Une jeune femme se tient immobile et me regarde. Je marche vers elle et l’aborde. Je lui dis que je suis professeur de français et que j’aimerais proposer mes services à l’université. Elle me répond qu’elle travaille aux ressources humaines, que ce n’est pas la peine que je candidate ; on n’enseigne pas le français ici.
— Justement, rétorqué-je, je suis la personne qu’il vous faut !
— Puisque je vous dis qu’on n’enseigne pas le français ici. Il n’y a pas de module de français.
— D’accord, mais vos élèves pourraient être intéressées par des cours de français, non ?
— Non, on n’enseigne pas le français, répète mon interlocutrice avec agacement.
— Justement, peut-être avez-vous des élèves qui voudraient avoir quelques notions de français, insistai-je. Je pourrais organiser une sorte de club?
— Non.
— Vous ne pensez pas que ça intéresserait vos élèves d’apprendre le français ?
— Non.
— Et si je mets juste une annonce sur un panneau d’affichage ?
— On n’a pas de panneau d’affichage.
Je suis interdite. Mon interlocutrice n’est pas avenante du tout, et cela me surprend. Je suis blessée dans mon orgueil de Française. Au Yémen, les jeunes que je rencontrais voulaient apprendre le français. Quand j’étais au journal, lorsque je descendais à la “cantine”, que je retrouvais mes collègues yéménites pour le petit-déjeuner, que nous nous asseyions par terre, en cercle pour partager nos shafoot et nos kudam, qu’elles ôtaient leur niqab (foulard qui couvre le visage, ne laissant voir que les yeux) parce que nous étions entre filles, elles en profitaient toujours pour m’extorquer des cours de français. Elles étaient curieuses, elles avaient envie. Elles répétaient les mots, me demandaient des phrases coquines, s’esclaffaient, laissant apparaître leurs jolies dents. Nous riions ensemble.
Là, dans cette université, face à cette jeune femme fermée, je ne me sens pas la bienvenue. Le courant ne passe pas. Je sors. En quelques minutes, je me retrouve dehors, sous la lumière crue du soleil de midi, les jambes roses de ma fille lovées sur mes hanches. Je suis frustrée. Même si ce n’est qu’un premier contact, je sens que les portes vont être dures à enfoncer. Mon univers et celui des Saoudiennes ne communiquent pas. Rien n’est fait pour que nous puissions nous rencontrer, pour que nos deux cultures échangent. Sans intermédiaire, je vais avoir beaucoup de mal à les approcher. »
Entre deux mondes (p. 131-133)
Les portes s’ouvrent (p. 315-317)
Extrait court
« Je m’arrête à hauteur d’un coquet jardin intérieur. Je ne peux m’empêcher d’être surprise de constater que les jeunes filles évoluent à visage voire à cheveux découverts. Protégées du regard des hommes, elles n’ont plus à se dissimuler. Je découvre un univers exclusivement féminin où les têtes sont nues et où l’harmonie de visages juvéniles prend forme. Ils sont offerts à mon regard et je les vois comme ils sont partout : poupons, durs et sérieux, outrageusement maquillés ou douloureusement acnéiques, sûrs d’eux ou secrets ; visages de jeunes filles en quête de soi qui ne portent pas nécessairement l’abaya ni le voile. Elles évoluent librement, en jupe longue ou pantalon de survêtement, un livre sous le bras ou des écouteurs aux oreilles. Il y a comme un relâchement inattendu dans les tenues et les démarches ; comme un espace privé où les codes de l’extérieur n’ont pas lieu d’être. C’est pour moi la découverte d’un lieu nouveau dont la décontraction simple me surprend. La première image qui me vient est celle des couloirs de lycée à l’américaine comme on les voit dans les séries B chez nous. Sauf que cette fois-ci, il n’y a pas de garçon. Une jeune femme se tient immobile et me regarde. Je marche vers elle et l’aborde. Je lui dis que je suis professeur de français et que j’aimerais proposer mes services à l’université. Elle me répond qu’elle travaille aux ressources humaines, que ce n’est pas la peine que je candidate ; on n’enseigne pas le français ici.
— Justement, rétorqué-je, je suis la personne qu’il vous faut !
— Puisque je vous dis qu’on n’enseigne pas le français ici. Il n’y a pas de module de français.
— D’accord, mais vos élèves pourraient être intéressées par des cours de français, non ?
— Non, on n’enseigne pas le français, répète mon interlocutrice avec agacement.
— Justement, peut-être avez-vous des élèves qui voudraient avoir quelques notions de français, insistai-je. Je pourrais organiser une sorte de club?
— Non.
— Vous ne pensez pas que ça intéresserait vos élèves d’apprendre le français ?
— Non.
— Et si je mets juste une annonce sur un panneau d’affichage ?
— On n’a pas de panneau d’affichage.
Je suis interdite. Mon interlocutrice n’est pas avenante du tout, et cela me surprend. Je suis blessée dans mon orgueil de Française. Au Yémen, les jeunes que je rencontrais voulaient apprendre le français. Quand j’étais au journal, lorsque je descendais à la “cantine”, que je retrouvais mes collègues yéménites pour le petit-déjeuner, que nous nous asseyions par terre, en cercle pour partager nos shafoot et nos kudam, qu’elles ôtaient leur niqab (foulard qui couvre le visage, ne laissant voir que les yeux) parce que nous étions entre filles, elles en profitaient toujours pour m’extorquer des cours de français. Elles étaient curieuses, elles avaient envie. Elles répétaient les mots, me demandaient des phrases coquines, s’esclaffaient, laissant apparaître leurs jolies dents. Nous riions ensemble.
Là, dans cette université, face à cette jeune femme fermée, je ne me sens pas la bienvenue. Le courant ne passe pas. Je sors. En quelques minutes, je me retrouve dehors, sous la lumière crue du soleil de midi, les jambes roses de ma fille lovées sur mes hanches. Je suis frustrée. Même si ce n’est qu’un premier contact, je sens que les portes vont être dures à enfoncer. Mon univers et celui des Saoudiennes ne communiquent pas. Rien n’est fait pour que nous puissions nous rencontrer, pour que nos deux cultures échangent. Sans intermédiaire, je vais avoir beaucoup de mal à les approcher. »
(p. 60-63)
Entre deux mondes (p. 131-133)
Les portes s’ouvrent (p. 315-317)
Extrait court


