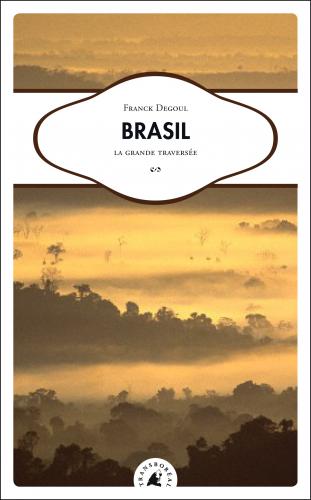
Épilogue :
« Juché sur un terre-plein surmontant la piste où, recroquevillé sous ma cape, je laisse passer l’averse, j’assiste au jeu de deux singes adultes perchés au faîte d’un arbre en vis-à-vis. Leur agilité est proprement remarquable. Usant indifféremment des mains, des pieds et de la queue pour sauter d’une branche à l’autre, ces primates facétieux déploient des mouvements éblouissants de naturel et d’aisance, de légèreté et de dextérité.
Contemplant leur habile ballet aérien, j’ai parfois le sentiment qu’ils m’observent lorsque, soudainement inquiétés par ma présence, ils se figent et scrutent le lointain dans ma direction, vigilants. Je me surprends par deux fois à leur adresser un large signe de la main en guise de salut : l’indifférence immobile que je suscite en retour me cause une bien étrange déception?
J’entre bientôt dans des pans réellement magnifiques de la forêt amazonienne. Les arbres s’élèvent bien plus haut que les jours précédents, et me vient l’image – éculée, certes – d’une cathédrale pour exprimer leur imposante stature. Lorsque la piste serpente plus étroitement encore entre ces enchevêtrements végétaux qui la compriment de part et d’autre, se forme un écho. Les voix humaines, le roulement des moteurs, le bruit des pas, le moindre son est amplifié et répété dans un laps de temps très court et presque imperceptible – à l’image du phénomène audible dans les stations du métro parisien. Cette piste est un couloir, un chemin d’arcades, une nef.
Il m’arrive de marcher plusieurs heures durant sans croiser de véhicule, et ce dans un silence à peine troublé par l’infime chuchotement de mes foulées. Et cependant, le silence ici n’existe pas. Un bruissement constant se fait entendre – feuilles, eau, vent, mouvements – auquel viennent s’ajouter, comme autant de notes de couleur sur le fond vert des sons, les cris, les hululements et les mélodies parkeriennes des chants d’oiseaux aussi nombreux et variés que comptent de feuilles les tiges, les branches inextricablement mêlées les unes aux autres. La vie abonde et déborde en chaque lieu.
En fin de journée, éreinté mais tout aise, je dénichai un asile nocturne en surplomb de la piste. Un talus de déblai formé lors de son nivellement offrait une terrasse artificielle de pierres noires et de terre rouge, quasi nue, bordée du rideau végétal de la forêt intacte. Comme j’y montais Rotunda, des petits singes évoluèrent gaiement au-dessus de ma tête, parcourant l’architecture organique d’un arbre, et cette fois-ci m’observèrent nettement, dissimulés dans la frondaison. C’était moi, ici, l’étrange étranger. Impromptue, ma présence intriguait : mes petits compagnons semblaient partagés entre l’envie de déguerpir et la curiosité qui les poussait à s’attarder pour assister à mon installation sur leur territoire.
Le ciel qui avait été menaçant tout l’après-midi se déboucha. Je restai au seuil de mon abri une bonne partie de la soirée et dînai dans la contemplation du jour cédant place à la nuit. Illuminée par les rayons du couchant, la forêt rubescente s’embrasa et se mit littéralement à fumer. Tant d’humidité ! Un ardent voile cotonneux recouvrit le sommet des arbres, de toutes parts s’élevèrent des nappes de brume incandescentes. Au-dessous, sur l’infernale côte que dominait mon refuge, quelques rares camions peinaient à traverser un bourbier. Leur moteur s’emballait à tout rompre dans des rugissements vains.
Je les entendais s’élancer dans une énième tentative et, enlisés plus encore dans leur espoir déçu, buter à nouveau contre ce piège infranchissable. Les portières s’ouvraient, les conducteurs échangeaient quelques mots brefs, quelques consignes élémentaires. Dans une improvisation aiguillonnée par l’urgence et la nécessité, ils concevaient des stratégies qui, à force d’acharnement, se révélaient payantes. “Vaï ! Vaï ! – Vas-y ! Vas-y !” Ils gravissaient la côte, victorieux – mais pour combien de temps encore ? Une solidarité soudait ces hommes, imposée par la piste comme le désert impose le partage de l’eau : nul ne s’y refuserait sans se défaire aussitôt de sa propre humanité.
Au beau milieu de la nuit, l’un de ces forçats s’enlisa à son tour. Au bruit, il semblait seul, et je doutai longtemps qu’il franchisse l’obstacle par ses propres moyens. Il y parvint finalement au prix d’obstination et de ruse et poursuivit sa route. Son chauffeur ignorait qu’une bonne âme le surplombait, invisible et bienveillante, l’écoutant s’échiner et l’encourageant en silence.
S’éloignant, ces véhicules et leur conducteur emportaient leur agitation et une certaine compagnie, lointaine mais bien humaine. Une fois cicatrisé, le calme se recomposait peu à peu et avec lui une insondable solitude murée d’obscurité.
L’empire des ténèbres sur la forêt, lorsqu’on se trouve seul en son sein, est tout bonnement effrayant les premiers temps. Tout intrigue, tout inquiète, car tout bouge, tout bruisse et tout babille en une polyphonie babélienne. Cris des oiseaux nocturnes ; feuilles qui s’abattent lourdement sur le sol après s’être entrechoquées, durant leur tombée en cascade depuis les hauteurs, avec d’autres feuilles ; frémissements, craquements, crépitements, frôlements, chuintements, chocs sourds et soudains ; et par-dessus tout, l’incessante chute des minuscules perles d’eau dégouttant par dizaines de chacune des millions, des milliards de feuilles que compte la forêt, gouttelettes qui s’épanchent sur le sol après avoir rebondi sur d’autres feuilles qui, ébranlées, déversent à leur tour leur propre trop-plein d’humidité. Cet égouttement permanent et infrangible suscite des hallucinations auditives : le son produit par l’ensemble donne l’illusion qu’il pleut. On se surprend à tendre l’oreille pour localiser le ruisseau qui tinte à proximité ; à tendre le bras pour s’assurer qu’il bruine comme on le croit? En vain : cette cascatelle perpétuelle n’est autre que la transpiration ininterrompue de l’épiderme végétal.
Éveillé à l’aube, je prends conscience que cet environnement soumet les hommes à une temporalité bien différente de celle des villes. Le temps se décompose, se dissout et se corrompt dans l’humus des conditions imposées par le milieu. Cette piste et les nombreux imprévus qui la jalonnent impliquent que les véhicules n’arrivent jamais à l’heure escomptée ; pas d’électricité en dehors de l’usage des – rares – générateurs, et par conséquent une intrusion très faible du monde extérieur, des médias et de leurs cycles indépendants de ceux de la journée et des saisons? La ponctualité, qui n’a de sens que dans un univers quadrillé, domestiqué, n’est pas de ce monde-ci. L’homme s’adapte et ne maîtrise que le peu qu’il lui est donné de maîtriser. C’est-à-dire rien. »
Rio Grande do Sul (p. 33-37)
Maranhão (Nordeste) (p. 152-155)
Extrait court
« Juché sur un terre-plein surmontant la piste où, recroquevillé sous ma cape, je laisse passer l’averse, j’assiste au jeu de deux singes adultes perchés au faîte d’un arbre en vis-à-vis. Leur agilité est proprement remarquable. Usant indifféremment des mains, des pieds et de la queue pour sauter d’une branche à l’autre, ces primates facétieux déploient des mouvements éblouissants de naturel et d’aisance, de légèreté et de dextérité.
Contemplant leur habile ballet aérien, j’ai parfois le sentiment qu’ils m’observent lorsque, soudainement inquiétés par ma présence, ils se figent et scrutent le lointain dans ma direction, vigilants. Je me surprends par deux fois à leur adresser un large signe de la main en guise de salut : l’indifférence immobile que je suscite en retour me cause une bien étrange déception?
J’entre bientôt dans des pans réellement magnifiques de la forêt amazonienne. Les arbres s’élèvent bien plus haut que les jours précédents, et me vient l’image – éculée, certes – d’une cathédrale pour exprimer leur imposante stature. Lorsque la piste serpente plus étroitement encore entre ces enchevêtrements végétaux qui la compriment de part et d’autre, se forme un écho. Les voix humaines, le roulement des moteurs, le bruit des pas, le moindre son est amplifié et répété dans un laps de temps très court et presque imperceptible – à l’image du phénomène audible dans les stations du métro parisien. Cette piste est un couloir, un chemin d’arcades, une nef.
Il m’arrive de marcher plusieurs heures durant sans croiser de véhicule, et ce dans un silence à peine troublé par l’infime chuchotement de mes foulées. Et cependant, le silence ici n’existe pas. Un bruissement constant se fait entendre – feuilles, eau, vent, mouvements – auquel viennent s’ajouter, comme autant de notes de couleur sur le fond vert des sons, les cris, les hululements et les mélodies parkeriennes des chants d’oiseaux aussi nombreux et variés que comptent de feuilles les tiges, les branches inextricablement mêlées les unes aux autres. La vie abonde et déborde en chaque lieu.
En fin de journée, éreinté mais tout aise, je dénichai un asile nocturne en surplomb de la piste. Un talus de déblai formé lors de son nivellement offrait une terrasse artificielle de pierres noires et de terre rouge, quasi nue, bordée du rideau végétal de la forêt intacte. Comme j’y montais Rotunda, des petits singes évoluèrent gaiement au-dessus de ma tête, parcourant l’architecture organique d’un arbre, et cette fois-ci m’observèrent nettement, dissimulés dans la frondaison. C’était moi, ici, l’étrange étranger. Impromptue, ma présence intriguait : mes petits compagnons semblaient partagés entre l’envie de déguerpir et la curiosité qui les poussait à s’attarder pour assister à mon installation sur leur territoire.
Le ciel qui avait été menaçant tout l’après-midi se déboucha. Je restai au seuil de mon abri une bonne partie de la soirée et dînai dans la contemplation du jour cédant place à la nuit. Illuminée par les rayons du couchant, la forêt rubescente s’embrasa et se mit littéralement à fumer. Tant d’humidité ! Un ardent voile cotonneux recouvrit le sommet des arbres, de toutes parts s’élevèrent des nappes de brume incandescentes. Au-dessous, sur l’infernale côte que dominait mon refuge, quelques rares camions peinaient à traverser un bourbier. Leur moteur s’emballait à tout rompre dans des rugissements vains.
Je les entendais s’élancer dans une énième tentative et, enlisés plus encore dans leur espoir déçu, buter à nouveau contre ce piège infranchissable. Les portières s’ouvraient, les conducteurs échangeaient quelques mots brefs, quelques consignes élémentaires. Dans une improvisation aiguillonnée par l’urgence et la nécessité, ils concevaient des stratégies qui, à force d’acharnement, se révélaient payantes. “Vaï ! Vaï ! – Vas-y ! Vas-y !” Ils gravissaient la côte, victorieux – mais pour combien de temps encore ? Une solidarité soudait ces hommes, imposée par la piste comme le désert impose le partage de l’eau : nul ne s’y refuserait sans se défaire aussitôt de sa propre humanité.
Au beau milieu de la nuit, l’un de ces forçats s’enlisa à son tour. Au bruit, il semblait seul, et je doutai longtemps qu’il franchisse l’obstacle par ses propres moyens. Il y parvint finalement au prix d’obstination et de ruse et poursuivit sa route. Son chauffeur ignorait qu’une bonne âme le surplombait, invisible et bienveillante, l’écoutant s’échiner et l’encourageant en silence.
S’éloignant, ces véhicules et leur conducteur emportaient leur agitation et une certaine compagnie, lointaine mais bien humaine. Une fois cicatrisé, le calme se recomposait peu à peu et avec lui une insondable solitude murée d’obscurité.
L’empire des ténèbres sur la forêt, lorsqu’on se trouve seul en son sein, est tout bonnement effrayant les premiers temps. Tout intrigue, tout inquiète, car tout bouge, tout bruisse et tout babille en une polyphonie babélienne. Cris des oiseaux nocturnes ; feuilles qui s’abattent lourdement sur le sol après s’être entrechoquées, durant leur tombée en cascade depuis les hauteurs, avec d’autres feuilles ; frémissements, craquements, crépitements, frôlements, chuintements, chocs sourds et soudains ; et par-dessus tout, l’incessante chute des minuscules perles d’eau dégouttant par dizaines de chacune des millions, des milliards de feuilles que compte la forêt, gouttelettes qui s’épanchent sur le sol après avoir rebondi sur d’autres feuilles qui, ébranlées, déversent à leur tour leur propre trop-plein d’humidité. Cet égouttement permanent et infrangible suscite des hallucinations auditives : le son produit par l’ensemble donne l’illusion qu’il pleut. On se surprend à tendre l’oreille pour localiser le ruisseau qui tinte à proximité ; à tendre le bras pour s’assurer qu’il bruine comme on le croit? En vain : cette cascatelle perpétuelle n’est autre que la transpiration ininterrompue de l’épiderme végétal.
Éveillé à l’aube, je prends conscience que cet environnement soumet les hommes à une temporalité bien différente de celle des villes. Le temps se décompose, se dissout et se corrompt dans l’humus des conditions imposées par le milieu. Cette piste et les nombreux imprévus qui la jalonnent impliquent que les véhicules n’arrivent jamais à l’heure escomptée ; pas d’électricité en dehors de l’usage des – rares – générateurs, et par conséquent une intrusion très faible du monde extérieur, des médias et de leurs cycles indépendants de ceux de la journée et des saisons? La ponctualité, qui n’a de sens que dans un univers quadrillé, domestiqué, n’est pas de ce monde-ci. L’homme s’adapte et ne maîtrise que le peu qu’il lui est donné de maîtriser. C’est-à-dire rien. »
(p. 208-211)
Rio Grande do Sul (p. 33-37)
Maranhão (Nordeste) (p. 152-155)
Extrait court


