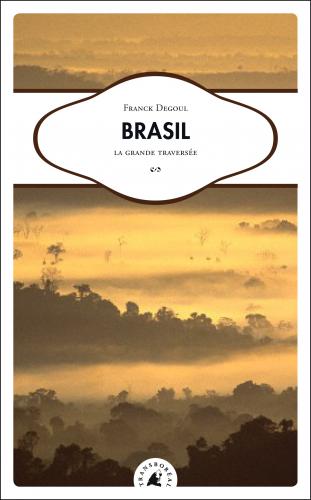
Rio Grande do Sul :
« À quelques jours près et par quelque hasard singulier, je fis ma première rencontre avec des Amérindiens alors que l’anthropologue Claude Lévi-Strauss décédait en emportant avec lui un pan capital de la pensée du XXe siècle. Peu après le village de Sertão Santana, et ce sur près d’une trentaine de kilomètres, une signalisation récurrente éveilla ma curiosité. Des panneaux indiquaient la présence d’“Acampamentos Indígenas”. Quel pouvait être l’intérêt de signaler des campements indigènes ? Le long de la route il est vrai, je relevai la présence de baraquements de fortune constitués de matériaux de récupération élimés et vieillis. Un entrelacs de tiges de bambou recouvertes de bâches en plastique rapiécées d’ajouts multicolores en formait l’ossature.
À proximité de ces cases précaires s’allongeaient de bas présentoirs en bois noués. Ceux-ci étaient cependant vides, comme toutes les cabanes alentour qui, le plus souvent closes, semblaient inoccupées. Peut-être enfouissaient-elles leurs occupants pour les abriter de la pluie ? Je ne pouvais distinguer âme qui vive.
Un peu plus loin, j’avisai des silhouettes cheminant sur l’accotement opposé. Progressivement, ces formes lointaines se précisèrent et, alors que j’arrivais à leur hauteur, c’est à une vision étrange qu’elles cédèrent la place. Un petit groupe d’individus, une famille, progressant en colonne, les parents en tête et les enfants en queue, transportant des sacs de jute remplis d’effets. Des Indiens, avançant avec cette détermination résignée propre à l’exil et évoquant ces scènes de réfugiés fuyant quelque catastrophe auxquelles la télévision nous a hélas habitués.
Lorsque nous fûmes tout proches, je saluai le père qui répondit d’un geste absent, manifestement absorbé par tout autre chose que ma présence. La femme et les fillettes arboraient de longs cheveux lisses d’un noir luisant, encadrant un visage de peau cuivrée aux yeux finement étirés. Je ne savais trop ce qui se passait. Je conservais cette scène en moi le jour durant, hanté par cette vision entêtante dont mes pensées ne parvenaient à se défaire. Des indigènes sans résidence, errant, en route vers le néant?
Claude Lévi-Strauss venait d’incorporer pour de bon le monde des mythes dont il avait si grandement contribué à élucider les fondements structurels et l’organisation symbolique, et, bien qu’ignorant alors sa disparition, j’eus une pensée pour le grand homme à l’occasion de cette rencontre étrange et comme allégorique. Deux destinées se croisant de part et d’autre d’un axe acquis au transport marchand où les produits vont et viennent dans les deux sens sans interruption. Quelle vision conserveraient-ils, ces exilés, de ce moment où ils aperçurent un homme seul, marchant sac au dos, vers une destination et pour un motif inconnus d’eux, à contresens de leur propre trajectoire ? Je ne devais comprendre la raison de ce déplacement que le lendemain.
Ce matin-là, dans l’ombrage criblé de vives clartés, derrière des présentoirs approvisionnés, des groupes de personnes, des familles, vaquaient à la confection d’objets artisanaux. J’eus la tentation d’établir un contact spontané, mais me ravisai. Qu’allais-je bien pouvoir leur demander, à ces Indiens affairés ? N’y aurait-il pas méprise ? Je continuai mon chemin, me reprochant cette timidité, cette crainte dont les raisons me semblaient douteuses. La prochaine occasion serait la bonne.
Partant de la route, un sentier serpentait parmi une végétation clairsemée et paraissait déboucher sur l’un des campements indiqués. Je l’empruntai pour me retrouver, au bout de quelques mètres, à l’orée d’un village en miniature : quelques cases en bambou étroitement ramassées, certaines couvertes de torchis, d’autres de bâches froissées. Une quinzaine de personnes y vivait, toutes affairées à des tâches diverses, au point que mon irruption au seuil de cet espace passa parfaitement inaperçue. Je m’annonçai : “Por favor? ?”
Cours brisé, souffle retenu, la petite communauté se rétracta aussitôt dans un silence épais. Convergeant vers ma personne, des regards interloqués fusaient de toute part et me détaillaient attentivement.
Un homme dans la quarantaine vint à ma rencontre d’un pas lent, comme s’il s’était agi de retarder le contact. Lorsque nous fûmes face à face, j’exposai les raisons de ma venue : curiosité de les connaître, de comprendre les raisons de leur présence au bord de cette route, et le mystère que constituait pour moi cette signalisation si bien disposée, instituant la précarité de leur installation en marge de cette voie de circulation. Je ne faisais que passer et, passant, je désirais approcher et découvrir. Je ne resterais pas longtemps : juste assez pour faire connaissance.
L’homme m’écoutait avec une patience et un calme souverains. Lorsque j’eus fini, il hocha la tête et, me demandant de patienter, s’en fut avec une égale lenteur consulter les membres de son groupe.
Je demeurais immobile, veillant à ce qu’aucun geste maladroit ne vînt prêter à confusion au sujet de mes intentions. Plusieurs minutes s’écoulèrent ainsi, dans un calme parfait. Quittant le groupe avec lequel il venait de s’entretenir à voix basse, l’intercesseur pénétra dans l’une des cases où il disparut quelques instants. Je redoutais un refus.
Il réapparut finalement muni de deux petits sièges sculptés qu’il installa, l’un en face de l’autre, à l’endroit où il m’avait laissé. Ce geste dépourvu d’une quelconque parole signifiait l’accord du groupe et le sien, et l’acceptation de la rencontre.
L’entrevue dura une heure au cours de laquelle André évoqua les problèmes auxquels sa famille élargie ainsi que les autres Guaranis vivant alentour étaient confrontés. Revenant sur ses origines, il m’apprit qu’il était né au Paraguay où se trouve la plus grande communauté guarani et où leur langue partage, avec l’espagnol, un statut officiel. Il poursuivit sur ses séjours en Argentine, puis en Uruguay où André et ses parents vécurent quelques années avant de migrer au Brésil où se trouve le deuxième plus grand foyer de leur ethnie : environ 30 000 personnes qui composent le principal peuplement indigène du pays.
Au moment de notre rencontre, André avait fondé sa propre famille et vivait depuis deux ans dans ce campement de fortune situé à la sortie de la ville de Barra do Ribeiro, entre la route fédérale et un vaste champ hérissé de clôtures. Quoi que déjà fort précaire, ce camp de sans-terre était voué à disparaître sous peu : une piste devait le traverser qui jetterait de nouveau sur les routes ces pauvres hères sans feu ni lieu. Le ministère brésilien en charge des travaux promettait de trouver une solution, mais rien n’était moins sûr. Une hostilité quasi générale stigmatisait ces indésirables. Elle était plus particulièrement le fait des grands propriétaires terriens, éleveurs et exploitants agricoles, qui recouraient au service d’hommes de main pour les intimider et les brutaliser – parfois jusqu’à la mort.
Dans les environs, au sein de campements identiques et plus ou moins éloignés de la route fédérale, trente-deux familles guaranis subissaient le même sort. Illégale au regard de la loi, mais légitime à leurs yeux, cette occupation était tout à la fois une manière de survivre, et une façon de rendre visible le problème qui les avait chassées et marginalisées, réduites à l’errance : la spoliation de leur terre au profit de l’élevage fermier extensif et de la lucrative culture du soja. La vie dans ces camps ? Malnutrition des enfants. Assassinat des meneurs qui osent organiser l’action. Suicides?
Ce problème concerne toutes les implantations guaranis au Brésil. Alors qu’ils occupaient autrefois un territoire de près de 350 000 kilomètres carrés de forêts et de plaines, ils s’entassent aujourd’hui sur de petites parcelles encerclées par les fermes d’élevage et les vastes plantations, avant de connaître le campement en bord de route lorsqu’il ne subsiste plus de leur territoire que l’espace pour un pas, celui du départ.
Certes, leur démarche est soutenue par la FUNAI, la Fundação Nacional do Índio (“Fondation nationale de l’Indien”), organe fédéral responsable de l’établissement et de l’exécution de la politique “indigéniste” brésilienne définie dans la constitution de 1988. Son action en faveur du retour des Indiens à la terre demeure toutefois insuffisante : la situation décrite est, hélas, toujours d’actualité. »
Maranhão (Nordeste) (p. 152-155)
Épilogue (p. 208-211)
Extrait court
« À quelques jours près et par quelque hasard singulier, je fis ma première rencontre avec des Amérindiens alors que l’anthropologue Claude Lévi-Strauss décédait en emportant avec lui un pan capital de la pensée du XXe siècle. Peu après le village de Sertão Santana, et ce sur près d’une trentaine de kilomètres, une signalisation récurrente éveilla ma curiosité. Des panneaux indiquaient la présence d’“Acampamentos Indígenas”. Quel pouvait être l’intérêt de signaler des campements indigènes ? Le long de la route il est vrai, je relevai la présence de baraquements de fortune constitués de matériaux de récupération élimés et vieillis. Un entrelacs de tiges de bambou recouvertes de bâches en plastique rapiécées d’ajouts multicolores en formait l’ossature.
À proximité de ces cases précaires s’allongeaient de bas présentoirs en bois noués. Ceux-ci étaient cependant vides, comme toutes les cabanes alentour qui, le plus souvent closes, semblaient inoccupées. Peut-être enfouissaient-elles leurs occupants pour les abriter de la pluie ? Je ne pouvais distinguer âme qui vive.
Un peu plus loin, j’avisai des silhouettes cheminant sur l’accotement opposé. Progressivement, ces formes lointaines se précisèrent et, alors que j’arrivais à leur hauteur, c’est à une vision étrange qu’elles cédèrent la place. Un petit groupe d’individus, une famille, progressant en colonne, les parents en tête et les enfants en queue, transportant des sacs de jute remplis d’effets. Des Indiens, avançant avec cette détermination résignée propre à l’exil et évoquant ces scènes de réfugiés fuyant quelque catastrophe auxquelles la télévision nous a hélas habitués.
Lorsque nous fûmes tout proches, je saluai le père qui répondit d’un geste absent, manifestement absorbé par tout autre chose que ma présence. La femme et les fillettes arboraient de longs cheveux lisses d’un noir luisant, encadrant un visage de peau cuivrée aux yeux finement étirés. Je ne savais trop ce qui se passait. Je conservais cette scène en moi le jour durant, hanté par cette vision entêtante dont mes pensées ne parvenaient à se défaire. Des indigènes sans résidence, errant, en route vers le néant?
Claude Lévi-Strauss venait d’incorporer pour de bon le monde des mythes dont il avait si grandement contribué à élucider les fondements structurels et l’organisation symbolique, et, bien qu’ignorant alors sa disparition, j’eus une pensée pour le grand homme à l’occasion de cette rencontre étrange et comme allégorique. Deux destinées se croisant de part et d’autre d’un axe acquis au transport marchand où les produits vont et viennent dans les deux sens sans interruption. Quelle vision conserveraient-ils, ces exilés, de ce moment où ils aperçurent un homme seul, marchant sac au dos, vers une destination et pour un motif inconnus d’eux, à contresens de leur propre trajectoire ? Je ne devais comprendre la raison de ce déplacement que le lendemain.
Ce matin-là, dans l’ombrage criblé de vives clartés, derrière des présentoirs approvisionnés, des groupes de personnes, des familles, vaquaient à la confection d’objets artisanaux. J’eus la tentation d’établir un contact spontané, mais me ravisai. Qu’allais-je bien pouvoir leur demander, à ces Indiens affairés ? N’y aurait-il pas méprise ? Je continuai mon chemin, me reprochant cette timidité, cette crainte dont les raisons me semblaient douteuses. La prochaine occasion serait la bonne.
Partant de la route, un sentier serpentait parmi une végétation clairsemée et paraissait déboucher sur l’un des campements indiqués. Je l’empruntai pour me retrouver, au bout de quelques mètres, à l’orée d’un village en miniature : quelques cases en bambou étroitement ramassées, certaines couvertes de torchis, d’autres de bâches froissées. Une quinzaine de personnes y vivait, toutes affairées à des tâches diverses, au point que mon irruption au seuil de cet espace passa parfaitement inaperçue. Je m’annonçai : “Por favor? ?”
Cours brisé, souffle retenu, la petite communauté se rétracta aussitôt dans un silence épais. Convergeant vers ma personne, des regards interloqués fusaient de toute part et me détaillaient attentivement.
Un homme dans la quarantaine vint à ma rencontre d’un pas lent, comme s’il s’était agi de retarder le contact. Lorsque nous fûmes face à face, j’exposai les raisons de ma venue : curiosité de les connaître, de comprendre les raisons de leur présence au bord de cette route, et le mystère que constituait pour moi cette signalisation si bien disposée, instituant la précarité de leur installation en marge de cette voie de circulation. Je ne faisais que passer et, passant, je désirais approcher et découvrir. Je ne resterais pas longtemps : juste assez pour faire connaissance.
L’homme m’écoutait avec une patience et un calme souverains. Lorsque j’eus fini, il hocha la tête et, me demandant de patienter, s’en fut avec une égale lenteur consulter les membres de son groupe.
Je demeurais immobile, veillant à ce qu’aucun geste maladroit ne vînt prêter à confusion au sujet de mes intentions. Plusieurs minutes s’écoulèrent ainsi, dans un calme parfait. Quittant le groupe avec lequel il venait de s’entretenir à voix basse, l’intercesseur pénétra dans l’une des cases où il disparut quelques instants. Je redoutais un refus.
Il réapparut finalement muni de deux petits sièges sculptés qu’il installa, l’un en face de l’autre, à l’endroit où il m’avait laissé. Ce geste dépourvu d’une quelconque parole signifiait l’accord du groupe et le sien, et l’acceptation de la rencontre.
L’entrevue dura une heure au cours de laquelle André évoqua les problèmes auxquels sa famille élargie ainsi que les autres Guaranis vivant alentour étaient confrontés. Revenant sur ses origines, il m’apprit qu’il était né au Paraguay où se trouve la plus grande communauté guarani et où leur langue partage, avec l’espagnol, un statut officiel. Il poursuivit sur ses séjours en Argentine, puis en Uruguay où André et ses parents vécurent quelques années avant de migrer au Brésil où se trouve le deuxième plus grand foyer de leur ethnie : environ 30 000 personnes qui composent le principal peuplement indigène du pays.
Au moment de notre rencontre, André avait fondé sa propre famille et vivait depuis deux ans dans ce campement de fortune situé à la sortie de la ville de Barra do Ribeiro, entre la route fédérale et un vaste champ hérissé de clôtures. Quoi que déjà fort précaire, ce camp de sans-terre était voué à disparaître sous peu : une piste devait le traverser qui jetterait de nouveau sur les routes ces pauvres hères sans feu ni lieu. Le ministère brésilien en charge des travaux promettait de trouver une solution, mais rien n’était moins sûr. Une hostilité quasi générale stigmatisait ces indésirables. Elle était plus particulièrement le fait des grands propriétaires terriens, éleveurs et exploitants agricoles, qui recouraient au service d’hommes de main pour les intimider et les brutaliser – parfois jusqu’à la mort.
Dans les environs, au sein de campements identiques et plus ou moins éloignés de la route fédérale, trente-deux familles guaranis subissaient le même sort. Illégale au regard de la loi, mais légitime à leurs yeux, cette occupation était tout à la fois une manière de survivre, et une façon de rendre visible le problème qui les avait chassées et marginalisées, réduites à l’errance : la spoliation de leur terre au profit de l’élevage fermier extensif et de la lucrative culture du soja. La vie dans ces camps ? Malnutrition des enfants. Assassinat des meneurs qui osent organiser l’action. Suicides?
Ce problème concerne toutes les implantations guaranis au Brésil. Alors qu’ils occupaient autrefois un territoire de près de 350 000 kilomètres carrés de forêts et de plaines, ils s’entassent aujourd’hui sur de petites parcelles encerclées par les fermes d’élevage et les vastes plantations, avant de connaître le campement en bord de route lorsqu’il ne subsiste plus de leur territoire que l’espace pour un pas, celui du départ.
Certes, leur démarche est soutenue par la FUNAI, la Fundação Nacional do Índio (“Fondation nationale de l’Indien”), organe fédéral responsable de l’établissement et de l’exécution de la politique “indigéniste” brésilienne définie dans la constitution de 1988. Son action en faveur du retour des Indiens à la terre demeure toutefois insuffisante : la situation décrite est, hélas, toujours d’actualité. »
(p. 33-37)
Maranhão (Nordeste) (p. 152-155)
Épilogue (p. 208-211)
Extrait court


