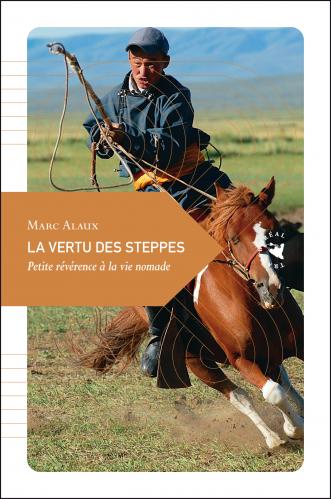
Rencontre avec le divin :
« La steppe, c’est l’absence de faux-semblants. À chaque instant s’impose un choix qui dévoile et engage toute la personne. On se sent privé de protection ou au contraire affranchi de toute limite. Rien ne sauve du vent mais rien n’entrave la volonté. On y mesure son courage. Le voyage y est une trajectoire circulaire qui ramène à sa personnalité, la nature fonctionnant tel un miroir de chaman, passe-muraille qui permet de voir à l’intérieur des choses. L’immensité devient alors une dimension intime et, pour certains, dominer la steppe revient à inviter Dieu en soi. Si Ferdynand Ossendowski a nommé son récit de fuite en Haute-Asie en 1921 Bêtes, hommes et dieux, c’est peut-être parce que selon lui le dialogue entre ces trois éléments se poursuit dans la steppe, qui devient un lieu de libération de l’âme. Maints voyageurs contemporains y voient, en effet, à travers l’absence fantasmée de l’homme, la présence du divin, comme s’il avait une adresse !
L’alchimie des émotions ne rapproche-t-elle pas le voyageur qui enfouit ses fantasmes dans la steppe du barde mongol qui dit chanter sous son influence ? Tous deux ne disent-ils pas recevoir la steppe quand ils la chargent d’une dimension métaphorique ? J’ignore si en entrant dans ma vie, la steppe a invité Dieu en moi, mais, pour sûr, elle a recomposé l’ordre de la matière qui me constitue. Mon être y ressent un bonheur nullement grandi ou modéré par les conditions de la société. Me livrer aux humeurs de cet univers sans pitié me procure paradoxalement une douce félicité, celle de sentir mon corps inondé de sève. La bise me blesse et m’exalte à la fois, soulignant qu’il est bon de vivre. J’aime la steppe quand elle met ma conscience à nu et me contraint à reconnaître dans la nature sauvage une part de moi-même. L’anéantissement salvateur des instincts qu’offre la marche m’est donc indispensable : je suis d’une farine qui doit être pétrie durement. Me projeter hors de moi, traverser mon corps m’aide à percevoir mon environnement et à trouver mon Orient intérieur.
On se tromperait en pensant que les nomades d’Asie centrale perpétuent, depuis des régions d’où l’écho du monde se perçoit avec recul, un mode de vie ancestral. Ils ont absolument tous intégré, en Chine ou en urss, le giron communiste à partir des années 1920, et les deux décennies écoulées depuis la désintégration du bloc soviétique montrent que le pastoralisme nomade continue d’agréger des éléments allogènes. Mais ce mode de gestion des ressources apparaît également menacé dans ses fondements. La conversion au communisme fut dans certaines régions un changement moins radical pour les hommes que l’initiation au libéralisme économique. Les nomades sont ainsi moins mobiles qu’à la période précollectiviste mais également moins qu’à la période collectiviste ! Dans le tohu-bohu du village-monde, la steppe reste toutefois une référence : les Mongols aiment les visages “larges et plats comme la steppe”, et par leurs funérailles célestes – le dépôt du corps dans la steppe est encore commun en Mongolie –, ils deviennent eux-mêmes “hôtes de la steppe caillouteuse”. La diversité de ce milieu disparaît devant notre fascination qui illustre un besoin de nature marginale pour trouver un sens à l’univers. Mais avant d’être une réalité fictionnelle à la sagesse immanente, la steppe est un paysage culturel sensible, une vague dont l’homme n’est pas seulement l’écume.
Entonné par les chœurs de l’armée Rouge, Oh, ma vaste steppe, de Dimitri Oleg Yachinov, résonne chez moi pour m’aider à souffler ces derniers mots. La steppe n’a d’autre vertu que celle que nous lui donnons. Mais après tout, peut-être faut-il l’ériger en barrière contre ce qui menace l’humanité ? Alors on peut y exister sans idéologie, “avec la bonté pour guide” selon le poète bouriate Piotr Nikiforovitch Dambinov. Que ma vie me semble vide quand je ne tente pas de faire de mon voisinage une steppe, assez vaste pour que tous les regards y trouvent leur place, et d’adopter un état d’esprit nomade, ouvert au changement et à la rencontre ! Le nomadisme impose l’alternance dans le partage du territoire et une liberté de circulation supérieure à ce que nos sociétés acceptent. On a cartographié le monde en une géographie bipolaire : l’humanité nomade, cosmopolite, belle mais bientôt vaincue, et l’humanité sédentaire, nationaliste, viciée mais conquérante. Prenons garde à la psychologie des peuples ! La vertu ne s’acquiert pas à la naissance mais se gagne par un rude combat. Et la frontière qui sépare le bien du mal, notait Soljenitsyne, ne s’érige pas entre nous mais en nous.
Je craque une allumette et brûle une pincée de poudre de genévrier. La fumée monte droit pareille à celle qui sort des yourtes par beau temps. Elle sert de support à mes rêves, comme l’horizon qui, rincé par l’averse estivale, noircit la page de la steppe d’une ligne unique. Devant elle, je fais le serment d’entendre à nouveau les grues cendrées et les tadornes annoncer le printemps des cols du Khinggan aux glaciers de l’Altai. J’ai besoin de sentir l’hiver enneiger pesamment le faisceau des pistes qui se dispersent et transmuer la nudité ambrée des pâturages en paillasse rugueuse et austère. Enfin, je continuerai d’apprendre la langue du nomade pour traverser sa parole comme j’ai traversé les steppes et comprendre sa façon de dire un monde où, poussée par le vent, la pensée qui court librement offre un avenir à l’homme. »
Un monde pétri d’immensité (p. 15-18)
Creuset d’idées reçues (p. 36-41)
Extrait court
« La steppe, c’est l’absence de faux-semblants. À chaque instant s’impose un choix qui dévoile et engage toute la personne. On se sent privé de protection ou au contraire affranchi de toute limite. Rien ne sauve du vent mais rien n’entrave la volonté. On y mesure son courage. Le voyage y est une trajectoire circulaire qui ramène à sa personnalité, la nature fonctionnant tel un miroir de chaman, passe-muraille qui permet de voir à l’intérieur des choses. L’immensité devient alors une dimension intime et, pour certains, dominer la steppe revient à inviter Dieu en soi. Si Ferdynand Ossendowski a nommé son récit de fuite en Haute-Asie en 1921 Bêtes, hommes et dieux, c’est peut-être parce que selon lui le dialogue entre ces trois éléments se poursuit dans la steppe, qui devient un lieu de libération de l’âme. Maints voyageurs contemporains y voient, en effet, à travers l’absence fantasmée de l’homme, la présence du divin, comme s’il avait une adresse !
L’alchimie des émotions ne rapproche-t-elle pas le voyageur qui enfouit ses fantasmes dans la steppe du barde mongol qui dit chanter sous son influence ? Tous deux ne disent-ils pas recevoir la steppe quand ils la chargent d’une dimension métaphorique ? J’ignore si en entrant dans ma vie, la steppe a invité Dieu en moi, mais, pour sûr, elle a recomposé l’ordre de la matière qui me constitue. Mon être y ressent un bonheur nullement grandi ou modéré par les conditions de la société. Me livrer aux humeurs de cet univers sans pitié me procure paradoxalement une douce félicité, celle de sentir mon corps inondé de sève. La bise me blesse et m’exalte à la fois, soulignant qu’il est bon de vivre. J’aime la steppe quand elle met ma conscience à nu et me contraint à reconnaître dans la nature sauvage une part de moi-même. L’anéantissement salvateur des instincts qu’offre la marche m’est donc indispensable : je suis d’une farine qui doit être pétrie durement. Me projeter hors de moi, traverser mon corps m’aide à percevoir mon environnement et à trouver mon Orient intérieur.
On se tromperait en pensant que les nomades d’Asie centrale perpétuent, depuis des régions d’où l’écho du monde se perçoit avec recul, un mode de vie ancestral. Ils ont absolument tous intégré, en Chine ou en urss, le giron communiste à partir des années 1920, et les deux décennies écoulées depuis la désintégration du bloc soviétique montrent que le pastoralisme nomade continue d’agréger des éléments allogènes. Mais ce mode de gestion des ressources apparaît également menacé dans ses fondements. La conversion au communisme fut dans certaines régions un changement moins radical pour les hommes que l’initiation au libéralisme économique. Les nomades sont ainsi moins mobiles qu’à la période précollectiviste mais également moins qu’à la période collectiviste ! Dans le tohu-bohu du village-monde, la steppe reste toutefois une référence : les Mongols aiment les visages “larges et plats comme la steppe”, et par leurs funérailles célestes – le dépôt du corps dans la steppe est encore commun en Mongolie –, ils deviennent eux-mêmes “hôtes de la steppe caillouteuse”. La diversité de ce milieu disparaît devant notre fascination qui illustre un besoin de nature marginale pour trouver un sens à l’univers. Mais avant d’être une réalité fictionnelle à la sagesse immanente, la steppe est un paysage culturel sensible, une vague dont l’homme n’est pas seulement l’écume.
Entonné par les chœurs de l’armée Rouge, Oh, ma vaste steppe, de Dimitri Oleg Yachinov, résonne chez moi pour m’aider à souffler ces derniers mots. La steppe n’a d’autre vertu que celle que nous lui donnons. Mais après tout, peut-être faut-il l’ériger en barrière contre ce qui menace l’humanité ? Alors on peut y exister sans idéologie, “avec la bonté pour guide” selon le poète bouriate Piotr Nikiforovitch Dambinov. Que ma vie me semble vide quand je ne tente pas de faire de mon voisinage une steppe, assez vaste pour que tous les regards y trouvent leur place, et d’adopter un état d’esprit nomade, ouvert au changement et à la rencontre ! Le nomadisme impose l’alternance dans le partage du territoire et une liberté de circulation supérieure à ce que nos sociétés acceptent. On a cartographié le monde en une géographie bipolaire : l’humanité nomade, cosmopolite, belle mais bientôt vaincue, et l’humanité sédentaire, nationaliste, viciée mais conquérante. Prenons garde à la psychologie des peuples ! La vertu ne s’acquiert pas à la naissance mais se gagne par un rude combat. Et la frontière qui sépare le bien du mal, notait Soljenitsyne, ne s’érige pas entre nous mais en nous.
Je craque une allumette et brûle une pincée de poudre de genévrier. La fumée monte droit pareille à celle qui sort des yourtes par beau temps. Elle sert de support à mes rêves, comme l’horizon qui, rincé par l’averse estivale, noircit la page de la steppe d’une ligne unique. Devant elle, je fais le serment d’entendre à nouveau les grues cendrées et les tadornes annoncer le printemps des cols du Khinggan aux glaciers de l’Altai. J’ai besoin de sentir l’hiver enneiger pesamment le faisceau des pistes qui se dispersent et transmuer la nudité ambrée des pâturages en paillasse rugueuse et austère. Enfin, je continuerai d’apprendre la langue du nomade pour traverser sa parole comme j’ai traversé les steppes et comprendre sa façon de dire un monde où, poussée par le vent, la pensée qui court librement offre un avenir à l’homme. »
(p. 85-89)
Un monde pétri d’immensité (p. 15-18)
Creuset d’idées reçues (p. 36-41)
Extrait court


