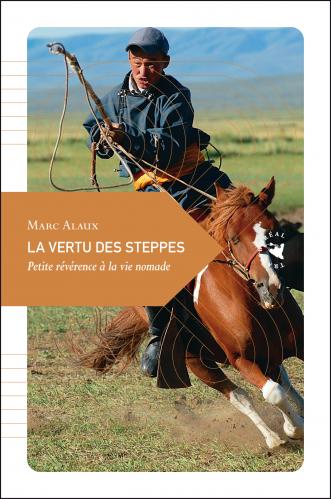
Un monde pétri d’immensité :
« Mon premier contact avec la steppe s’est apparenté à une morsure. Il s’est produit dans le plus vaste désert d’Asie, le Gobi, dans lequel je m’élançai pour plusieurs mois d’une marche harassante. Dès la troisième nuit, une tempête de neige rendit ma tente inutilisable. À l’effroi vite consumé succéda une certaine résolution, ou du moins une disposition d’esprit qui s’en approche. Traverser cet espace ne pouvant se faire sans effort, j’étais prêt à lutter, à prendre le vide d’assaut pour en venir à bout. Mais je constatai bientôt que si la volonté permet d’y subsister telle une bête, elle ne suffit pas à y vivre en homme. Car ce n’est point d’abri nocturne dont je me sentis dépourvu – je dormis les six mois suivants à la belle étoile malgré la pluie et le gel –, mais plutôt du regard adéquat pour naviguer dans un milieu indifférent au sort des hommes. Voilà ce qu’il faut acquérir, le regard qui permet d’assumer son existence en modelant une mystique de l’espace.
Aux yeux de celui qui foule la steppe, tout se passe d’abord comme si le but s’éloignait constamment. Jusqu’où s’étirent ces étendues qui vibrent de puissance ? Comment calibrer le paysage quand le simple fait de l’enfermer dans un cadre photographique falsifie ses limites ? Difficile à dire, puisqu’il se distingue moins par les obstacles physiques que par sa profondeur. Or l’évaluation d’une distance est relative. Le marcheur au long cours franchit une trentaine de kilomètres par jour. Le nomade, lui, évalue les étapes selon qu’il va à cheval (environ 60 kilomètres), à dos de chameau (20 kilomètres) ou qu’il pousse du bétail (30 kilomètres). Le terrain (enneigé, boueux ou stable) et la saison (les bêtes engraissées sont rapides l’automne mais épuisées en fin d’hiver) modifient aussi sa perception. L’immensité impose sa réalité diversement mais à tous : pour le stepniak qui se l’approprie en la cultivant, elle débute aux limites de sa parcelle mais celle-ci se fond elle-même dans l’immensité. Pour le nomade, elle pèse sur ses habitudes : afin de scruter le lointain, il garde sur lui sa lunette monoculaire qui est peut-être son outil le plus indispensable avec le cheval. L’immensité va jusqu’à se tailler une place dans le langage. Le troupeau est classé selon sa capacité à franchir l’espace en “pattes courtes” (moutons, chèvres et bovins) et “pattes longues” (chameaux, chevaux). Les anciens puisaient même dans le champ lexical de l’immensité pour définir un caractère ou souligner l’universalité d’un pouvoir : en mongol, un homme paisible est uujim dotortoi, “à l’intérieur immense”, uujim qualifiant aussi la steppe ouverte ; le premier mot de “dalaï-lama” signifie “mer” en mongol, et le nom de “Gengis Khan” viendrait du turc tenggis (“océan”).
Plutôt que de chercher à maîtriser l’immensité, les nomades l’investissent en lui forgeant une territorialité spécifique : une géographie avant tout sociale qui parle moins de paysages que d’accointances. Montagnes, sources et cairns sacrés forment des repères stables dans l’espace mais les yourtes constituent d’autres pôles, mobiles ceux-là. Ces champignons blancs calquent sur l’étendue – paysage visible – la maille des liens de parenté, d’amitié et de relations de travail – paysage invisible – pour former un espace réticulaire. Il est donc impossible à l’initié de regarder la steppe sans sentir ses occupants. Les nomades n’évoquent pas leur pays comme un océan mais comme une trame tissée, une combinaison de terroirs utiles aux éleveurs. Je reste ému par le fait qu’au terme de plusieurs jours de voyage avec un Fils de la steppe, on puisse subitement l’entendre dire, alors que le paysage n’a pas changé : “Ça y est, voilà mon pays de naissance.” »
Creuset d’idées reçues (p. 36-41)
Rencontre avec le divin (p. 85-89)
Extrait court
« Mon premier contact avec la steppe s’est apparenté à une morsure. Il s’est produit dans le plus vaste désert d’Asie, le Gobi, dans lequel je m’élançai pour plusieurs mois d’une marche harassante. Dès la troisième nuit, une tempête de neige rendit ma tente inutilisable. À l’effroi vite consumé succéda une certaine résolution, ou du moins une disposition d’esprit qui s’en approche. Traverser cet espace ne pouvant se faire sans effort, j’étais prêt à lutter, à prendre le vide d’assaut pour en venir à bout. Mais je constatai bientôt que si la volonté permet d’y subsister telle une bête, elle ne suffit pas à y vivre en homme. Car ce n’est point d’abri nocturne dont je me sentis dépourvu – je dormis les six mois suivants à la belle étoile malgré la pluie et le gel –, mais plutôt du regard adéquat pour naviguer dans un milieu indifférent au sort des hommes. Voilà ce qu’il faut acquérir, le regard qui permet d’assumer son existence en modelant une mystique de l’espace.
Aux yeux de celui qui foule la steppe, tout se passe d’abord comme si le but s’éloignait constamment. Jusqu’où s’étirent ces étendues qui vibrent de puissance ? Comment calibrer le paysage quand le simple fait de l’enfermer dans un cadre photographique falsifie ses limites ? Difficile à dire, puisqu’il se distingue moins par les obstacles physiques que par sa profondeur. Or l’évaluation d’une distance est relative. Le marcheur au long cours franchit une trentaine de kilomètres par jour. Le nomade, lui, évalue les étapes selon qu’il va à cheval (environ 60 kilomètres), à dos de chameau (20 kilomètres) ou qu’il pousse du bétail (30 kilomètres). Le terrain (enneigé, boueux ou stable) et la saison (les bêtes engraissées sont rapides l’automne mais épuisées en fin d’hiver) modifient aussi sa perception. L’immensité impose sa réalité diversement mais à tous : pour le stepniak qui se l’approprie en la cultivant, elle débute aux limites de sa parcelle mais celle-ci se fond elle-même dans l’immensité. Pour le nomade, elle pèse sur ses habitudes : afin de scruter le lointain, il garde sur lui sa lunette monoculaire qui est peut-être son outil le plus indispensable avec le cheval. L’immensité va jusqu’à se tailler une place dans le langage. Le troupeau est classé selon sa capacité à franchir l’espace en “pattes courtes” (moutons, chèvres et bovins) et “pattes longues” (chameaux, chevaux). Les anciens puisaient même dans le champ lexical de l’immensité pour définir un caractère ou souligner l’universalité d’un pouvoir : en mongol, un homme paisible est uujim dotortoi, “à l’intérieur immense”, uujim qualifiant aussi la steppe ouverte ; le premier mot de “dalaï-lama” signifie “mer” en mongol, et le nom de “Gengis Khan” viendrait du turc tenggis (“océan”).
Plutôt que de chercher à maîtriser l’immensité, les nomades l’investissent en lui forgeant une territorialité spécifique : une géographie avant tout sociale qui parle moins de paysages que d’accointances. Montagnes, sources et cairns sacrés forment des repères stables dans l’espace mais les yourtes constituent d’autres pôles, mobiles ceux-là. Ces champignons blancs calquent sur l’étendue – paysage visible – la maille des liens de parenté, d’amitié et de relations de travail – paysage invisible – pour former un espace réticulaire. Il est donc impossible à l’initié de regarder la steppe sans sentir ses occupants. Les nomades n’évoquent pas leur pays comme un océan mais comme une trame tissée, une combinaison de terroirs utiles aux éleveurs. Je reste ému par le fait qu’au terme de plusieurs jours de voyage avec un Fils de la steppe, on puisse subitement l’entendre dire, alors que le paysage n’a pas changé : “Ça y est, voilà mon pays de naissance.” »
(p. 15-18)
Creuset d’idées reçues (p. 36-41)
Rencontre avec le divin (p. 85-89)
Extrait court


