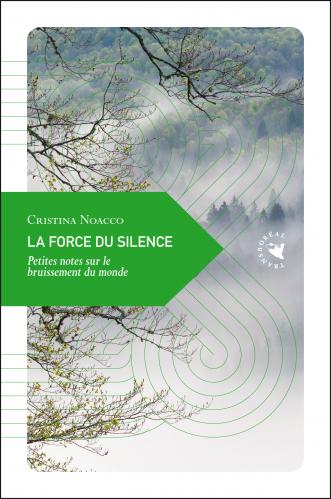
Le cri du silence :
« Si le silence est d’or et la parole d’argent, comme l’affirme le dicton, à quoi ressemble la parole tue, celle qui demeure inexprimée ? Il ne s’agit pas ici d’analyser le prétendu silence animal, qui amènerait à dire, d’un animal de compagnie, qu’”il ne lui manque que la parole”, ni de la voix des objets, projection de l’âme humaine sur la matière inanimée, mais de toutes les situations où le non-dit s’appuie sur une communication non verbale, surtout lorsqu’il tire sa force de l’absence de langage verbal. L’expression des sentiments, qu’ils soient constructifs ou destructeurs, se passe de la parole : deux amis marchent côte à côte sans besoin d’exposer les idées qu’ils partagent ; deux amoureux croisent leurs regards pleins de promesses ; un vieux couple se comprend sans parler, tel autre est devenu indifférent à tout échange ; deux hommes manifestent une attitude méprisante. Jusqu’au silence de la haine et à celui qui accompagne le crime ou la vengeance, l’assaut ou l’attentat. Parmi les mille et un exemples que je pourrais citer du langage non verbal, j’aime me souvenir des personnes rencontrées au fil de mes pérégrinations sur les chemins himalayens. Ne connaissant pas la langue des contrées visitées, c’est aux regards, aux sourires et aux gestes que j’ai confié mon désir d’échange, et je dois reconnaître qu’il n’a pas été nécessaire de parler pour comprendre, pour demander et pour recevoir un message offert avec une générosité spontanée. La pauvreté non plus n’a pas besoin de crier : une main tendue est suffisamment parlante, et feindre de ne pas la voir indique de quel côté se situe le vrai manque. Je me souviens tout particulièrement d’une famille à Hanupatta, au cœur de la vallée isolée et faiblement peuplée du Zanskar, dans l’Himalaya indien. Au bout d’une marche rendue harassante par un sac lourd, l’altitude et la chaleur, j’étais enfin arrivée en vue d’un hameau. Dans les champs en contrebas de la route, un petit groupe de personnes était occupé à moissonner l’orge. En me voyant, un enfant a levé les bras en signe de joie et sa mère a aussitôt posé la faucille pour me rejoindre et m’inviter du regard à loger chez elle. Dans la pièce unique et sombre de son habitation, elle m’a offert du thé au beurre de yack et de la farine d’orge (la fameuse tsampa, base de l’alimentation locale), puis, tout en me souriant, elle a pris son plus jeune enfant dans les bras, a découvert son sein et l’a bercé pendant qu’il tétait goulûment. Le regard intense que la jeune maman et son bébé ont échangé pendant un long moment disait la symbiose des deux êtres unis pour la vie, la tendresse qui dépasse toute parole et qu’aucun discours ne pourrait restituer. Cette scène, digne des clairs-obscurs de Rembrandt et des maternités de Lippi, tout comme le moment que j’ai passé avec Tenzin, le fils aîné, curieux de voir mon livre et désireux d’en copier les images, à défaut d’en comprendre le texte, restera gravée dans ma mémoire avec la force du silence qui l’a célébrée. Le soir venu, j’ai partagé avec le jeune couple, leurs enfants et leurs parents un repas de fête préparé en mon honneur, assis autour du tandoor, et j’ai assisté à la veillée rituelle, rythmée par le mouvement circulaire du moulin à prières du chef de famille ; le silence alors a porté à sa plus haute expression un moment très intense de communion, en me donnant à comprendre qu’il est la clé et la mesure du langage universel. Connaître l’alphabet du silence nous permet de nous ouvrir à la compassion, à la compréhension et au partage de nos différences. »
La quête du silence (p. 11-13)
Le pouvoir de l’écrit (p. 57-61)
Extrait court
« Si le silence est d’or et la parole d’argent, comme l’affirme le dicton, à quoi ressemble la parole tue, celle qui demeure inexprimée ? Il ne s’agit pas ici d’analyser le prétendu silence animal, qui amènerait à dire, d’un animal de compagnie, qu’”il ne lui manque que la parole”, ni de la voix des objets, projection de l’âme humaine sur la matière inanimée, mais de toutes les situations où le non-dit s’appuie sur une communication non verbale, surtout lorsqu’il tire sa force de l’absence de langage verbal. L’expression des sentiments, qu’ils soient constructifs ou destructeurs, se passe de la parole : deux amis marchent côte à côte sans besoin d’exposer les idées qu’ils partagent ; deux amoureux croisent leurs regards pleins de promesses ; un vieux couple se comprend sans parler, tel autre est devenu indifférent à tout échange ; deux hommes manifestent une attitude méprisante. Jusqu’au silence de la haine et à celui qui accompagne le crime ou la vengeance, l’assaut ou l’attentat. Parmi les mille et un exemples que je pourrais citer du langage non verbal, j’aime me souvenir des personnes rencontrées au fil de mes pérégrinations sur les chemins himalayens. Ne connaissant pas la langue des contrées visitées, c’est aux regards, aux sourires et aux gestes que j’ai confié mon désir d’échange, et je dois reconnaître qu’il n’a pas été nécessaire de parler pour comprendre, pour demander et pour recevoir un message offert avec une générosité spontanée. La pauvreté non plus n’a pas besoin de crier : une main tendue est suffisamment parlante, et feindre de ne pas la voir indique de quel côté se situe le vrai manque. Je me souviens tout particulièrement d’une famille à Hanupatta, au cœur de la vallée isolée et faiblement peuplée du Zanskar, dans l’Himalaya indien. Au bout d’une marche rendue harassante par un sac lourd, l’altitude et la chaleur, j’étais enfin arrivée en vue d’un hameau. Dans les champs en contrebas de la route, un petit groupe de personnes était occupé à moissonner l’orge. En me voyant, un enfant a levé les bras en signe de joie et sa mère a aussitôt posé la faucille pour me rejoindre et m’inviter du regard à loger chez elle. Dans la pièce unique et sombre de son habitation, elle m’a offert du thé au beurre de yack et de la farine d’orge (la fameuse tsampa, base de l’alimentation locale), puis, tout en me souriant, elle a pris son plus jeune enfant dans les bras, a découvert son sein et l’a bercé pendant qu’il tétait goulûment. Le regard intense que la jeune maman et son bébé ont échangé pendant un long moment disait la symbiose des deux êtres unis pour la vie, la tendresse qui dépasse toute parole et qu’aucun discours ne pourrait restituer. Cette scène, digne des clairs-obscurs de Rembrandt et des maternités de Lippi, tout comme le moment que j’ai passé avec Tenzin, le fils aîné, curieux de voir mon livre et désireux d’en copier les images, à défaut d’en comprendre le texte, restera gravée dans ma mémoire avec la force du silence qui l’a célébrée. Le soir venu, j’ai partagé avec le jeune couple, leurs enfants et leurs parents un repas de fête préparé en mon honneur, assis autour du tandoor, et j’ai assisté à la veillée rituelle, rythmée par le mouvement circulaire du moulin à prières du chef de famille ; le silence alors a porté à sa plus haute expression un moment très intense de communion, en me donnant à comprendre qu’il est la clé et la mesure du langage universel. Connaître l’alphabet du silence nous permet de nous ouvrir à la compassion, à la compréhension et au partage de nos différences. »
(p. 31-34)
La quête du silence (p. 11-13)
Le pouvoir de l’écrit (p. 57-61)
Extrait court


