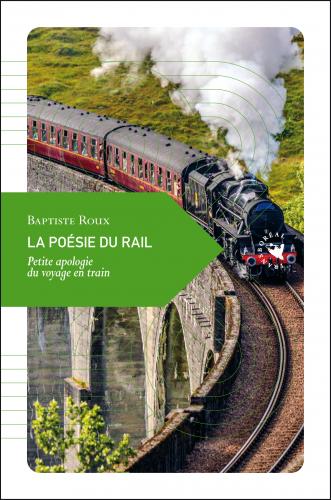
Un flot d’images :
« Ma premiÃĻre ÃĐmotion ferroviaire sur une voie de 10 kilomÃĻtres a-t-elle dÃĐcidÃĐ de ma tendresse pour les autorails ? Toujours est-il qu’à bientÃīt 40 ans leur univers me plonge dans des pensÃĐes nostalgiques. De Rodez à Brive, de NÃŪmes à GÃĐnolhac ou de La Bastide-Saint-Laurent à Mende – voie unique qui dessine de sidÃĐrants mÃĐandres entre Bagnols-les-Bains et Allenc afin d’ÃĐviter la forte dÃĐclivitÃĐ –, ces petites lignes inscrites à mÊme la chair du champ ou du vallon qu’elles traversent, et dont les ouvrages d’art forment le paraphe, soulÃĻvent en moi un flot d’images. Voies fatiguÃĐes, train rÃĐduit à une seule voiture, gares dÃĐfinitivement closes : ces subsistances anachroniques d’un monde oÃđ le chemin de fer se devait de desservir chaque chef-lieu de canton, maintenues dÃĐsormais en survie artificielle grÃĒce aux rÃĐgions, font naÃŪtre des visions de groupes de paysans endimanchÃĐs qui se rendent à la foire ou de jeunes conscrits agitant les mains aux fenÊtres des compartiments devant des femmes admiratives, scÃĻnes figÃĐes par tant de cartes postales du dÃĐbut du XXe siÃĻcle.
Bancs ÃĐtroits et vermoulus de salles d’attente envahies par la poussiÃĻre, aux balances aussi massives qu’inutiles, horloges sans aiguilles, voies envahies par les mauvaises herbes : ne demeurent plus à prÃĐsent que des vestiges, vainement combattus par une ÃĐbauche de modernitÃĐ – les panneaux d’un bleu morose oÃđ se dÃĐlave le nom des gares, conçus au dÃĐbut des annÃĐes 1980, ou les distributeurs de billets surdimensionnÃĐs en constituent les lugubres exemples –, reliques prÃĐcaires impuissantes à enrayer un dÃĐclin inexorable. Celui-ci s’appelle “substitution routiÃĻre”, ou, pire encore, prend la forme d’une musÃĐification parodique nommÃĐe “train touristique”. Contre toute raison (des moyennes infÃĐrieures à 60 kilomÃĻtres à l’heure), contre toute logique (des trains souvent vides sur l’ensemble du parcours), certaines lignes secondaires semblent achever, avec une loyautÃĐ risible, une mission oubliÃĐe par leurs donneurs d’ordre. On voit encore rouler de ces trains fantÃīmes, fringants dans leur livrÃĐe – car le matÃĐriel roulant flambant neuf est en exacte contradiction avec la vÃĐtustÃĐ des voies –, arpentant fidÃĻlement les espaces dÃĐsertÃĐs de l’Aude ou du Massif central comme des acteurs sous contrat qui jouent leur spectacle devant une salle vide.
Pourtant, en ÃĐtÃĐ, ces liaisons moribondes connaissent une nouvelle jeunesse – à tout le moins une nouvelle vie. Les gares, sortant de leur lÃĐthargie hivernale, voient se presser des randonneurs harnachÃĐs comme s’ils allaient gravir l’Everest (au Lioran), des hordes juvÃĐniles piaffant d’ÃĐnergie ou des pÃĻlerins mÃĐditatifs soucieux d’abrÃĐger la voie Regordane. TassÃĐs dans l’ÃĐtuve des autorails et recrus de sueur, ces conquÃĐrants de l’ÃĐtÃĐ paient au prix fort l’implacable logique ferroviaire : à trafic annuel modique, malthusianisme de l’ÃĐquipement et, surtout, inadaptation aux variations saisonniÃĻres.
Souvent rÃĐduite à deux voitures, la rame unique quasi dÃĐsertÃĐe en novembre clame en juillet sa dÃĐtresse face aux assauts des cantines, des glaciÃĻres et des sacs à dos. L’intÃĐrieur des compartiments prend rapidement l’aspect de la cabine des Marx Brothers dans Une nuit à l’opÃĐra. Le moindre incident tourne au comique – du moins pour l’observateur extÃĐrieur : freinage brutal renversant une thÃĐorie de valises qui entravent toute circulation ; hurlements de bÃĐbÃĐs terrorisÃĐs par la presse ; exaspÃĐration collective face au moindre retard qui semble durer des heures? Combien de paisibles familles ont dÃŧ nourrir, au cœur de la fournaise estivale, de noirs desseins à l’encontre des technocrates de la SNCF, personnages tatillons pour lesquels la circulation d’un train se limite aux seuls paramÃĻtres de la dÃĐpense par kilomÃĻtre ! »
Le rapport au temps (p. 25-27)
ComplicitÃĐ (p. 46-49)
Extrait court
« Ma premiÃĻre ÃĐmotion ferroviaire sur une voie de 10 kilomÃĻtres a-t-elle dÃĐcidÃĐ de ma tendresse pour les autorails ? Toujours est-il qu’à bientÃīt 40 ans leur univers me plonge dans des pensÃĐes nostalgiques. De Rodez à Brive, de NÃŪmes à GÃĐnolhac ou de La Bastide-Saint-Laurent à Mende – voie unique qui dessine de sidÃĐrants mÃĐandres entre Bagnols-les-Bains et Allenc afin d’ÃĐviter la forte dÃĐclivitÃĐ –, ces petites lignes inscrites à mÊme la chair du champ ou du vallon qu’elles traversent, et dont les ouvrages d’art forment le paraphe, soulÃĻvent en moi un flot d’images. Voies fatiguÃĐes, train rÃĐduit à une seule voiture, gares dÃĐfinitivement closes : ces subsistances anachroniques d’un monde oÃđ le chemin de fer se devait de desservir chaque chef-lieu de canton, maintenues dÃĐsormais en survie artificielle grÃĒce aux rÃĐgions, font naÃŪtre des visions de groupes de paysans endimanchÃĐs qui se rendent à la foire ou de jeunes conscrits agitant les mains aux fenÊtres des compartiments devant des femmes admiratives, scÃĻnes figÃĐes par tant de cartes postales du dÃĐbut du XXe siÃĻcle.
Bancs ÃĐtroits et vermoulus de salles d’attente envahies par la poussiÃĻre, aux balances aussi massives qu’inutiles, horloges sans aiguilles, voies envahies par les mauvaises herbes : ne demeurent plus à prÃĐsent que des vestiges, vainement combattus par une ÃĐbauche de modernitÃĐ – les panneaux d’un bleu morose oÃđ se dÃĐlave le nom des gares, conçus au dÃĐbut des annÃĐes 1980, ou les distributeurs de billets surdimensionnÃĐs en constituent les lugubres exemples –, reliques prÃĐcaires impuissantes à enrayer un dÃĐclin inexorable. Celui-ci s’appelle “substitution routiÃĻre”, ou, pire encore, prend la forme d’une musÃĐification parodique nommÃĐe “train touristique”. Contre toute raison (des moyennes infÃĐrieures à 60 kilomÃĻtres à l’heure), contre toute logique (des trains souvent vides sur l’ensemble du parcours), certaines lignes secondaires semblent achever, avec une loyautÃĐ risible, une mission oubliÃĐe par leurs donneurs d’ordre. On voit encore rouler de ces trains fantÃīmes, fringants dans leur livrÃĐe – car le matÃĐriel roulant flambant neuf est en exacte contradiction avec la vÃĐtustÃĐ des voies –, arpentant fidÃĻlement les espaces dÃĐsertÃĐs de l’Aude ou du Massif central comme des acteurs sous contrat qui jouent leur spectacle devant une salle vide.
Pourtant, en ÃĐtÃĐ, ces liaisons moribondes connaissent une nouvelle jeunesse – à tout le moins une nouvelle vie. Les gares, sortant de leur lÃĐthargie hivernale, voient se presser des randonneurs harnachÃĐs comme s’ils allaient gravir l’Everest (au Lioran), des hordes juvÃĐniles piaffant d’ÃĐnergie ou des pÃĻlerins mÃĐditatifs soucieux d’abrÃĐger la voie Regordane. TassÃĐs dans l’ÃĐtuve des autorails et recrus de sueur, ces conquÃĐrants de l’ÃĐtÃĐ paient au prix fort l’implacable logique ferroviaire : à trafic annuel modique, malthusianisme de l’ÃĐquipement et, surtout, inadaptation aux variations saisonniÃĻres.
Souvent rÃĐduite à deux voitures, la rame unique quasi dÃĐsertÃĐe en novembre clame en juillet sa dÃĐtresse face aux assauts des cantines, des glaciÃĻres et des sacs à dos. L’intÃĐrieur des compartiments prend rapidement l’aspect de la cabine des Marx Brothers dans Une nuit à l’opÃĐra. Le moindre incident tourne au comique – du moins pour l’observateur extÃĐrieur : freinage brutal renversant une thÃĐorie de valises qui entravent toute circulation ; hurlements de bÃĐbÃĐs terrorisÃĐs par la presse ; exaspÃĐration collective face au moindre retard qui semble durer des heures? Combien de paisibles familles ont dÃŧ nourrir, au cœur de la fournaise estivale, de noirs desseins à l’encontre des technocrates de la SNCF, personnages tatillons pour lesquels la circulation d’un train se limite aux seuls paramÃĻtres de la dÃĐpense par kilomÃĻtre ! »
(p. 37-40)
Le rapport au temps (p. 25-27)
ComplicitÃĐ (p. 46-49)
Extrait court


