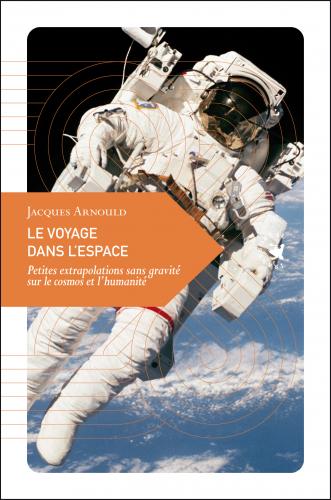
La danse de l’astronaute :
« Peut-être, pour penser l’apesanteur, avons-nous besoin de ces deux figures, celle de la danseuse en état de grâce et celle de l’astronaute en péril, respectivement incarnées par Kitsou Dubois et Sandra Bullock. Merveilleuse source de plaisir, l’apesanteur n’en est pas moins, pour un être humain, un véritable drame où se rejoignent et se heurtent les forces les plus violentes de sa condition. D’une part, le rêve du beau, la recherche de la liberté, le désir du juste qui s’expriment tout particulièrement dans l’imaginaire du vol ; bref, une sorte d’invitation au “lâcher prise” puisqu’il n’y a plus ni haut ni bas qui prévalent et que s’offrent alors tant de possibles. D’autre part, la peur de l’accident, la crainte de la chute, la menace de l’erreur ; autrement dit, l’injonction à “ne rien lâcher”, pour rappeler l’accroche du film de Cuarón. L’astronaute n’a pas à choisir entre ces deux champs de forces, mais à tirer le meilleur enseignement de chacun d’eux.
En apesanteur, chacun devient une référence, chacun devient le centre autour duquel gravite le monde, chacun occupe le centre du monde. Je me souviens de cette table ronde organisée à Nantes en 2015, à l’occasion d’un congrès européen d’astronomie. Avec un ami scientifique, je parlais de la révolution préparée par Copernic et déclenchée par Galilée et ses comparses au début du XVIIe siècle, en affirmant que la Terre tournait autour du Soleil, et j’évoquais la tirade mise par Bertolt Brecht sur les lèvres d’un “très vieux cardinal” dans sa pièce La Vie de Galilée, résumé théâtral de la prétention anthropocentrique : “Je marche d’un pas assuré sur une terre ferme, elle est fixe, elle est le centre de l’univers, et moi, je suis au centre, et l’œil du Créateur est fixé sur moi et sur moi seul?”
Les révolutions des astronautes autour de la Terre, “interprétées” par la danseuse en apesanteur aérienne, auraient donc achevé celle des scientifiques du XVIIe siècle : l’univers est une sphère dont le centre est partout, puisque chacun d’entre nous peut en devenir un, et dont la circonférence est nulle part puisqu’il a toutes les apparences de l’infini. En desserrant notre lien gravitationnel, nous resserrons notre relation à l’univers et, sans doute, éprouvons-nous davantage le sentiment océanique dont Rolland entretenait Freud avec passion?
Toutefois, n’oublions pas la leçon donnée par Gravity : même avec grâce, Nijinski et Gagarine finissent par rejoindre le sol ; la nage de Leonov, la marche d’Armstrong et d’Aldrin se sont de même terminées par un brutal atterrissage sur le sol kazakh ou une plongée dans l’océan Pacifique. »
Perspective plongeante (p. 35-37)
Conquête spatiale (p. 81-83)
Extrait court
« Peut-être, pour penser l’apesanteur, avons-nous besoin de ces deux figures, celle de la danseuse en état de grâce et celle de l’astronaute en péril, respectivement incarnées par Kitsou Dubois et Sandra Bullock. Merveilleuse source de plaisir, l’apesanteur n’en est pas moins, pour un être humain, un véritable drame où se rejoignent et se heurtent les forces les plus violentes de sa condition. D’une part, le rêve du beau, la recherche de la liberté, le désir du juste qui s’expriment tout particulièrement dans l’imaginaire du vol ; bref, une sorte d’invitation au “lâcher prise” puisqu’il n’y a plus ni haut ni bas qui prévalent et que s’offrent alors tant de possibles. D’autre part, la peur de l’accident, la crainte de la chute, la menace de l’erreur ; autrement dit, l’injonction à “ne rien lâcher”, pour rappeler l’accroche du film de Cuarón. L’astronaute n’a pas à choisir entre ces deux champs de forces, mais à tirer le meilleur enseignement de chacun d’eux.
En apesanteur, chacun devient une référence, chacun devient le centre autour duquel gravite le monde, chacun occupe le centre du monde. Je me souviens de cette table ronde organisée à Nantes en 2015, à l’occasion d’un congrès européen d’astronomie. Avec un ami scientifique, je parlais de la révolution préparée par Copernic et déclenchée par Galilée et ses comparses au début du XVIIe siècle, en affirmant que la Terre tournait autour du Soleil, et j’évoquais la tirade mise par Bertolt Brecht sur les lèvres d’un “très vieux cardinal” dans sa pièce La Vie de Galilée, résumé théâtral de la prétention anthropocentrique : “Je marche d’un pas assuré sur une terre ferme, elle est fixe, elle est le centre de l’univers, et moi, je suis au centre, et l’œil du Créateur est fixé sur moi et sur moi seul?”
Les révolutions des astronautes autour de la Terre, “interprétées” par la danseuse en apesanteur aérienne, auraient donc achevé celle des scientifiques du XVIIe siècle : l’univers est une sphère dont le centre est partout, puisque chacun d’entre nous peut en devenir un, et dont la circonférence est nulle part puisqu’il a toutes les apparences de l’infini. En desserrant notre lien gravitationnel, nous resserrons notre relation à l’univers et, sans doute, éprouvons-nous davantage le sentiment océanique dont Rolland entretenait Freud avec passion?
Toutefois, n’oublions pas la leçon donnée par Gravity : même avec grâce, Nijinski et Gagarine finissent par rejoindre le sol ; la nage de Leonov, la marche d’Armstrong et d’Aldrin se sont de même terminées par un brutal atterrissage sur le sol kazakh ou une plongée dans l’océan Pacifique. »
(p. 54-56)
Perspective plongeante (p. 35-37)
Conquête spatiale (p. 81-83)
Extrait court


