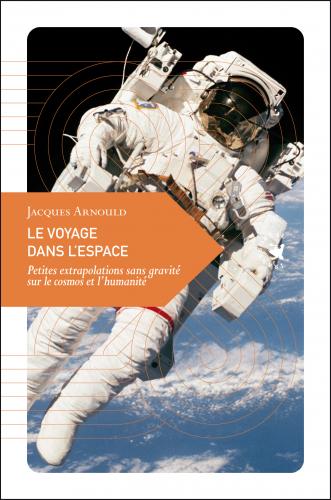
Perspective plongeante :
« Prendre de la hauteur, faire un pas de côté afin de pouvoir contempler la Terre, en observer les habitants, acquérir ainsi le devoir de les protéger ou le pouvoir de les assujettir : les humains en avaient souvent rêvé et, à défaut d’en être eux-mêmes dotés, avaient prêté ces attributs aux êtres célestes. Dans sa nouvelle intitulée “Érostrate”, Jean-Paul Sartre imagine un personnage qui prétend s’être placé au-dessus du commun des mortels et qui, pour les épier et les dominer, aime s’accouder à la fenêtre de son appartement, au sixième étage. Cette “perspective plongeante”, commente Sartre, peut ainsi devenir le “grand ennemi de l’Humain”, offrant un promontoire propice à des observations calculées, à des contrôles efficaces.
Perspective plongeante : j’ai retenu cette locution du philosophe français pour traduire une expression désormais prisée de la communauté des astronautes, des gens de l’espace et de l’air, celle d’overview effect. Elle a été forgée par Frank White, à la fin des années 1980. Pour répondre au regret de Tom Wolfe de ne pas voir davantage de philosophes s’intéresser à l’aventure spatiale, White avait entrepris d’interroger les astronautes ayant réalisé des missions spatiales, qu’il s’agisse de tourner autour de la Terre ou de rejoindre l’orbite, voire la surface de la Lune. De ces rencontres, il avait tiré la conclusion que l’overview effect, l’effet de perspective plongeante, constitue l’une des expériences les plus fortes éprouvées par quiconque séjourne dans l’espace.
Certes, les voyages aériens, les satellites d’observation de la Terre ou les sondes interplanétaires peuvent, chacun à leur manière, offrir des images de notre planète “vue de haut” : à travers le hublot d’un avion ou en voyant la Terre réduite à un minuscule point bleu “piqué” sur la toile noire de l’univers, nous pouvons bel et bien être pris d’un sentiment mêlé d’admiration, de vertige, d’effroi. J’en avais fait la remarque à Jean-Pierre Haigneré qui avait été pilote de chasse et pilote d’essai avant de devenir astronaute, aussi son avis était-il indiscutable : seul le vol à bord d’un vaisseau spatial confère à la vision de la Terre une atmosphère onirique, un caractère dramatique, au point de transformer l’apparence des structures et des phénomènes les plus familiers, d’offrir l’accès à un monde “magique” qui n’a “rien de très humain”. »
La danse de l’astronaute (p. 54-56)
Conquête spatiale (p. 81-83)
Extrait court
« Prendre de la hauteur, faire un pas de côté afin de pouvoir contempler la Terre, en observer les habitants, acquérir ainsi le devoir de les protéger ou le pouvoir de les assujettir : les humains en avaient souvent rêvé et, à défaut d’en être eux-mêmes dotés, avaient prêté ces attributs aux êtres célestes. Dans sa nouvelle intitulée “Érostrate”, Jean-Paul Sartre imagine un personnage qui prétend s’être placé au-dessus du commun des mortels et qui, pour les épier et les dominer, aime s’accouder à la fenêtre de son appartement, au sixième étage. Cette “perspective plongeante”, commente Sartre, peut ainsi devenir le “grand ennemi de l’Humain”, offrant un promontoire propice à des observations calculées, à des contrôles efficaces.
Perspective plongeante : j’ai retenu cette locution du philosophe français pour traduire une expression désormais prisée de la communauté des astronautes, des gens de l’espace et de l’air, celle d’overview effect. Elle a été forgée par Frank White, à la fin des années 1980. Pour répondre au regret de Tom Wolfe de ne pas voir davantage de philosophes s’intéresser à l’aventure spatiale, White avait entrepris d’interroger les astronautes ayant réalisé des missions spatiales, qu’il s’agisse de tourner autour de la Terre ou de rejoindre l’orbite, voire la surface de la Lune. De ces rencontres, il avait tiré la conclusion que l’overview effect, l’effet de perspective plongeante, constitue l’une des expériences les plus fortes éprouvées par quiconque séjourne dans l’espace.
Certes, les voyages aériens, les satellites d’observation de la Terre ou les sondes interplanétaires peuvent, chacun à leur manière, offrir des images de notre planète “vue de haut” : à travers le hublot d’un avion ou en voyant la Terre réduite à un minuscule point bleu “piqué” sur la toile noire de l’univers, nous pouvons bel et bien être pris d’un sentiment mêlé d’admiration, de vertige, d’effroi. J’en avais fait la remarque à Jean-Pierre Haigneré qui avait été pilote de chasse et pilote d’essai avant de devenir astronaute, aussi son avis était-il indiscutable : seul le vol à bord d’un vaisseau spatial confère à la vision de la Terre une atmosphère onirique, un caractère dramatique, au point de transformer l’apparence des structures et des phénomènes les plus familiers, d’offrir l’accès à un monde “magique” qui n’a “rien de très humain”. »
(p. 35-37)
La danse de l’astronaute (p. 54-56)
Conquête spatiale (p. 81-83)
Extrait court


