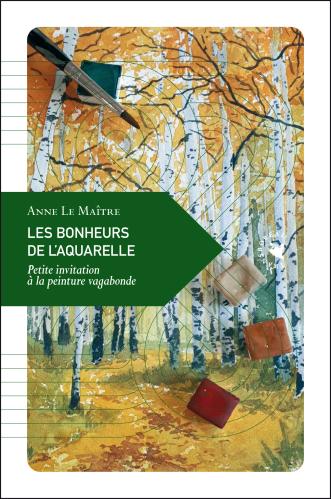
Le temps :
« Le temps, donc, voilà la grande affaire. Le temps crée la distance tout autant que l’espace. Le temps fait le voyage. Et l’aquarelliste est ainsi constitué que seul le dessin lui en donne la pleine mesure. Il y a sans doute beaucoup de raisons de s’en aller, autant de raisons, peut-être, que de voyageurs. Pour ma part, plus je vais, plus il me semble que quand je boucle mon sac et glisse la clé sous ma porte, c’est avant tout pour retrouver le plein déploiement du temps. Non plus le temps du TGV qui couvre 300 kilomètres en moins d’une heure. Non plus celui, inhumain, des avions qui relient en trois coups d’ailes l’hiver à l’été. Pas plus que le temps de l’appareil photographique qui capture en un centième de seconde les mille statues d’un temple ou le million de feuilles d’un bosquet. Non : le temps du regard qui découvre, observe, apprivoise, qui étudie comment chaque pétale du bouton-d’or s’articule au sépale et de quelle manière les lauzes disposées en écailles font du toit de cette bergerie un abri sûr pour les bêtes. Si vous ne comprenez pas, comment réussir le dessin ?
Il y a quelques années, j’ai pris à pied la route des vacances. La famille de mon père est originaire du Mâconnais où elle conserve une ferme nichée au milieu des vignes. J’y ai passé tous mes étés. J’ai fait des centaines de fois, en voiture ou en train, le trajet qui, par Chalon, Tournus et Cluny, dégringole la Bourgogne le long de la côte viticole et de la vallée de la Saône. C’est l’affaire d’une heure et demie. Cette fois-là j’ai mis huit jours.
À pied.
Parce que mon corps me semble parfaitement conçu pour se déplacer à 6 kilomètres à l’heure, toute autre vitesse nécessitant chez moi un temps d’adaptation exactement proportionnel à la performance réalisée. Parce que ce paysage bourguignon, tout entier façonné au Moyen-Âge par les moines de Cluny, date d’une époque où la journée de marche était l’unité de mesure. En le parcourant à son juste rythme, j’ai eu l’impression de passer enfin à la bonne vitesse un disque 33 tours que j’aurais jusqu’alors écouté en 78.
Parce que seul le temps de la marche me semblait offrir une chance de moissonner les merveilles que recèlent ces quelques dizaines de kilomètres. J’ai dessiné, donc, et moissonné : j’ai approfondi les mystères de l’architecture romane dite “bourguignonne”, j’ai comparé les modes de culture de la vigne, compté les chevreuils et les châtaigniers et révisé la flore des pelouses calcaires. J’ai découvert une voie romaine brûlée de soleil, une Madeleine aux cheveux d’or peinte derrière la porte vermoulue d’une église de village, un aubergiste tout droit sorti du XIIIe siècle et l’une des meilleures confitures de framboises jamais goûtées. J’ai respiré le parfum des buis sous l’averse, celui des genêts à midi et l’odeur de corne brûlée du cheval que l’on ferre. Je me suis fait une foulure et des amis? À chaque fois que mon pas se pressait, il y avait quelque chose – un moineau, une rivière ou une abbaye classée au patrimoine mondial de l’humanité – pour me retenir, me ralentir et me dire : regarde, sens, écoute. Dessine. J’ai bien consacré dix minutes à croquer un pissenlit en contrebas de Taizé – combien de temps lui avait-il fallu pour pousser ? –, alors qu’il ne m’aurait pas fallu une seconde pour prendre une photo. Mais aurais-je eu envie de la faire ? Aurais-je seulement pris la peine de regarder ce petit bonhomme sympathique, tout éclatant de santé dans son costume d’or, qui m’a vidé ce jour-là la moitié de ma réserve de jaune de chrome ? Et que faire d’une photo de pissenlit, d’ailleurs ?
Cela fait trois ans et demi, déjà. Les cloches sonnaient sur la colline et le ciel était gris.
Je me souviens très bien de lui.
“Si tu veux un ami, apprivoise-moi.” »
L’expérience du zen (p. 55-58)
On peint une émotion (p. 65-67)
Extrait court
« Le temps, donc, voilà la grande affaire. Le temps crée la distance tout autant que l’espace. Le temps fait le voyage. Et l’aquarelliste est ainsi constitué que seul le dessin lui en donne la pleine mesure. Il y a sans doute beaucoup de raisons de s’en aller, autant de raisons, peut-être, que de voyageurs. Pour ma part, plus je vais, plus il me semble que quand je boucle mon sac et glisse la clé sous ma porte, c’est avant tout pour retrouver le plein déploiement du temps. Non plus le temps du TGV qui couvre 300 kilomètres en moins d’une heure. Non plus celui, inhumain, des avions qui relient en trois coups d’ailes l’hiver à l’été. Pas plus que le temps de l’appareil photographique qui capture en un centième de seconde les mille statues d’un temple ou le million de feuilles d’un bosquet. Non : le temps du regard qui découvre, observe, apprivoise, qui étudie comment chaque pétale du bouton-d’or s’articule au sépale et de quelle manière les lauzes disposées en écailles font du toit de cette bergerie un abri sûr pour les bêtes. Si vous ne comprenez pas, comment réussir le dessin ?
Il y a quelques années, j’ai pris à pied la route des vacances. La famille de mon père est originaire du Mâconnais où elle conserve une ferme nichée au milieu des vignes. J’y ai passé tous mes étés. J’ai fait des centaines de fois, en voiture ou en train, le trajet qui, par Chalon, Tournus et Cluny, dégringole la Bourgogne le long de la côte viticole et de la vallée de la Saône. C’est l’affaire d’une heure et demie. Cette fois-là j’ai mis huit jours.
À pied.
Parce que mon corps me semble parfaitement conçu pour se déplacer à 6 kilomètres à l’heure, toute autre vitesse nécessitant chez moi un temps d’adaptation exactement proportionnel à la performance réalisée. Parce que ce paysage bourguignon, tout entier façonné au Moyen-Âge par les moines de Cluny, date d’une époque où la journée de marche était l’unité de mesure. En le parcourant à son juste rythme, j’ai eu l’impression de passer enfin à la bonne vitesse un disque 33 tours que j’aurais jusqu’alors écouté en 78.
Parce que seul le temps de la marche me semblait offrir une chance de moissonner les merveilles que recèlent ces quelques dizaines de kilomètres. J’ai dessiné, donc, et moissonné : j’ai approfondi les mystères de l’architecture romane dite “bourguignonne”, j’ai comparé les modes de culture de la vigne, compté les chevreuils et les châtaigniers et révisé la flore des pelouses calcaires. J’ai découvert une voie romaine brûlée de soleil, une Madeleine aux cheveux d’or peinte derrière la porte vermoulue d’une église de village, un aubergiste tout droit sorti du XIIIe siècle et l’une des meilleures confitures de framboises jamais goûtées. J’ai respiré le parfum des buis sous l’averse, celui des genêts à midi et l’odeur de corne brûlée du cheval que l’on ferre. Je me suis fait une foulure et des amis? À chaque fois que mon pas se pressait, il y avait quelque chose – un moineau, une rivière ou une abbaye classée au patrimoine mondial de l’humanité – pour me retenir, me ralentir et me dire : regarde, sens, écoute. Dessine. J’ai bien consacré dix minutes à croquer un pissenlit en contrebas de Taizé – combien de temps lui avait-il fallu pour pousser ? –, alors qu’il ne m’aurait pas fallu une seconde pour prendre une photo. Mais aurais-je eu envie de la faire ? Aurais-je seulement pris la peine de regarder ce petit bonhomme sympathique, tout éclatant de santé dans son costume d’or, qui m’a vidé ce jour-là la moitié de ma réserve de jaune de chrome ? Et que faire d’une photo de pissenlit, d’ailleurs ?
Cela fait trois ans et demi, déjà. Les cloches sonnaient sur la colline et le ciel était gris.
Je me souviens très bien de lui.
“Si tu veux un ami, apprivoise-moi.” »
(p. 19-22)
L’expérience du zen (p. 55-58)
On peint une émotion (p. 65-67)
Extrait court


