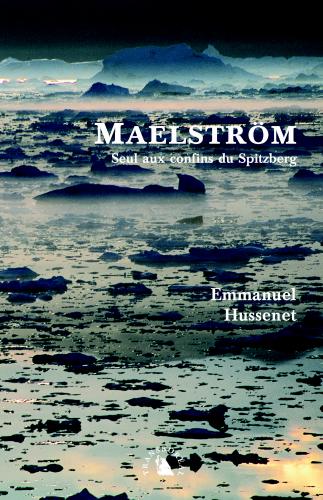
Oû¿ la folie se trouve des raisons :
« En une heure trente j’ûˋtais sur l’eau, les jambes calûˋes dans l’embarcation qui devenait le prolongement de mon propre corps, en forme de torpille ou de poisson. Je l’ai animûˋe de la seule faûÏon que s’anime un corps pareil : j’ai saisi la pagaie et j’ai bougûˋ. Lentement. Mais avec une telle confiance dans le rapport purement mathûˋmatique liant la vitesse de progression à la distance à parcourir, que j’en ai oubliûˋ ce jour-là mes limites. Avant mûˆme de gagner la partie la plus ûˋtroite de l’embouchure, je me sûˋparais de ces belles landes enneigûˋes pour diriger la proue vers une autre terre, une terre majestueuse, extrûˋmitûˋ minûˋrale de mon horizon, loin, si loin que je ne m’y serais jamais lancûˋ si je n’avais ûˋtûˋ qu’un homme. J’ûˋtais aussi une machine à laquelle on avait appris le calcul ûˋlûˋmentaire. Vingt kilomû´tres à une allure moyenne de cinq kilomû´tres par heure, cela fait quatre heures. En comptant les pauses et la dûˋrive, dans cinq heures j’aurai atteint la faûÏade nord d’Isfjord.
La distance qui me sûˋparait de la cûÇte que je quittais m’ûÇtait dûˋjà toute chance de salut en cas de coup de vent brutal; je devais me garder d’y penser et me concentrer sur l’effort comme si de rien n’ûˋtait. Les sensations que procure une grande traversûˋe en kayak n’ont rien de comparables avec celles à bord d’un bateau. C’est à ce moment-là qu’on prend conscience de l’extrûˆme vulnûˋrabilitûˋ de l’esquif ainsi que de l’intense proximitûˋ entre le corps et la mer : le kayak n’est pas un lieu de vie mais un outil de transition. L’effet ûˋtait particuliû´rement troublant. Le trouble croissait à mesure que je m’ûˋloignais sur l’ocûˋan, et j’avais peur, oui, peur que ma conscience en soit dûˋstabilisûˋe ou que mes muscles dûˋsobûˋissant à ma volontûˋ, abdiquent ou se rebellent.
Mon ventre distillait une anxiûˋtûˋ amû´re, je ne sus bientûÇt plus sur quoi me concentrer. J’essayais d’ûˋchapper à l’eau massive dont l’ûˋtendue me rûˋduisait à l’infime, en la regardant sous ma main, matiû´re lugubre et instable d’oû¿ pouvait jaillir à tout instant un monstre de lûˋgende ou les remous monumentaux d’une colû´re pûˋlagique. Je fermai les yeux, me dûˋbattant contre mon imagination. Ne sachant plus comment rûˋagir pour contrebalancer l’inertie des ûˋlûˋments, je me mis à chanter. Puis, j’ai fixûˋ Alkhornet, cette montagne pyramidale qui m’attendait de l’autre cûÇtûˋ du dûˋtroit et qui devint le monument de mon triomphe obligûˋ.
C’est alors que je pus mesurer l’ûˋpreuve physique et morale que renfermait vraiment cette expûˋdition. L’ûÛlot de Ross est le dernier ûˋlûˋment de l’archipel des Sept-ûles et reprûˋsente, à 80ô¯ 50’ de latitude nord, le point culminant du continent europûˋen. Pour l’atteindre, il me faudra couvrir pas moins de six cents kilomû´tres. Qu’est-ce que six cents kilomû´tres sur une carte ? C’est une reprûˋsentation de commoditûˋ, c’est du papier et ûÏa n’a rien à voir avec ma rûˋalitûˋ, celle, vivante et souffrante, de mon corps entier ! Et pour l’imagination, qu’est-ce que six cents kilomû´tres, mille si je dois revenir ? Ce n’est rien non plus, l’imagination imagine n’importe quoi, il ne faut pas la croire ! Que dirait la raison dans tout cela si je la laissais parler, que c’est de la folie, que je vais me tuer ? Si je l’avais ûˋcoutûˋe, elle ne m’aurait mûˆme pas laissûˋ partir.
Je sus que les sentiments qui dûˋfilû´rent en moi durant ces cinq heures d’efforts de toutes formes, prûˋfiguraient ceux que je retrouverai plus tard au cours de mon aventure. Il y eut l’audace de se lancer, le refus de la peur mais la peur quand mûˆme, le doute au beau milieu de la mer, l’arrûˆt, la larme, puis le nouveau dûˋpart. Il y eut l’angoisse et l’impatience ; un dûˋbut de joie et la patience. Je ne regardais jamais en arriû´re, jamais de cûÇtûˋ. Toujours au-devant, ou au-dedans de moi.
J’ai connu le vide, quand plus rien ne bouge et qu’il faut hurler pour abattre le silence. J’ai senti le souffle me bousculer puis me retenir ; au milieu, la mer s’est mise à respirer comme moi. Elle m’a fait danser, nous nous regardions alors comme d’anciens amis qui se redûˋcouvrent à chaque pas de danse. Je lui ai tapûˋ sur l’ûˋpaule avec ma rame, de cette tape amicale et virile qu’on adresse à un animal, mais je l’ai à chaque instant respectûˋe comme une mû´re, admirûˋe comme un pû´re, redoutûˋe comme un dieu.
J’ai ûˋcoutûˋ encore le temps oû¿ sommeillait l’ûˋcho de quelque prochaine guerre ; j’ai implorûˋ le ciel pour conclure avec lui une trûˆve et qu’il jette ailleurs ses armes et son fracas. J’ai ûˋpuisûˋ dans l’opacitûˋ de l’huile ondulante qui me supportait, les sources d’une crûˋativitûˋ profonde oû¿ les couleurs inconnues des abysses rûˋflûˋchissaient les lumiû´res sidûˋrales et impossibles. J’ai soufflûˋ, j’ai brû£lûˋ, j’ai gelûˋ, j’ai eu mal ; j’ai oubliûˋ aussi. J’ai voyagûˋ, derriû´re, devant, mais surtout ni derriû´re ni devant, ici, quoique bien ailleurs, dans tous ces rûˆves qui n’ont jamais eu de lieu et n’en trouveront certainement jamais.
Lorsqu’à bout de forces je suis arrivûˋ, je ne me souvenais plus quand j’ûˋtais parti. Maintenant ûˋtait une heure qui aurait pu ûˆtre une aube en toute autre latitude ; mes aubes perûÏaient mes nuits de part en part d’une luminositûˋ cûˋleste. J’avais atteint la pyramide de mon triomphe, mais ne triomphais pas. Je n’ûˋprouvais ni fiertûˋ ni bonheur, seulement une inquiûˋtude vis-à-vis de tout ce que je venais de dûˋcouvrir et que je devrai demain, et jour aprû´s jour, revivre, ûˋprouver, pûˋnûˋtrer jusqu’à complû´te ûˋlucidation.
Aprû´s avoir longuement encore rasûˋ la cûÇte barrûˋe par les congû´res, j’ai fini par trouver un lieu de repos. J’ai touchûˋ terre, une terre qui pour la premiû´re fois dans mon destin portait la dimension d’un autre continent. J’entrais. Les yeux ûˋnormes, puis repliûˋs et modestes, les genoux tremblants, j’ai hissûˋ le bateau, jetûˋ une couverture, dûˋgagûˋ le fusil, et me suis endormi sur la neige.�� »
Oû¿ la libertûˋ reconnaûÛt ses limites (p. 100-101)
Oû¿ la mer attise l’action (p. 153-155)
Extrait court
Extraits d’articles
Lã€irrûˋsistible attrait de lã€Arctique
La solitude dans le haut Arctique
« En une heure trente j’ûˋtais sur l’eau, les jambes calûˋes dans l’embarcation qui devenait le prolongement de mon propre corps, en forme de torpille ou de poisson. Je l’ai animûˋe de la seule faûÏon que s’anime un corps pareil : j’ai saisi la pagaie et j’ai bougûˋ. Lentement. Mais avec une telle confiance dans le rapport purement mathûˋmatique liant la vitesse de progression à la distance à parcourir, que j’en ai oubliûˋ ce jour-là mes limites. Avant mûˆme de gagner la partie la plus ûˋtroite de l’embouchure, je me sûˋparais de ces belles landes enneigûˋes pour diriger la proue vers une autre terre, une terre majestueuse, extrûˋmitûˋ minûˋrale de mon horizon, loin, si loin que je ne m’y serais jamais lancûˋ si je n’avais ûˋtûˋ qu’un homme. J’ûˋtais aussi une machine à laquelle on avait appris le calcul ûˋlûˋmentaire. Vingt kilomû´tres à une allure moyenne de cinq kilomû´tres par heure, cela fait quatre heures. En comptant les pauses et la dûˋrive, dans cinq heures j’aurai atteint la faûÏade nord d’Isfjord.
La distance qui me sûˋparait de la cûÇte que je quittais m’ûÇtait dûˋjà toute chance de salut en cas de coup de vent brutal; je devais me garder d’y penser et me concentrer sur l’effort comme si de rien n’ûˋtait. Les sensations que procure une grande traversûˋe en kayak n’ont rien de comparables avec celles à bord d’un bateau. C’est à ce moment-là qu’on prend conscience de l’extrûˆme vulnûˋrabilitûˋ de l’esquif ainsi que de l’intense proximitûˋ entre le corps et la mer : le kayak n’est pas un lieu de vie mais un outil de transition. L’effet ûˋtait particuliû´rement troublant. Le trouble croissait à mesure que je m’ûˋloignais sur l’ocûˋan, et j’avais peur, oui, peur que ma conscience en soit dûˋstabilisûˋe ou que mes muscles dûˋsobûˋissant à ma volontûˋ, abdiquent ou se rebellent.
Mon ventre distillait une anxiûˋtûˋ amû´re, je ne sus bientûÇt plus sur quoi me concentrer. J’essayais d’ûˋchapper à l’eau massive dont l’ûˋtendue me rûˋduisait à l’infime, en la regardant sous ma main, matiû´re lugubre et instable d’oû¿ pouvait jaillir à tout instant un monstre de lûˋgende ou les remous monumentaux d’une colû´re pûˋlagique. Je fermai les yeux, me dûˋbattant contre mon imagination. Ne sachant plus comment rûˋagir pour contrebalancer l’inertie des ûˋlûˋments, je me mis à chanter. Puis, j’ai fixûˋ Alkhornet, cette montagne pyramidale qui m’attendait de l’autre cûÇtûˋ du dûˋtroit et qui devint le monument de mon triomphe obligûˋ.
C’est alors que je pus mesurer l’ûˋpreuve physique et morale que renfermait vraiment cette expûˋdition. L’ûÛlot de Ross est le dernier ûˋlûˋment de l’archipel des Sept-ûles et reprûˋsente, à 80ô¯ 50’ de latitude nord, le point culminant du continent europûˋen. Pour l’atteindre, il me faudra couvrir pas moins de six cents kilomû´tres. Qu’est-ce que six cents kilomû´tres sur une carte ? C’est une reprûˋsentation de commoditûˋ, c’est du papier et ûÏa n’a rien à voir avec ma rûˋalitûˋ, celle, vivante et souffrante, de mon corps entier ! Et pour l’imagination, qu’est-ce que six cents kilomû´tres, mille si je dois revenir ? Ce n’est rien non plus, l’imagination imagine n’importe quoi, il ne faut pas la croire ! Que dirait la raison dans tout cela si je la laissais parler, que c’est de la folie, que je vais me tuer ? Si je l’avais ûˋcoutûˋe, elle ne m’aurait mûˆme pas laissûˋ partir.
Je sus que les sentiments qui dûˋfilû´rent en moi durant ces cinq heures d’efforts de toutes formes, prûˋfiguraient ceux que je retrouverai plus tard au cours de mon aventure. Il y eut l’audace de se lancer, le refus de la peur mais la peur quand mûˆme, le doute au beau milieu de la mer, l’arrûˆt, la larme, puis le nouveau dûˋpart. Il y eut l’angoisse et l’impatience ; un dûˋbut de joie et la patience. Je ne regardais jamais en arriû´re, jamais de cûÇtûˋ. Toujours au-devant, ou au-dedans de moi.
J’ai connu le vide, quand plus rien ne bouge et qu’il faut hurler pour abattre le silence. J’ai senti le souffle me bousculer puis me retenir ; au milieu, la mer s’est mise à respirer comme moi. Elle m’a fait danser, nous nous regardions alors comme d’anciens amis qui se redûˋcouvrent à chaque pas de danse. Je lui ai tapûˋ sur l’ûˋpaule avec ma rame, de cette tape amicale et virile qu’on adresse à un animal, mais je l’ai à chaque instant respectûˋe comme une mû´re, admirûˋe comme un pû´re, redoutûˋe comme un dieu.
J’ai ûˋcoutûˋ encore le temps oû¿ sommeillait l’ûˋcho de quelque prochaine guerre ; j’ai implorûˋ le ciel pour conclure avec lui une trûˆve et qu’il jette ailleurs ses armes et son fracas. J’ai ûˋpuisûˋ dans l’opacitûˋ de l’huile ondulante qui me supportait, les sources d’une crûˋativitûˋ profonde oû¿ les couleurs inconnues des abysses rûˋflûˋchissaient les lumiû´res sidûˋrales et impossibles. J’ai soufflûˋ, j’ai brû£lûˋ, j’ai gelûˋ, j’ai eu mal ; j’ai oubliûˋ aussi. J’ai voyagûˋ, derriû´re, devant, mais surtout ni derriû´re ni devant, ici, quoique bien ailleurs, dans tous ces rûˆves qui n’ont jamais eu de lieu et n’en trouveront certainement jamais.
Lorsqu’à bout de forces je suis arrivûˋ, je ne me souvenais plus quand j’ûˋtais parti. Maintenant ûˋtait une heure qui aurait pu ûˆtre une aube en toute autre latitude ; mes aubes perûÏaient mes nuits de part en part d’une luminositûˋ cûˋleste. J’avais atteint la pyramide de mon triomphe, mais ne triomphais pas. Je n’ûˋprouvais ni fiertûˋ ni bonheur, seulement une inquiûˋtude vis-à-vis de tout ce que je venais de dûˋcouvrir et que je devrai demain, et jour aprû´s jour, revivre, ûˋprouver, pûˋnûˋtrer jusqu’à complû´te ûˋlucidation.
Aprû´s avoir longuement encore rasûˋ la cûÇte barrûˋe par les congû´res, j’ai fini par trouver un lieu de repos. J’ai touchûˋ terre, une terre qui pour la premiû´re fois dans mon destin portait la dimension d’un autre continent. J’entrais. Les yeux ûˋnormes, puis repliûˋs et modestes, les genoux tremblants, j’ai hissûˋ le bateau, jetûˋ une couverture, dûˋgagûˋ le fusil, et me suis endormi sur la neige.�� »
(p. 54-56)
Oû¿ la libertûˋ reconnaûÛt ses limites (p. 100-101)
Oû¿ la mer attise l’action (p. 153-155)
Extrait court
Extraits d’articles
Lã€irrûˋsistible attrait de lã€Arctique
La solitude dans le haut Arctique


