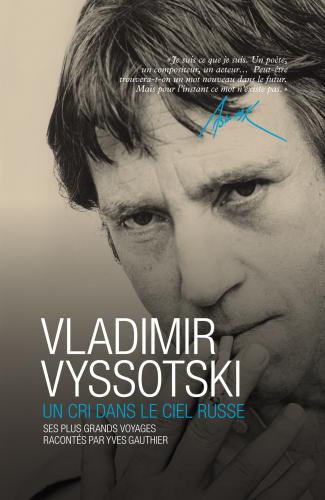
Introduction – « Plus qu’un poète? » :
« Ce petit livre-portrait commencera par un aveu : je dois la vie sauve à Vladimir Vyssotski.
C’était en 1989. Vivant à Moscou, je roulais alors dans une Lada-Jigouli “à la face de fauve” – dixit Vyssotski lui-même dans une chanson-pamphlet intitulée Jaloux des quatre roues, où “cataclysme” rimait avec “capitalisme” pour railler l’embourgeoisement des Soviétiques par les voitures de cette marque. Un jour, j’eus une panne de régulateur de charge causant un survoltage. Le voltmètre s’envolait, la batterie fumait. Voyant cela, j’optai pour l’un de ces petits garages privés qui fleurissaient un peu partout depuis que Mikhaïl Gorbatchev, l’année d’avant, avait fait voter la loi sur les coopératives, par suite de quoi beaucoup d’aventuriers s’étaient dépêchés de monter des affaires au nom d’un principe aussitôt érigé en calembour : “Il faut battre le fer tant qu’il est gorbachaud.” Malheureusement pour moi, je manquai de flair et tombai dans un endroit louche et glauque du côté de Kountsevo, un faubourg du sud. Quand la réparation fut faite et que j’en demandai le prix aux deux figures patibulaires qui tenaient l’atelier (que ne m’étais-je méfié !), leur réponse me jeta dans une scène de roman noir : “Ton blouson.”
Je n’étais pas d’accord. C’était un blouson de cuir marron clair à double rabat que mes parents m’avaient rapporté d’Istanbul pour mon anniversaire. Les deux autres pourtant s’entêtaient, disant préférer mon cuir à mon argent qu’ils appelaient des “roubles en bois”. Ils me lancèrent : “C’est ça ou?”
La phrase resta en suspens, mais le geste illustra la suite : d’un mouvement synchronisé, les deux hommes descendirent le pont élévateur, où ma voiture attendait en l’air, grâce à une paire de leviers à crémaillère. Une fois ôtés, ces leviers étaient dans leurs mains comme deux grosses barres à mine. Pareils à un couple d’écuyers barrant la porte d’un château avec leurs lances, les mécaniciens croisèrent les deux barres pour me couper la sortie du garage, baraque de tôle plantée au milieu d’un terrain vague. Le vent du soir s’en mêla, qui fit claquer un battant de porte sur lequel je découvris de l’intérieur le poster d’une pin-up à la nudité crue en train d’accomplir accroupie un acte d’onanisme, une image à faire rougir un camionneur. Le deuxième battant béait encore, qui offrait comme un cadre sordide au paysage de Kountsevo avec ses cages d’habitation, son tronçon de MKAD (le grand périphérique) et, à deux pas de là, un étang de pêche servant de réceptacle aux huiles de vidange de l’atelier. Il me souvient que, la peur aidant, j’y voyais d’avance flotter mon cadavre roué de coups. Qu’on relise la chronique judiciaire de ce temps-là pour comprendre ma vision.
La nuit tombait.
Bêtement, je promenai le regard dans l’atelier comme pour y chercher une issue dérobée. Mes yeux s’arrêtèrent sur un coin sombre aménagé à la façon du “coin sacré” des maisons russes d’autrefois, le rayon des icônes. De là me regardait le chanteur-compositeur Vyssotski dont le portrait pendait en couleurs, telle une image sainte. La vue du poète m’inspira : “J’ai mieux qu’un blouson, leur dis-je. Et mieux que des roubles en bois. J’ai un livre.”
Les deux brutes eurent une expression de méchanceté intriguée. Je repris : “Vyssotski. Par Marina Vlady.”
Le livre, Vladimir ou le vol arrêté (Paris, 1987) venait de sortir à Moscou, en traduction russe, aux Éditions du Progrès, à seulement 250 000 exemplaires. Introuvable en librairie, sauf au marché noir où il se vendait à peine moins cher qu’un blouson de cuir turc. Privilège de ma profession, j’en avais quelques exemplaires dont un dans ma sacoche.
Je le dégainai.
Ils échangèrent un regard ahuri où pointait déjà une lueur d’émerveillement, puis coururent se laver les mains à l’étang. Je revois leurs gros doigts tourner les pages du livre et leurs gueules de bandits s’adoucir. Grâce à Vyssotski, je repartis vivant et libre.
D’un autre côté, comment savoir ? Sans lui, je ne me serais peut-être jamais aventuré dans son pays et n’aurais donc pas atterri dans ce garage ténébreux. Car c’est à travers ses chansons que, fasciné, je m’étais initié à la vraie langue russe, celle des entrailles de son peuple mystérieux. Je me dis parfois que Vyssotski, ce jour-là, d’une manière symbolique, m’a sauvé d’une vilaine histoire où j’étais tombé par sa faute. Ou plutôt par sa grâce. Mais trêve de mysticisme.
Si je conte ici cette anecdote, c’est que, pour authentique qu’elle soit, je la regarde comme une fable vyssotskienne par excellence : même dramaturgie que dans ses textes, même charge conflictuelle, même décor social de romance noire, même glissement subtil du réel à l’allégorique, même message filigrané. Du reste, une affaire de survoltage pouvait-elle me conduire ailleurs que dans l’univers de Vyssotski ?
Et surtout : la force rédemptrice du chanteur ! Forcer deux brutes à baisser les armes rien qu’à l’évocation de son nom, presque dix ans après sa mort ! La sublimation du mal par le chant? Que disait monseigneur Bienvenu à Jean Valjean, déjà, à propos des chandeliers ? Que cet argent lui servît à devenir honnête homme. Eh bien, Vyssotski ne fit pas moins que l’évêque de Victor Hugo. Rallier deux fripouilles à la meilleure cause, éclairer leurs visages, élever leurs âmes? Que dis-je, “deux fripouilles”, un peuple entier !
On le vénère dans les prisons où les taulards, chamarrés de tatouages, croient dur comme fer qu’il fut des leurs. On le vénère dans les campagnes et les villes : petites, moyennes, grandes. Dans les fermes, les usines, les stades, les casernes, les cours d’immeuble et d’école, les administrations, les universités, les théâtres, les rédactions. Chez les branchés comme chez les paumés. Idole transsociale, transgénérationnelle, totale, fédérale. Et fédératrice.
En 2010, année du trentième anniversaire de la mort de Vyssotski, l’institut de sondage TSIOM (Centre russe d’étude de l’opinion publique) demanda aux Russes quelles étaient à leurs yeux “les plus grandes idoles du XXe siècle”. L’enquête embrassait un échantillon de 1 600 personnes vivant dans 142 régions de la vaste Fédération de Russie. Youri Gagarine, cosmonaute, arrivait en tête (35 %) des personnes interrogées, talonné par Vladimir Vyssotski (31 %), acteur, chanteur, compositeur, poète. Loin derrière (20 %), le maréchal Joukov, pourtant regardé comme le tombeur de Hitler, traînait la jambe. Dans le sillage de ces trois baleines, les noms qui suivaient avaient la grandeur statistique du plancton – de Tolstoï à Gorbatchev.
On reconnaissait en fin de liste, rapetissé à 2 %, Joseph Brodsky, géant de la poésie, prix Nobel de littérature, celui-là même qui, par une dédicace fameuse, avait sacré notre chanteur-compositeur au rang de “meilleur poète russe”. Poète ! le mot le plus chéri, le plus revendiqué par Vladimir Vyssotski. Au nom de quoi il vécut. Au nom de quoi il mourut. Car, comme le disait Evguéni Evtouchenko, “un poète en Russie est plus qu’un poète”. »
« Ce petit livre-portrait commencera par un aveu : je dois la vie sauve à Vladimir Vyssotski.
C’était en 1989. Vivant à Moscou, je roulais alors dans une Lada-Jigouli “à la face de fauve” – dixit Vyssotski lui-même dans une chanson-pamphlet intitulée Jaloux des quatre roues, où “cataclysme” rimait avec “capitalisme” pour railler l’embourgeoisement des Soviétiques par les voitures de cette marque. Un jour, j’eus une panne de régulateur de charge causant un survoltage. Le voltmètre s’envolait, la batterie fumait. Voyant cela, j’optai pour l’un de ces petits garages privés qui fleurissaient un peu partout depuis que Mikhaïl Gorbatchev, l’année d’avant, avait fait voter la loi sur les coopératives, par suite de quoi beaucoup d’aventuriers s’étaient dépêchés de monter des affaires au nom d’un principe aussitôt érigé en calembour : “Il faut battre le fer tant qu’il est gorbachaud.” Malheureusement pour moi, je manquai de flair et tombai dans un endroit louche et glauque du côté de Kountsevo, un faubourg du sud. Quand la réparation fut faite et que j’en demandai le prix aux deux figures patibulaires qui tenaient l’atelier (que ne m’étais-je méfié !), leur réponse me jeta dans une scène de roman noir : “Ton blouson.”
Je n’étais pas d’accord. C’était un blouson de cuir marron clair à double rabat que mes parents m’avaient rapporté d’Istanbul pour mon anniversaire. Les deux autres pourtant s’entêtaient, disant préférer mon cuir à mon argent qu’ils appelaient des “roubles en bois”. Ils me lancèrent : “C’est ça ou?”
La phrase resta en suspens, mais le geste illustra la suite : d’un mouvement synchronisé, les deux hommes descendirent le pont élévateur, où ma voiture attendait en l’air, grâce à une paire de leviers à crémaillère. Une fois ôtés, ces leviers étaient dans leurs mains comme deux grosses barres à mine. Pareils à un couple d’écuyers barrant la porte d’un château avec leurs lances, les mécaniciens croisèrent les deux barres pour me couper la sortie du garage, baraque de tôle plantée au milieu d’un terrain vague. Le vent du soir s’en mêla, qui fit claquer un battant de porte sur lequel je découvris de l’intérieur le poster d’une pin-up à la nudité crue en train d’accomplir accroupie un acte d’onanisme, une image à faire rougir un camionneur. Le deuxième battant béait encore, qui offrait comme un cadre sordide au paysage de Kountsevo avec ses cages d’habitation, son tronçon de MKAD (le grand périphérique) et, à deux pas de là, un étang de pêche servant de réceptacle aux huiles de vidange de l’atelier. Il me souvient que, la peur aidant, j’y voyais d’avance flotter mon cadavre roué de coups. Qu’on relise la chronique judiciaire de ce temps-là pour comprendre ma vision.
La nuit tombait.
Bêtement, je promenai le regard dans l’atelier comme pour y chercher une issue dérobée. Mes yeux s’arrêtèrent sur un coin sombre aménagé à la façon du “coin sacré” des maisons russes d’autrefois, le rayon des icônes. De là me regardait le chanteur-compositeur Vyssotski dont le portrait pendait en couleurs, telle une image sainte. La vue du poète m’inspira : “J’ai mieux qu’un blouson, leur dis-je. Et mieux que des roubles en bois. J’ai un livre.”
Les deux brutes eurent une expression de méchanceté intriguée. Je repris : “Vyssotski. Par Marina Vlady.”
Le livre, Vladimir ou le vol arrêté (Paris, 1987) venait de sortir à Moscou, en traduction russe, aux Éditions du Progrès, à seulement 250 000 exemplaires. Introuvable en librairie, sauf au marché noir où il se vendait à peine moins cher qu’un blouson de cuir turc. Privilège de ma profession, j’en avais quelques exemplaires dont un dans ma sacoche.
Je le dégainai.
Ils échangèrent un regard ahuri où pointait déjà une lueur d’émerveillement, puis coururent se laver les mains à l’étang. Je revois leurs gros doigts tourner les pages du livre et leurs gueules de bandits s’adoucir. Grâce à Vyssotski, je repartis vivant et libre.
D’un autre côté, comment savoir ? Sans lui, je ne me serais peut-être jamais aventuré dans son pays et n’aurais donc pas atterri dans ce garage ténébreux. Car c’est à travers ses chansons que, fasciné, je m’étais initié à la vraie langue russe, celle des entrailles de son peuple mystérieux. Je me dis parfois que Vyssotski, ce jour-là, d’une manière symbolique, m’a sauvé d’une vilaine histoire où j’étais tombé par sa faute. Ou plutôt par sa grâce. Mais trêve de mysticisme.
Si je conte ici cette anecdote, c’est que, pour authentique qu’elle soit, je la regarde comme une fable vyssotskienne par excellence : même dramaturgie que dans ses textes, même charge conflictuelle, même décor social de romance noire, même glissement subtil du réel à l’allégorique, même message filigrané. Du reste, une affaire de survoltage pouvait-elle me conduire ailleurs que dans l’univers de Vyssotski ?
Et surtout : la force rédemptrice du chanteur ! Forcer deux brutes à baisser les armes rien qu’à l’évocation de son nom, presque dix ans après sa mort ! La sublimation du mal par le chant? Que disait monseigneur Bienvenu à Jean Valjean, déjà, à propos des chandeliers ? Que cet argent lui servît à devenir honnête homme. Eh bien, Vyssotski ne fit pas moins que l’évêque de Victor Hugo. Rallier deux fripouilles à la meilleure cause, éclairer leurs visages, élever leurs âmes? Que dis-je, “deux fripouilles”, un peuple entier !
On le vénère dans les prisons où les taulards, chamarrés de tatouages, croient dur comme fer qu’il fut des leurs. On le vénère dans les campagnes et les villes : petites, moyennes, grandes. Dans les fermes, les usines, les stades, les casernes, les cours d’immeuble et d’école, les administrations, les universités, les théâtres, les rédactions. Chez les branchés comme chez les paumés. Idole transsociale, transgénérationnelle, totale, fédérale. Et fédératrice.
En 2010, année du trentième anniversaire de la mort de Vyssotski, l’institut de sondage TSIOM (Centre russe d’étude de l’opinion publique) demanda aux Russes quelles étaient à leurs yeux “les plus grandes idoles du XXe siècle”. L’enquête embrassait un échantillon de 1 600 personnes vivant dans 142 régions de la vaste Fédération de Russie. Youri Gagarine, cosmonaute, arrivait en tête (35 %) des personnes interrogées, talonné par Vladimir Vyssotski (31 %), acteur, chanteur, compositeur, poète. Loin derrière (20 %), le maréchal Joukov, pourtant regardé comme le tombeur de Hitler, traînait la jambe. Dans le sillage de ces trois baleines, les noms qui suivaient avaient la grandeur statistique du plancton – de Tolstoï à Gorbatchev.
On reconnaissait en fin de liste, rapetissé à 2 %, Joseph Brodsky, géant de la poésie, prix Nobel de littérature, celui-là même qui, par une dédicace fameuse, avait sacré notre chanteur-compositeur au rang de “meilleur poète russe”. Poète ! le mot le plus chéri, le plus revendiqué par Vladimir Vyssotski. Au nom de quoi il vécut. Au nom de quoi il mourut. Car, comme le disait Evguéni Evtouchenko, “un poète en Russie est plus qu’un poète”. »
(p. 5-9)


