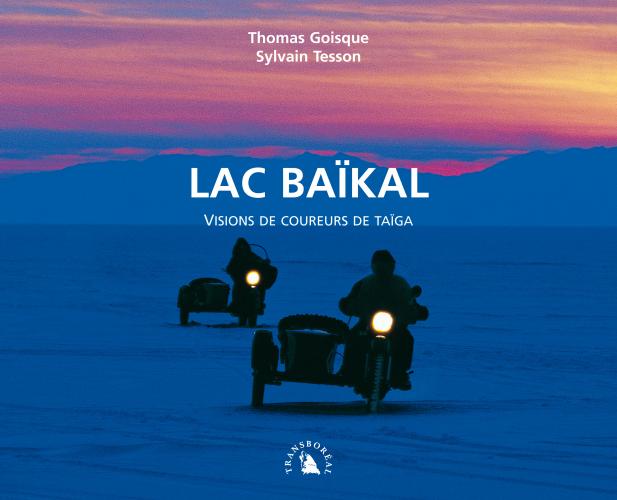
Finir en cabane :
« Les rares personnes qui rendent visite à Sacha à l’embouchure de la Kharguino le connaissent sous son surnom de “Colonel original”. Sur le bord de la rivière plantée de bouleaux, il s’est installé dans une belle isba de bois à l’emplacement d’un village de bûcherons déserté dans les années 1950, “à la mort de Staline”. Sacha vit de sa retraite, de pêche, de chasse et s’octroie de temps en temps une virée à Irkoutsk à bord de son UAZ, par la piste forestière qui raccorde son isba à la route goudronnée. Pour le reste, il n’a besoin de personne. La grandeur des lieux et son petit jardin lui suffisent. “La beauté sauvera le monde !” : Sacha a fait sien l’aphorisme de Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski. Sa maison ressemble à une didascalie de Tchekhov : le samovar bout, un bouquet d’aneth sèche sur la table, un canot de bois repose sur le flanc, une oie claironne dans les baliveaux. L’hiver, la rivière déborde, gèle et transforme les abords de l’isba en un parvis lacté hérissé de bouleaux. À notre arrivée, Sacha achève de replier ses filets et, servant le thé, confie son histoire. “J’étais dans la chasse soviétique, je pilotais des Sukhoi, j’aurais dû prendre ma retraite à Moscou, mais je préfère être heureux ici que bien logé là-bas.” Le soir, l’ancien colonel qui a visité Sofia, Berlin et Leningrad, assis sur son banc de bois, goûte, les yeux mi-clos, la magnétique respiration du lac. Le silence pose sa cloche sur les camaïeux de la plaine liquide. Un doux sourire ne quitte jamais Sacha. L’armée Rouge produit de beaux retraités. La simplicité volontaire confère à la vie forestière une valeur que la vie urbaine ne peut offrir. Dans le béton, la course au bien-être commande de “posséder plus”. Ici, il ne s’agit que de vivre mieux.
La vie en cabane est un remède à toute peine. On connaît le mot de Voiture : “Le vrai secret pour avoir de la santé et de la gaieté est que le corps soit agité et que l’esprit se repose.” La cabane offre cela. Un fardeau de tâches qui vous occupent huit heures par jour. Deux fenêtres ouvertes sur un lac à sillonner sans fin. Bref, la possibilité d’une vie avec le corps occupé, l’esprit disponible, l’âme apaisée. Question finale : est-il heureux, le peuple des cabanes ? Plus heureux que le peuple des villes ? Le recours aux forêts garantit-il le bonheur ? Souvent, le citadin juge l’ermite, crie au fou, lui tient une fielleuse rigueur de son amour pour la solitude. Surtout, sentence suprême, il lui reproche d’avoir fui. Aux yeux de ceux qui y restent, fuir la termitière est une désertion. (Les rats quittent le navire parce qu’ils sont les plus intelligents.) La fuite, c’est le nom donné par les ensablés au chemin qui conduit les audacieux vers l’épanouissement d’eux-mêmes. Parfois, devant le spectacle d’une cabane postée sur le talus baïkalien, me vient l’idée qu’elle se tient hors du temps, hors de l’histoire. Et que, possédant son univers autonome – le territoire de chasse, de pêche et de coupe –, elle est exclue du monde. Dans une sotie superbe, László F. Földényi imagine que “Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes” (c’est le titre du livre). La raison de son chagrin ? Le conceptualiste allemand, dans sa Leçon sur la philosophie de l’histoire, écrit que “la morphologie du pays n’est pas propice à une culture historique ou à devenir un acteur particulier de l’histoire”. Voilà pourquoi Fedor s’effondre : Hegel lui dénie sa place dans le temps des hommes. Il exclut le peuple sibérien de la marche du monde. Il fait de la Sibérie un non-lieu, lui refuse son inscription dans la modernité. Les larmes de Dostoïevski sont étranges : il semblerait qu’il y a là plutôt un compliment et de quoi se réjouir. N’a-t-on pas envie de la célébrer, cette terre éloignée des rivages humains, où lever quatre murs de rondins pour inventer sa vie reste chose possible ? »
La fin du miracle (p. 38-41)
Le goût de la nature (p. 104-105)
Extrait court
« Les rares personnes qui rendent visite à Sacha à l’embouchure de la Kharguino le connaissent sous son surnom de “Colonel original”. Sur le bord de la rivière plantée de bouleaux, il s’est installé dans une belle isba de bois à l’emplacement d’un village de bûcherons déserté dans les années 1950, “à la mort de Staline”. Sacha vit de sa retraite, de pêche, de chasse et s’octroie de temps en temps une virée à Irkoutsk à bord de son UAZ, par la piste forestière qui raccorde son isba à la route goudronnée. Pour le reste, il n’a besoin de personne. La grandeur des lieux et son petit jardin lui suffisent. “La beauté sauvera le monde !” : Sacha a fait sien l’aphorisme de Fedor Mikhaïlovitch Dostoïevski. Sa maison ressemble à une didascalie de Tchekhov : le samovar bout, un bouquet d’aneth sèche sur la table, un canot de bois repose sur le flanc, une oie claironne dans les baliveaux. L’hiver, la rivière déborde, gèle et transforme les abords de l’isba en un parvis lacté hérissé de bouleaux. À notre arrivée, Sacha achève de replier ses filets et, servant le thé, confie son histoire. “J’étais dans la chasse soviétique, je pilotais des Sukhoi, j’aurais dû prendre ma retraite à Moscou, mais je préfère être heureux ici que bien logé là-bas.” Le soir, l’ancien colonel qui a visité Sofia, Berlin et Leningrad, assis sur son banc de bois, goûte, les yeux mi-clos, la magnétique respiration du lac. Le silence pose sa cloche sur les camaïeux de la plaine liquide. Un doux sourire ne quitte jamais Sacha. L’armée Rouge produit de beaux retraités. La simplicité volontaire confère à la vie forestière une valeur que la vie urbaine ne peut offrir. Dans le béton, la course au bien-être commande de “posséder plus”. Ici, il ne s’agit que de vivre mieux.
La vie en cabane est un remède à toute peine. On connaît le mot de Voiture : “Le vrai secret pour avoir de la santé et de la gaieté est que le corps soit agité et que l’esprit se repose.” La cabane offre cela. Un fardeau de tâches qui vous occupent huit heures par jour. Deux fenêtres ouvertes sur un lac à sillonner sans fin. Bref, la possibilité d’une vie avec le corps occupé, l’esprit disponible, l’âme apaisée. Question finale : est-il heureux, le peuple des cabanes ? Plus heureux que le peuple des villes ? Le recours aux forêts garantit-il le bonheur ? Souvent, le citadin juge l’ermite, crie au fou, lui tient une fielleuse rigueur de son amour pour la solitude. Surtout, sentence suprême, il lui reproche d’avoir fui. Aux yeux de ceux qui y restent, fuir la termitière est une désertion. (Les rats quittent le navire parce qu’ils sont les plus intelligents.) La fuite, c’est le nom donné par les ensablés au chemin qui conduit les audacieux vers l’épanouissement d’eux-mêmes. Parfois, devant le spectacle d’une cabane postée sur le talus baïkalien, me vient l’idée qu’elle se tient hors du temps, hors de l’histoire. Et que, possédant son univers autonome – le territoire de chasse, de pêche et de coupe –, elle est exclue du monde. Dans une sotie superbe, László F. Földényi imagine que “Dostoïevski lit Hegel en Sibérie et fond en larmes” (c’est le titre du livre). La raison de son chagrin ? Le conceptualiste allemand, dans sa Leçon sur la philosophie de l’histoire, écrit que “la morphologie du pays n’est pas propice à une culture historique ou à devenir un acteur particulier de l’histoire”. Voilà pourquoi Fedor s’effondre : Hegel lui dénie sa place dans le temps des hommes. Il exclut le peuple sibérien de la marche du monde. Il fait de la Sibérie un non-lieu, lui refuse son inscription dans la modernité. Les larmes de Dostoïevski sont étranges : il semblerait qu’il y a là plutôt un compliment et de quoi se réjouir. N’a-t-on pas envie de la célébrer, cette terre éloignée des rivages humains, où lever quatre murs de rondins pour inventer sa vie reste chose possible ? »
(p. 124-127)
La fin du miracle (p. 38-41)
Le goût de la nature (p. 104-105)
Extrait court


