La maison d’édition et la librairie des voyageurs au long cours
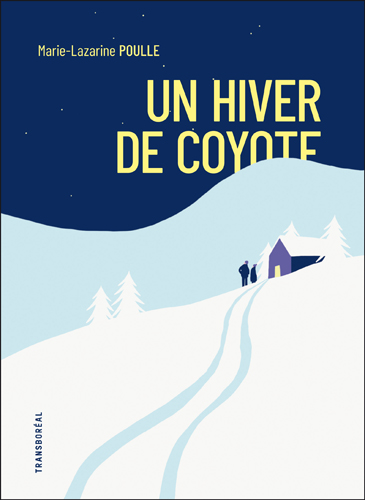
Interview : Pauline Quierzy
CDT
Quelle motivation vous a poussée à entreprendre cette traversée à pied des États-Unis ? Parmi les grands itinéraires de randonnée, pourquoi avoir choisi le Continental Divide Trail ?
Une quête de sens, d’essentiel m’a poussée en chemin ; une quête de beauté et d’harmonie aussi. Les poursuivre était alors le sésame de mon épanouissement. Je tenais à être la plus attentive possible à la poésie du monde, sensible aux réalités visibles et invisibles. Je crois avoir ainsi répondu à ce besoin profond et urgent de vivre une expérience sensorielle intense et authentique.
J’ai choisi le CDT parmi les itinéraires qui m’immergeraient le plus dans la vie sauvage. Suivant la ligne de partage des eaux nord-américaine, épine dorsale d’un continent, il se faufile dans des terres reculées, aussi fascinantes qu’hostiles. Prairies alpines exposées, anciens champs volcaniques, chaînes des Rocheuses à couper le souffle. Y progresser pas à pas, c’est en quelque sorte retrouver sa place dans la grande marche du monde.
Au-delà de motivations intimistes, une curiosité professionnelle a aussi guidé cette aventure. Le CDT est bien plus qu’un sentier : c’est un corridor naturel pour la faune, un sanctuaire pour de précieux écosystèmes et aussi ce lien qui unit les communautés de l’Ouest américain. Il est considéré comme l’un des efforts de conservation les plus importants en Amérique du Nord. Travaillant pour des projets visant à préserver les relations qui unissent le vivant, suivre le CDT, m’en faire le témoin et le révéler par l’écriture, c’est une forme d’engagement à sa protection.
Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ?
En 2019, année de notre traversée, la neige a représenté un défi de taille. Un enneigement record, que l’Ouest américain n’avait pas connu depuis des décennies, a suspendu notre élan vers le nord. La frontière entre Nouveau-Mexique et Colorado atteinte, les crêtes des Rocheuses étaient devenues impraticables, théâtre d’avalanches et de tempêtes. Nous avons dû reconsidérer le fil conducteur de notre voyage et reprendre notre marche dans le Grand Bassin du Wyoming. Cette adaptabilité et révérence aux éléments naturels nous aura permis d’aller jusqu’au bout de ce périple. Ne pas rentrer en force dans ces espaces, s’incliner face aux « décisions » de la nature, lui faire confiance.
Le poids du portage a aussi été une difficulté, relative. Quand l’eau était rare ou lorsque l’isolement imposait une autonomie alimentaire pour plusieurs jours. En randonnée, on porte souvent le poids de ses peurs. Là aussi il nous a fallu choisir, préférer. Se concentrer sur l’essentiel. Se faire confiance et s’alléger.
Partagez-nous votre plus beau souvenir du chemin !
Mon plus beau souvenir du chemin, plutôt qu’un événement isolé, est une façon de voyager. Cette approche émotionnelle privilégiant l’écoute et l’ouverture à l’autre, quel qu’il soit : insecte, oiseau, nuage, pin, lichen, antilope, marcheur. C’est une façon d’être au monde, de l’accueillir. Faite de discrétion, de lenteur, d’humilité. D’observations et d’introspection. D’effacement de soi. Se fondre, « disparaître » comme dans un affût, pour faire apparaître tout le vivant qui nous entoure. Un recueillement, une connivence presque sacrée avec son environnement et avec soi.
Cet accord, il est d’une certaine façon déjà là. Mais dans son quotidien, on peut aisément devenir indisponible, accaparé par un trop-plein de tâches, la fatigue, les contrariétés et aléas de l’existence.
Or on sait aujourd’hui que les écosystèmes prospèrent grâce à ces interconnexions entre les espèces et leur milieu, contribuant à l’équilibre général, à la santé. Et à ce jeu subtil, l’homme doit prendre part. Mon plus beau souvenir, c’est donc celui d’une marche symbiotique, qui offre une compréhension profonde du vivant et de l’expérience humaine en son sein.
Que révèle le CDT de l’Amérique contemporaine selon vous ?
Le CDT révèle la force tout autant que la vulnérabilité des grands espaces de l’Ouest américain et des populations qui y vivent : faune, flore, humains. Il révèle la fragilité d’un système de conservation qui peut-être sapé du jour au lendemain par des ambitions politiques et économiques.
Ainsi le gouvernement Trump balaye d’un revers de main règles et politiques environnementales, affaiblit les agences dont le mandat est de les faire respecter, coupe le budget de la recherche et multiplie les autorisations d’exploitation minière et forestière.
Le CDT révèle que la conquête de l’Ouest se poursuit. Les immenses territoires colonisés au XIXe siècle, pourtant alors habités par les Indiens, continuent d’être l’objet de prédation et de convoitises, en particulier pour la course aux énergies. Les populations actuelles sont indirectement chassées de leurs terres souillées par les contaminations et menacées par des projets industriels de grande envergure.
L’Ouest a fait rêver des générations entières, il est emblématique dans la construction de l’identité américaine. Ce sentier, parcourant des milliers de kilomètres de terres publiques, est celui de toutes et de tous. Il révèle surtout que préserver les espaces qu’il traverse est la responsabilité de chacun. Une sorte de destin collectif duquel s’emparer pour pouvoir continuer à se déployer respectueusement dans ces milieux d’exception.
Quel livre sur l’Amérique sauvage nous conseillez-vous ?
Printemps silencieux, de Rachel Carson. En hommage à cette biologiste américaine, femme de lettres et pionnière du mouvement environnementaliste qui a eu le courage de dénoncer l’impact des pesticides. Ce récit poignant dévoile un monde où le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes sont étouffés par un silence sinistre : celui de l’effondrement des écosystèmes suite à un empoisonnement de masse. Par la force de ses observations et celle des ses mots, Rachel Carson a exhorté ses lecteurs à repenser notre façon d’interagir avec le monde naturel. Elle a inspiré et encouragé des générations d’environnementalistes à préserver la vie.
Je crois en la poursuite de ce changement de paradigme : passer de « la nature au service de l’homme » à « l’homme au service de la nature ». Cette intégrité écologique est même indissociable de notre condition humaine. « La beauté de la nature a une place nécessaire dans le développement spirituel de tout individu et de toute société. Je crois qu’à chaque fois que nous substituons une chose créée de main d’homme ou artificielle à un élément naturel de la terre, nous retardons en quelque sorte la croissance spirituelle de l’humanité », pensait Rachel Carson. Je crois à cet engagement collectif pour prendre soin du vivant. La marche est en soi une démarche pacifique et militante quand elle y éveille.
Questions préparées par Claire Dufaure
Archives des interviews



