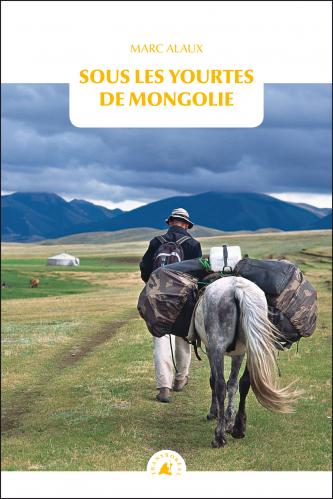
Dans la grande enceinte :
« J’avais coulé d’extraordinaires semaines à Oulan-Bator. Je m’étais satisfait de ne pas la traverser en partance pour la steppe. J’y avais trouvé à faire. J’y avais simplement habité, découvrant le repos de l’esprit entre des murs étrangers, le plaisir du lever au sein d’une ville dépouillée de secrets quoique lointaine. La routine s’était faite exquise. J’avais savouré ma présence, goûté l’air de la ville et des hauteurs voisines, fredonné les chansons à succès de Baterdene et de Sarantuya en arpentant les rues, suivi le rythme du rap musclé de Tatar et guetté les concerts de Javkhlan. Je m’étais approprié leur langue par bribes. De ce moment, du remous sentimental qui l’accompagna, je garde un souvenir tel qu’il m’est impossible de mesurer la portée de mes retours en Mongolie et le repos que j’y gagne, même loin de celle que j’aime, même si à chaque voyage, un de mes proches disparaît, comme par malédiction.
Je prenais le temps de donner par écrit une place aux émotions. Durant quelques semaines, je vécus en témoin de ma propre vie. Il subsiste de ces jours, hormis des feuillets noircis de phrases pittoresques, des souvenirs miraculeux qui donnent de l’éclat à mon existence, si servile autrement. La vie n’a d’intérêt que d’être vécue sans ambition, or j’étais parvenu à me dissoudre dans l’observation du lieu, à faire corps avec le milieu et les gens au cours d’un abandon passionnel de l’âme. Du reste, arpenter la steppe n’était plus une chose insurmontable pour mon corps tant il s’y était habitué. Les dernières semaines, je n’avais pas survécu dans le désert en suçotant du fromage séché. Je n’avais pas eu besoin de poursuivre mes chevaux en fuite. Encore moins m’avait-il fallu chercher ma pitance ou fuir la grêle. Le péril n’avait pas été mon pain quotidien. J’avais mené une vie simple et profité de nuits douces. Et de surcroît, dans la chaleur des cantines populaires, j’avais mangé à ma faim. J’étais allé chercher derrière le ciment des murs les rires, les parfums et les regards du peuple que j’aimais. Je vivais assez puissamment les jours d’hiver, qui renforcent l’isolement et le silence, pour ne rien regretter. Je ne voyageais guère. Le couteau rouillait dans son fourreau, les rangers restaient au placard. Je ne fuyais plus comme un bandit sans feu ni lieu. J’avais adopté une sorte de statisme, mais qui n’était qu’apparent, qui frappait le corps seul, autrement dit peu de chose. Tant de pensées vagabondes et d’idéaux d’un jour rebelles à l’immobilisme foisonnaient en moi que j’explorais la sédentarité comme une région inconnue. Le matin, après m’être dit “une fois encore”, j’entremêlais comme la veille mon destin à celui des rues. »
Sous le joug des tempêtes (p. 93-96)
Le doux chant des heures d’été (p. 239-242)
Extrait court
« J’avais coulé d’extraordinaires semaines à Oulan-Bator. Je m’étais satisfait de ne pas la traverser en partance pour la steppe. J’y avais trouvé à faire. J’y avais simplement habité, découvrant le repos de l’esprit entre des murs étrangers, le plaisir du lever au sein d’une ville dépouillée de secrets quoique lointaine. La routine s’était faite exquise. J’avais savouré ma présence, goûté l’air de la ville et des hauteurs voisines, fredonné les chansons à succès de Baterdene et de Sarantuya en arpentant les rues, suivi le rythme du rap musclé de Tatar et guetté les concerts de Javkhlan. Je m’étais approprié leur langue par bribes. De ce moment, du remous sentimental qui l’accompagna, je garde un souvenir tel qu’il m’est impossible de mesurer la portée de mes retours en Mongolie et le repos que j’y gagne, même loin de celle que j’aime, même si à chaque voyage, un de mes proches disparaît, comme par malédiction.
Je prenais le temps de donner par écrit une place aux émotions. Durant quelques semaines, je vécus en témoin de ma propre vie. Il subsiste de ces jours, hormis des feuillets noircis de phrases pittoresques, des souvenirs miraculeux qui donnent de l’éclat à mon existence, si servile autrement. La vie n’a d’intérêt que d’être vécue sans ambition, or j’étais parvenu à me dissoudre dans l’observation du lieu, à faire corps avec le milieu et les gens au cours d’un abandon passionnel de l’âme. Du reste, arpenter la steppe n’était plus une chose insurmontable pour mon corps tant il s’y était habitué. Les dernières semaines, je n’avais pas survécu dans le désert en suçotant du fromage séché. Je n’avais pas eu besoin de poursuivre mes chevaux en fuite. Encore moins m’avait-il fallu chercher ma pitance ou fuir la grêle. Le péril n’avait pas été mon pain quotidien. J’avais mené une vie simple et profité de nuits douces. Et de surcroît, dans la chaleur des cantines populaires, j’avais mangé à ma faim. J’étais allé chercher derrière le ciment des murs les rires, les parfums et les regards du peuple que j’aimais. Je vivais assez puissamment les jours d’hiver, qui renforcent l’isolement et le silence, pour ne rien regretter. Je ne voyageais guère. Le couteau rouillait dans son fourreau, les rangers restaient au placard. Je ne fuyais plus comme un bandit sans feu ni lieu. J’avais adopté une sorte de statisme, mais qui n’était qu’apparent, qui frappait le corps seul, autrement dit peu de chose. Tant de pensées vagabondes et d’idéaux d’un jour rebelles à l’immobilisme foisonnaient en moi que j’explorais la sédentarité comme une région inconnue. Le matin, après m’être dit “une fois encore”, j’entremêlais comme la veille mon destin à celui des rues. »
(p. 75-77)
Sous le joug des tempêtes (p. 93-96)
Le doux chant des heures d’été (p. 239-242)
Extrait court


