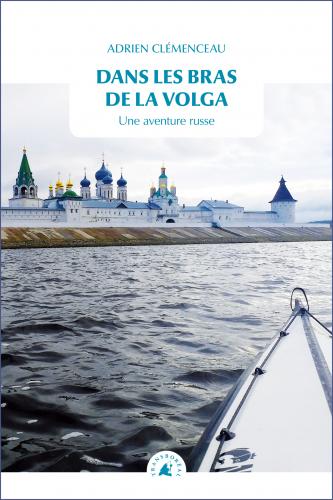
La steppe :
« La Volga est toujours malmenée par les vents. J’ai besoin d’une journée de repos supplémentaire en vue de la prochaine étape, qui doit me mener jusqu’au barrage de Balakovo. Toute la partie supérieure de mon corps est douloureuse : les articulations de mes mains, à force d’être cramponnées à la pagaie, me font souffrir au point de me réveiller la nuit. Mes épaules et mes bras sont raides. Depuis le début du voyage, je me nourris peu quand je suis sur l’eau. Seul, je ne parviens pas le soir à me préparer des dîners roboratifs ; je dévore mes rations lyophilisées puis me couche, comptant sur les haltes en ville pour compenser et faire de vrais repas. En conséquence, mon corps a changé. On pourrait croire qu’à force de pagayer le kayakiste se forge une carrure de colosse ; c’est souvent tout le contraire qui se produit. J’ai brûlé beaucoup de graisse sans prendre de masse : plus de fesses, et mes jambes sont minces comme des cannes d’émeu, mais il me reste le mental pour continuer.
Depuis le départ, jour après jour, j’ai la chance d’être toujours aussi déterminé. J’ai déjà pagayé 2 300 kilomètres ; il m’en reste plus de 1 000 pour parachever l’aventure. Mon voyage devrait encore durer une vingtaine de jours, un mois tout au plus, ce qui signifie que je naviguerai encore début novembre. Je l’avais imaginé mais je redoute cette perspective, synonyme de froid implacable. Je sais que ce sera un rude finale, mais, ayant déjà éprouvé l’adversité au Tatarstan, je me sens prêt.
Dukhovnitskoïe reste calme, et ma tente est abritée sous un arbre. Alors que je me brosse les dents, Sergueï, revenu de son labeur, s’adresse à moi depuis son balcon en exhibant sa corpulence la plus crue, velue et bedonnante :
— Quand vas-tu partir ?
Je ne peux que répliquer qu’il faudra encore attendre.
Sergueï s’en retourne dans son salon de ministre sans émettre d’autre parole.
Tandis que la journée s’écoule, les pensées affluent. Bon sang ! qu’est-ce qui m’a poussé à partir seul, si loin, pour me retrouver dans un village inconnu, perclus de douleurs, après que la moitié de mes affaires a été engloutie par le fleuve ? L’aventure ! une envie de m’évader et la certitude que si je ne l’avais pas fait le vide m’aurait aspiré, le néant. Les vagues de la Volga devenaient les pics de mon cardiogramme. Il me fallait voguer pour me sentir vivant.
Malgré les souffrances et l’éloignement, un sentiment de félicité – mélange de joie et de poésie – me porte. Sans hésiter, maintenant assis face au fleuve, je puis dire que je suis heureux ; heureux de suivre ce torrent de molécules denses qui me guide inlassablement. Le fleuve, telle une métaphore de la vie, une ode qui se déclame, aiguë ou grave, m’absorbe et s’infiltre dans mon âme. »
La Volga au grand cours (p. 57-60)
Volga et Kama (p. 107-109)
Extrait court
« La Volga est toujours malmenée par les vents. J’ai besoin d’une journée de repos supplémentaire en vue de la prochaine étape, qui doit me mener jusqu’au barrage de Balakovo. Toute la partie supérieure de mon corps est douloureuse : les articulations de mes mains, à force d’être cramponnées à la pagaie, me font souffrir au point de me réveiller la nuit. Mes épaules et mes bras sont raides. Depuis le début du voyage, je me nourris peu quand je suis sur l’eau. Seul, je ne parviens pas le soir à me préparer des dîners roboratifs ; je dévore mes rations lyophilisées puis me couche, comptant sur les haltes en ville pour compenser et faire de vrais repas. En conséquence, mon corps a changé. On pourrait croire qu’à force de pagayer le kayakiste se forge une carrure de colosse ; c’est souvent tout le contraire qui se produit. J’ai brûlé beaucoup de graisse sans prendre de masse : plus de fesses, et mes jambes sont minces comme des cannes d’émeu, mais il me reste le mental pour continuer.
Depuis le départ, jour après jour, j’ai la chance d’être toujours aussi déterminé. J’ai déjà pagayé 2 300 kilomètres ; il m’en reste plus de 1 000 pour parachever l’aventure. Mon voyage devrait encore durer une vingtaine de jours, un mois tout au plus, ce qui signifie que je naviguerai encore début novembre. Je l’avais imaginé mais je redoute cette perspective, synonyme de froid implacable. Je sais que ce sera un rude finale, mais, ayant déjà éprouvé l’adversité au Tatarstan, je me sens prêt.
Dukhovnitskoïe reste calme, et ma tente est abritée sous un arbre. Alors que je me brosse les dents, Sergueï, revenu de son labeur, s’adresse à moi depuis son balcon en exhibant sa corpulence la plus crue, velue et bedonnante :
— Quand vas-tu partir ?
Je ne peux que répliquer qu’il faudra encore attendre.
Sergueï s’en retourne dans son salon de ministre sans émettre d’autre parole.
Tandis que la journée s’écoule, les pensées affluent. Bon sang ! qu’est-ce qui m’a poussé à partir seul, si loin, pour me retrouver dans un village inconnu, perclus de douleurs, après que la moitié de mes affaires a été engloutie par le fleuve ? L’aventure ! une envie de m’évader et la certitude que si je ne l’avais pas fait le vide m’aurait aspiré, le néant. Les vagues de la Volga devenaient les pics de mon cardiogramme. Il me fallait voguer pour me sentir vivant.
Malgré les souffrances et l’éloignement, un sentiment de félicité – mélange de joie et de poésie – me porte. Sans hésiter, maintenant assis face au fleuve, je puis dire que je suis heureux ; heureux de suivre ce torrent de molécules denses qui me guide inlassablement. Le fleuve, telle une métaphore de la vie, une ode qui se déclame, aiguë ou grave, m’absorbe et s’infiltre dans mon âme. »
(p. 148-149)
La Volga au grand cours (p. 57-60)
Volga et Kama (p. 107-109)
Extrait court


