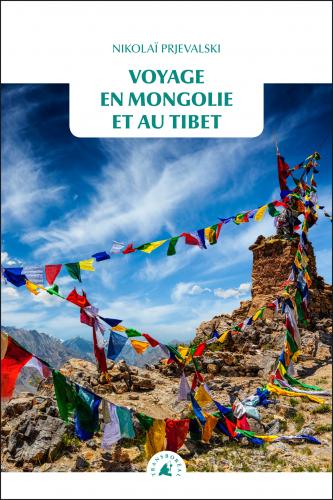
Les Mongols :
« C’est à Khalkha que la race mongole a conservé le type national dans sa plus grande pureté. L’habitant de ce pays est de taille moyenne et d’une constitution vigoureuse ; son visage large et brun a pour caractères la saillie des pommettes, le nez épaté et les yeux petits ; de grandes oreilles s’écartent d’un crâne anguleux recouvert d’une chevelure noire ; la barbe et les moustaches sont clairsemées.
Partout ailleurs, les Mongols ont perdu leur type original, particulièrement dans le voisinage de la Grande Muraille. Car, malgré leur existence errante, les Mongols méridionaux n’ont pu se soustraire à l’influence étrangère, qui, par son action lente, mais séculaire, a fini par les transformer à peu près en Chinois. Si le Mongol du Midi mène encore la vie pastorale et nomade, son extérieur et son caractère se rapprochent beaucoup plus de ceux du Chinois que de ceux de son compatriote du Nord. Depuis longtemps, les nomades du Sud s’unissent avec leurs voisins. Leur visage a perdu son cachet rude et grossier pour emprunter les traits réguliers des Chinois. Dans sa vie privée, le nomade trouve de bon goût d’imiter les coutumes du Céleste Empire ; la vie sauvage du désert ne lui offre plus d’attraits, et il lui préfère celle des grandes cités de la Chine, dont il a eu l’occasion d’apprécier les avantages. Malheureusement, le Mongol sinisé, tout en conservant les défauts du barbare, ne s’est assimilé que les vices de la civilisation. Aussi cette race s’est-elle plutôt abâtardie qu’elle ne s’est élevée dans l’échelle sociale.
Comme les Chinois, les Mongols se rasent la tête, à l’exception d’une touffe de cheveux qu’ils disposent en longue queue ; toutefois leurs lamas ont le crâne entièrement rasé. Personne ne laisse croître la barbe ni les moustaches. L’usage de porter la queue a été introduit en Chine par la conquête mandchoue, et depuis cette époque la queue, chez tous les peuples soumis au Céleste Empire, est un signe de leur vassalité.
Les femmes mongoles disposent ordinairement leur chevelure en deux tresses tombant, de chaque côté, sur la poitrine. Parfois les femmes mariées portent une seule natte, qui retombe par-derrière, et le sommet de leur tête est orné de plaques en argent, semées de corail rouge. Les pauvres remplacent le corail par des perles en verre ; mais les plaques sont d’ordinaire en argent, très rarement en cuivre. Les oreilles sont garnies de boucles en argent, et les bras et les doigts chargés de bracelets et de bagues.
Les vêtements des Mongols se composent d’un caftan, le plus souvent en cotonnade bleue, de bottes chinoises et d’un chapeau plat à bords relevés. Les chemises et les caleçons sont peu communs. En hiver, le costume est complété d’une culotte, d’une pelisse et d’un bonnet, le tout en peau d’agneau. Les élégants font usage, en été, d’un caftan en soie. La pelisse et le caftan sont serrés au corps par une ceinture, à laquelle est suspendu un petit sac contenant du tabac, une pipe et un briquet. Les habitants de Khalkha y joignent une tabatière, dont ils offrent une prise dès le premier échange de civilités. Mais le véritable luxe des nomades réside dans leurs harnachements, qui parfois sont en argent.
Les femmes se vêtent d’une robe flottante et endossent par-dessus une sorte de gilet sans manche. Il faut y ajouter que la coupe de vêtements du beau sexe et sa coiffure présentent de notables différences dans chaque contrée de la Mongolie.
L’habitation nationale des Mongols est la yourte en feutre. C’est une tente de forme ronde à la base ; le sommet est conique et ouvert afin de donner un passage à la fumée et à la lumière. La carcasse est formée par des perches enfoncées dans le sol, reliées par des cordes et laissant entre elles un espace suffisant pour entrer ou sortir en se baissant : c’est la porte. Les extrémités supérieures de ces perches sont réunies par un cercle de 3 ou 4 pieds de diamètre : c’est la cheminée et la fenêtre. Tout cet établissement, consolidé par des cordes tendues à l’extérieur, est recouvert de pièces de feutre que l’on double en hiver. Le diamètre ordinaire d’une pareille demeure est de 12 à 15 pieds et la hauteur de 10. L’âtre est établi au centre de la pièce, les dieux lares sont placés en face de la porte, et les ustensiles de ménage sont disposés le long des parois. Tout autour du foyer s’étalent, en guise de siège, des pièces de feutre, que les gens aisés remplacent par des tapis. Les yourtes princières sont planchéiées et décorées de tenture de soie. Pour le nomade, la yourte est une habitation appréciable : elle le protège de la chaleur et, tant que dure le feu, elle le défend contre les froids les plus vifs. Pendant la nuit, on éteint le foyer, on bouche l’ouverture du toit et la température reste encore suffisamment élevée. En été, le feutre est imperméable aux pluies les plus persistantes. »
Tibet septentrional (p. 352-355)
Retour dans l’Ala-Chan – route d’Ourga par le Gobi central (p. 416-419)
Extrait court
« C’est à Khalkha que la race mongole a conservé le type national dans sa plus grande pureté. L’habitant de ce pays est de taille moyenne et d’une constitution vigoureuse ; son visage large et brun a pour caractères la saillie des pommettes, le nez épaté et les yeux petits ; de grandes oreilles s’écartent d’un crâne anguleux recouvert d’une chevelure noire ; la barbe et les moustaches sont clairsemées.
Partout ailleurs, les Mongols ont perdu leur type original, particulièrement dans le voisinage de la Grande Muraille. Car, malgré leur existence errante, les Mongols méridionaux n’ont pu se soustraire à l’influence étrangère, qui, par son action lente, mais séculaire, a fini par les transformer à peu près en Chinois. Si le Mongol du Midi mène encore la vie pastorale et nomade, son extérieur et son caractère se rapprochent beaucoup plus de ceux du Chinois que de ceux de son compatriote du Nord. Depuis longtemps, les nomades du Sud s’unissent avec leurs voisins. Leur visage a perdu son cachet rude et grossier pour emprunter les traits réguliers des Chinois. Dans sa vie privée, le nomade trouve de bon goût d’imiter les coutumes du Céleste Empire ; la vie sauvage du désert ne lui offre plus d’attraits, et il lui préfère celle des grandes cités de la Chine, dont il a eu l’occasion d’apprécier les avantages. Malheureusement, le Mongol sinisé, tout en conservant les défauts du barbare, ne s’est assimilé que les vices de la civilisation. Aussi cette race s’est-elle plutôt abâtardie qu’elle ne s’est élevée dans l’échelle sociale.
Comme les Chinois, les Mongols se rasent la tête, à l’exception d’une touffe de cheveux qu’ils disposent en longue queue ; toutefois leurs lamas ont le crâne entièrement rasé. Personne ne laisse croître la barbe ni les moustaches. L’usage de porter la queue a été introduit en Chine par la conquête mandchoue, et depuis cette époque la queue, chez tous les peuples soumis au Céleste Empire, est un signe de leur vassalité.
Les femmes mongoles disposent ordinairement leur chevelure en deux tresses tombant, de chaque côté, sur la poitrine. Parfois les femmes mariées portent une seule natte, qui retombe par-derrière, et le sommet de leur tête est orné de plaques en argent, semées de corail rouge. Les pauvres remplacent le corail par des perles en verre ; mais les plaques sont d’ordinaire en argent, très rarement en cuivre. Les oreilles sont garnies de boucles en argent, et les bras et les doigts chargés de bracelets et de bagues.
Les vêtements des Mongols se composent d’un caftan, le plus souvent en cotonnade bleue, de bottes chinoises et d’un chapeau plat à bords relevés. Les chemises et les caleçons sont peu communs. En hiver, le costume est complété d’une culotte, d’une pelisse et d’un bonnet, le tout en peau d’agneau. Les élégants font usage, en été, d’un caftan en soie. La pelisse et le caftan sont serrés au corps par une ceinture, à laquelle est suspendu un petit sac contenant du tabac, une pipe et un briquet. Les habitants de Khalkha y joignent une tabatière, dont ils offrent une prise dès le premier échange de civilités. Mais le véritable luxe des nomades réside dans leurs harnachements, qui parfois sont en argent.
Les femmes se vêtent d’une robe flottante et endossent par-dessus une sorte de gilet sans manche. Il faut y ajouter que la coupe de vêtements du beau sexe et sa coiffure présentent de notables différences dans chaque contrée de la Mongolie.
L’habitation nationale des Mongols est la yourte en feutre. C’est une tente de forme ronde à la base ; le sommet est conique et ouvert afin de donner un passage à la fumée et à la lumière. La carcasse est formée par des perches enfoncées dans le sol, reliées par des cordes et laissant entre elles un espace suffisant pour entrer ou sortir en se baissant : c’est la porte. Les extrémités supérieures de ces perches sont réunies par un cercle de 3 ou 4 pieds de diamètre : c’est la cheminée et la fenêtre. Tout cet établissement, consolidé par des cordes tendues à l’extérieur, est recouvert de pièces de feutre que l’on double en hiver. Le diamètre ordinaire d’une pareille demeure est de 12 à 15 pieds et la hauteur de 10. L’âtre est établi au centre de la pièce, les dieux lares sont placés en face de la porte, et les ustensiles de ménage sont disposés le long des parois. Tout autour du foyer s’étalent, en guise de siège, des pièces de feutre, que les gens aisés remplacent par des tapis. Les yourtes princières sont planchéiées et décorées de tenture de soie. Pour le nomade, la yourte est une habitation appréciable : elle le protège de la chaleur et, tant que dure le feu, elle le défend contre les froids les plus vifs. Pendant la nuit, on éteint le foyer, on bouche l’ouverture du toit et la température reste encore suffisamment élevée. En été, le feutre est imperméable aux pluies les plus persistantes. »
(p. 83-86)
Tibet septentrional (p. 352-355)
Retour dans l’Ala-Chan – route d’Ourga par le Gobi central (p. 416-419)
Extrait court


