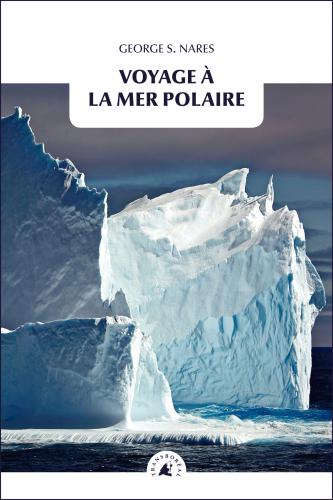
Markham vers le pôle :
« Dans la soirée du 8, le lieutenant Parr fit son apparition à bord de l’Alert. Comme il traversait le pont, saluant silencieusement de la tête les deux ou trois hommes qu’il y rencontra, personne ne se méprit à l’expression grave et fatiguée de ses traits, et, en quelques instants, la certitude d’un malheur s’était répandue dans tout le navire. Les misères du voyage avaient tellement changé notre camarade que, le prenant pour Beaumont son ami, dont le teint est extrêmement basané, je lui demandai avec anxiété quel était le désastre qui le ramenait si vite de la côte du Groenland.
J’appris alors la douloureuse nouvelle : la plupart des hommes de Markham étaient atteints du scorbut et en pressant besoin de secours ; le commandant, aidé d’une poignée de travailleurs encore valides, était parvenu à convoyer les malades dans les alentours du cap Joseph-Henry, à 50 kilomètres du navire ; il faisait tout son possible pour marcher encore, mais chaque jour ajoutait à l’intensité du fléau et au nombre de ceux qu’il frappait. Le lieutenant Parr s’était noblement offert pour venir réclamer notre prompte assistance. Muni de son alpenstock et d’une petite ration de vivres, il avait fait 20 milles sans désemparer avant d’arriver à la petite tente de chasse de la baie Dumbell où il s’était préparé, à la hâte, une tasse de thé ; puis cet homme vaillant avait repris sa course et fini, en vingt-quatre heures, cette longue et solitaire étape.
À minuit, tout était prêt et deux fortes escouades d’hommes et d’officiers quittaient le bord pour s’élancer à la rescousse. Le lieutenant May et le docteur Moss, chaussés de patins, allaient en avant avec les chiens et le traîneau chargé des médicaments les plus nécessaires. Une marche forcée les amena au camp de Markham cinquante heures après le départ du messager.
Leur arrivée remonta aussitôt le moral de nos pauvres compagnons ; malheureusement, il était trop tard pour un des voyageurs : George Porter venait d’expirer ; on l’avait enseveli dans le floe, tout près de la route.
Le lendemain, de bonne heure, je les rejoignais avec le reste de l’escouade de secours ; l’espoir et la confiance, qui ne les avaient jamais quittés entièrement, reprenaient le dessus ; les malades mêmes se relevèrent de leur extrême prostration, effet ordinaire du fléau ; leur abattement avait encore été augmenté par la mort récente de leur camarade.
Ceux qui n’ont pas été témoins de scènes semblables, au milieu des mornes déserts polaires, ne peuvent se faire une idée de l’aspect de ces malheureux qui, luttant avec la souffrance, essayaient de se traîner vers le navire.
Markham ouvrait la marche, attelé avec deux marins au premier traîneau ; puis venait le second, tiré aussi par trois hommes : chaque véhicule portait deux malades entourés d’autant de couvertures et de feutres qu’il en fallait pour conserver la chaleur et faire une couche aussi confortable que le permettaient les cahots de la route. Le cinquième scorbutique était étendu sur le dernier traîneau, chargé en outre du reste des bagages et des vivres ; quatre éclopés suivaient derrière sur la glace inégale, raboteuse et couverte de neige ; leurs membres, de jour en jour plus contractés, annonçaient qu’ils ne pourraient aller bien loin ; mais, vaillamment, ils tenaient ferme ; ils ne voulaient pas augmenter, avant qu’une nécessité absolue les y contraignît, le poids de fardeaux déjà bien lourds pour des camarades à peine moins faibles qu’eux.
Ces quatre pauvres diables partaient donc tous les matins avant le gros de la troupe, sachant trop bien qu’ils ne pourraient se relever tout seuls s’ils tombaient dans la neige ou s’ils avaient à traverser une barrière de névé exceptionnellement profonde ; souvent les traîneaux les trouvaient étendus sans force sur la neige, mais, une fois remis sur leurs jambes, ils reprenaient leur néfaste voyage avec quelque parole gaie ou un sourire de remerciement.
Outre Markham, qui hala son traîneau jusqu’à la dernière minute, non sans avoir tous les matins reconnu la route à suivre, je dois nommer les chefs d’équipe John Radmore et Thomas Jolliffe. Quoique les plus vigoureux de la troupe, ils étaient extrêmement affaiblis, mais, plutôt que de se démettre du poste d’honneur qui leur assignait le labeur supplémentaire de fouler la neige de leurs pieds pour faciliter le passage des transports, ils marchaient tous deux se donnant le bras, s’appuyant l’un sur l’autre, et, gardant bien tendue la sangle du traîneau, ils facilitaient d’autant l’œuvre de leurs compagnons épuisés.
La bonne humeur, le courage de chacun de ces hommes, leur résignation au dur travail exigé d’eux, leur lutte contre la plus affreuse des routes, leur force d’endurance sont certes au-dessus de toute louange. Après les avoir vus, je comprends ce que les Esquimaux disaient à sir Léopold McClintock des compagnons de sir John Franklin : “Ils tombaient et mouraient en marchant.” »
Quartiers d’hiver (p. 197-201)
Ultimes explorations (p. 580-583)
Extrait court
« Dans la soirée du 8, le lieutenant Parr fit son apparition à bord de l’Alert. Comme il traversait le pont, saluant silencieusement de la tête les deux ou trois hommes qu’il y rencontra, personne ne se méprit à l’expression grave et fatiguée de ses traits, et, en quelques instants, la certitude d’un malheur s’était répandue dans tout le navire. Les misères du voyage avaient tellement changé notre camarade que, le prenant pour Beaumont son ami, dont le teint est extrêmement basané, je lui demandai avec anxiété quel était le désastre qui le ramenait si vite de la côte du Groenland.
J’appris alors la douloureuse nouvelle : la plupart des hommes de Markham étaient atteints du scorbut et en pressant besoin de secours ; le commandant, aidé d’une poignée de travailleurs encore valides, était parvenu à convoyer les malades dans les alentours du cap Joseph-Henry, à 50 kilomètres du navire ; il faisait tout son possible pour marcher encore, mais chaque jour ajoutait à l’intensité du fléau et au nombre de ceux qu’il frappait. Le lieutenant Parr s’était noblement offert pour venir réclamer notre prompte assistance. Muni de son alpenstock et d’une petite ration de vivres, il avait fait 20 milles sans désemparer avant d’arriver à la petite tente de chasse de la baie Dumbell où il s’était préparé, à la hâte, une tasse de thé ; puis cet homme vaillant avait repris sa course et fini, en vingt-quatre heures, cette longue et solitaire étape.
À minuit, tout était prêt et deux fortes escouades d’hommes et d’officiers quittaient le bord pour s’élancer à la rescousse. Le lieutenant May et le docteur Moss, chaussés de patins, allaient en avant avec les chiens et le traîneau chargé des médicaments les plus nécessaires. Une marche forcée les amena au camp de Markham cinquante heures après le départ du messager.
Leur arrivée remonta aussitôt le moral de nos pauvres compagnons ; malheureusement, il était trop tard pour un des voyageurs : George Porter venait d’expirer ; on l’avait enseveli dans le floe, tout près de la route.
Le lendemain, de bonne heure, je les rejoignais avec le reste de l’escouade de secours ; l’espoir et la confiance, qui ne les avaient jamais quittés entièrement, reprenaient le dessus ; les malades mêmes se relevèrent de leur extrême prostration, effet ordinaire du fléau ; leur abattement avait encore été augmenté par la mort récente de leur camarade.
Ceux qui n’ont pas été témoins de scènes semblables, au milieu des mornes déserts polaires, ne peuvent se faire une idée de l’aspect de ces malheureux qui, luttant avec la souffrance, essayaient de se traîner vers le navire.
Markham ouvrait la marche, attelé avec deux marins au premier traîneau ; puis venait le second, tiré aussi par trois hommes : chaque véhicule portait deux malades entourés d’autant de couvertures et de feutres qu’il en fallait pour conserver la chaleur et faire une couche aussi confortable que le permettaient les cahots de la route. Le cinquième scorbutique était étendu sur le dernier traîneau, chargé en outre du reste des bagages et des vivres ; quatre éclopés suivaient derrière sur la glace inégale, raboteuse et couverte de neige ; leurs membres, de jour en jour plus contractés, annonçaient qu’ils ne pourraient aller bien loin ; mais, vaillamment, ils tenaient ferme ; ils ne voulaient pas augmenter, avant qu’une nécessité absolue les y contraignît, le poids de fardeaux déjà bien lourds pour des camarades à peine moins faibles qu’eux.
Ces quatre pauvres diables partaient donc tous les matins avant le gros de la troupe, sachant trop bien qu’ils ne pourraient se relever tout seuls s’ils tombaient dans la neige ou s’ils avaient à traverser une barrière de névé exceptionnellement profonde ; souvent les traîneaux les trouvaient étendus sans force sur la neige, mais, une fois remis sur leurs jambes, ils reprenaient leur néfaste voyage avec quelque parole gaie ou un sourire de remerciement.
Outre Markham, qui hala son traîneau jusqu’à la dernière minute, non sans avoir tous les matins reconnu la route à suivre, je dois nommer les chefs d’équipe John Radmore et Thomas Jolliffe. Quoique les plus vigoureux de la troupe, ils étaient extrêmement affaiblis, mais, plutôt que de se démettre du poste d’honneur qui leur assignait le labeur supplémentaire de fouler la neige de leurs pieds pour faciliter le passage des transports, ils marchaient tous deux se donnant le bras, s’appuyant l’un sur l’autre, et, gardant bien tendue la sangle du traîneau, ils facilitaient d’autant l’œuvre de leurs compagnons épuisés.
La bonne humeur, le courage de chacun de ces hommes, leur résignation au dur travail exigé d’eux, leur lutte contre la plus affreuse des routes, leur force d’endurance sont certes au-dessus de toute louange. Après les avoir vus, je comprends ce que les Esquimaux disaient à sir Léopold McClintock des compagnons de sir John Franklin : “Ils tombaient et mouraient en marchant.” »
(p. 359-362)
Quartiers d’hiver (p. 197-201)
Ultimes explorations (p. 580-583)
Extrait court


