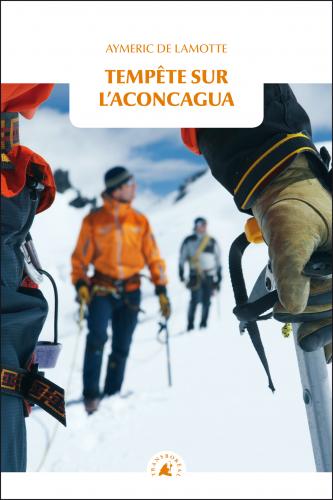
Le Nid des condors :
« Durant ces journées d’ascension, je m’étais plongé dans la lecture des Nourritures terrestres, long poème en prose dans lequel André Gide évoque l’éveil et l’exaltation des sens au contact de la nature. Je dévorais l’ouvrage avec avidité en espérant y cultiver ma propre sensibilité. Gide s’y fait le maître du jeune Nathanaël auquel il souhaite enseigner la ferveur afin de l’émanciper de sa nature tendre et pusillanime. Une interprétation des Nourritures, peut-être caricaturale, a d’ailleurs contribué à créditer, au sein du débat politico-philosophique, une idéologie libérale-libertaire qui a érigé le déracinement et le mouvement en norme, voire en injonction.
Certes, l’immobilité use l’homme, l’avachit et le tue à petit feu ; mais il n’est pas fait pour cingler vers l’océan et errer éternellement. L’homme est fait pour être enraciné. Le propos de la philosophe Simone Weil, dans son ouvrage L’Enracinement, est éloquent à cet égard :
“L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie.”
Dans un échange épistolaire avec Maurice Barrès qui publie, curieuse conjoncture, ses Déracinés la même année que les Nourritures terrestres, Gide tronque la notion d’enracinement sur laquelle il colle une acception rance de repli sur soi qui éloignerait l’homme de l’indépendance d’esprit, du changement et des “terres nouvelles”. Il participe à construire la dichotomie entre l’immobilité et le mouvement qui est si navrante pour l’esprit et inapte à décrire avec nuance la nature humaine. Naturellement, le fait qu’un individu s’enracine ne signifie pas qu’il ne puisse pas voyager, vivre et travailler à l’étranger – n’étais-je pas moi-même parti explorer de lointaines contrées ? –, mais cela signifie qu’il a besoin d’un chez-soi. Il reçoit en héritage une vision de l’homme et du monde qui le structure et qui guide involontairement ses choix et son comportement. Il en prend conscience et décide de la transmettre, de l’ajuster, de la corriger ou de la rejeter en partie. Il prolonge ce donné en se familiarisant avec une géographie, une histoire, une culture, des personnes. Il multiplie et approfondit ainsi les liens qu’il noue avec un lieu déterminé. Il se sent alors appartenir à une communauté de destin et est soucieux de celle-ci et de sa pérennité. La cécité anthropologique de Gide est précisément de ne pas pressentir cette soif de permanence et d’appartenance qui sourd dans le tréfonds de chaque individu. L’appartenance ne signifie pas l’engluement. S’enraciner ne veut pas dire se figer, mais bien que nous venons de quelque part, que nous ne sommes pas des êtres hors-sol aux semelles de vent.
La marche dans les Andes confirmait l’intuition de Simone Weil. J’avais beau être au bout du monde, si éloigné par le temps et par l’espace de tout ce que je connaissais, je pensais fréquemment aux miens. »
Le miracle des Andes (p. 82-84)
Et la neige s’abattit (p. 129-131)
Extrait court
« Durant ces journées d’ascension, je m’étais plongé dans la lecture des Nourritures terrestres, long poème en prose dans lequel André Gide évoque l’éveil et l’exaltation des sens au contact de la nature. Je dévorais l’ouvrage avec avidité en espérant y cultiver ma propre sensibilité. Gide s’y fait le maître du jeune Nathanaël auquel il souhaite enseigner la ferveur afin de l’émanciper de sa nature tendre et pusillanime. Une interprétation des Nourritures, peut-être caricaturale, a d’ailleurs contribué à créditer, au sein du débat politico-philosophique, une idéologie libérale-libertaire qui a érigé le déracinement et le mouvement en norme, voire en injonction.
Certes, l’immobilité use l’homme, l’avachit et le tue à petit feu ; mais il n’est pas fait pour cingler vers l’océan et errer éternellement. L’homme est fait pour être enraciné. Le propos de la philosophe Simone Weil, dans son ouvrage L’Enracinement, est éloquent à cet égard :
“L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l’âme humaine. C’est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d’avenir. Participation naturelle, c’est-à-dire amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l’entourage. Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l’intermédiaire des milieux dont il fait naturellement partie.”
Dans un échange épistolaire avec Maurice Barrès qui publie, curieuse conjoncture, ses Déracinés la même année que les Nourritures terrestres, Gide tronque la notion d’enracinement sur laquelle il colle une acception rance de repli sur soi qui éloignerait l’homme de l’indépendance d’esprit, du changement et des “terres nouvelles”. Il participe à construire la dichotomie entre l’immobilité et le mouvement qui est si navrante pour l’esprit et inapte à décrire avec nuance la nature humaine. Naturellement, le fait qu’un individu s’enracine ne signifie pas qu’il ne puisse pas voyager, vivre et travailler à l’étranger – n’étais-je pas moi-même parti explorer de lointaines contrées ? –, mais cela signifie qu’il a besoin d’un chez-soi. Il reçoit en héritage une vision de l’homme et du monde qui le structure et qui guide involontairement ses choix et son comportement. Il en prend conscience et décide de la transmettre, de l’ajuster, de la corriger ou de la rejeter en partie. Il prolonge ce donné en se familiarisant avec une géographie, une histoire, une culture, des personnes. Il multiplie et approfondit ainsi les liens qu’il noue avec un lieu déterminé. Il se sent alors appartenir à une communauté de destin et est soucieux de celle-ci et de sa pérennité. La cécité anthropologique de Gide est précisément de ne pas pressentir cette soif de permanence et d’appartenance qui sourd dans le tréfonds de chaque individu. L’appartenance ne signifie pas l’engluement. S’enraciner ne veut pas dire se figer, mais bien que nous venons de quelque part, que nous ne sommes pas des êtres hors-sol aux semelles de vent.
La marche dans les Andes confirmait l’intuition de Simone Weil. J’avais beau être au bout du monde, si éloigné par le temps et par l’espace de tout ce que je connaissais, je pensais fréquemment aux miens. »
(p. 93-95)
Le miracle des Andes (p. 82-84)
Et la neige s’abattit (p. 129-131)
Extrait court


