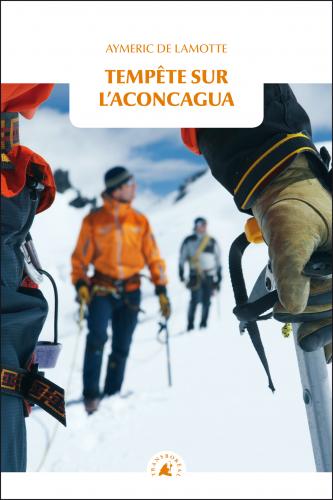
Le miracle des Andes :
« J’aimais m’isoler à quelques dizaines de mètres du camp pour écrire. J’excluais de mon champ de vision toute présence humaine et toute marque de l’homme. La nature m’inondait de son calme d’éternité, accumulé depuis le fond des âges. Mon habituelle nervosité s’estompait. Je voulais me fondre dans le paysage, en avaler la beauté. J’observais et je tentais de m’accorder au monde. C’était sans espoir. Grâce à certaines lectures, je savais vaguement en théorie ce que cela signifiait ; mais mon œil et mon esprit, rompus à la vie affairée de citadin, n’avaient jamais fait l’expérience de la véritable observation, au sens d’une contemplation. Dans Saint Exupéry Paraclet, Sylvain Fort explique que Saint Exupéry et Simone Weil, tous deux postés au seuil de la foi chrétienne, étanchent leur soif spirituelle dans l’attention extrême et la contemplation. Il y a la volonté d’établir une liaison entre soi et le monde. Dans Pilote de guerre, Saint Exupéry parle de “présence au monde” lorsqu’il évoque l’attitude du dominicain qui prie, de Louis Pasteur qui analyse le microbe ou de Cézanne qui peint. Simone Weil abonde ainsi : “Quand on écoute du Bach ou une mélodie grégorienne, toutes les facultés de l’âme se taisent et se tendent pour appréhender cette chose parfaitement belle.”
Je tentais pour ma part d’appréhender cette chose parfaitement belle qu’était la nature andine. Je m’imposais alors un jeu : je ne pouvais m’arrêter de contempler le paysage que lorsque j’en avais été repu à trois reprises. À la première saturation, je me forçais de continuer à le fixer, ainsi à la deuxième saturation ; enfin, à la troisième, je me permettais de détourner les yeux, saoulé de scénographie. Plus d’une fois, ma persévérance paya. Le paysage se comporte à l’instar d’une demoiselle prude qui cache ses trésors. La patience est le prix à payer. Après quelque temps d’observation, je découvrais une seconde couche du réel qui me faisait pourtant face dès les premiers coups d’œil. Je rentrais dans ses interstices ; ses subtilités se révélaient à moi. Et il est vrai que l’attention extrême et prolongée aiguise la familiarité et rend plus sensible. Le regard ne se lasse jamais d’un spectacle de splendeur. Plus on observe un paysage, plus il se magnifie. N’étant pas, quant à moi, au seuil de la foi chrétienne, mais bien les deux pieds dedans, je considérais le spectacle andin comme la manifestation du mystère de la Création. Et la beauté qui explosait de toutes parts affermissait ma croyance en Dieu. Je le sentais distinctement dans mon for intérieur : l’approfondissement de ma “présence au monde” accentuait Sa présence. »
Le Nid des condors (p. 93-95)
Et la neige s’abattit (p. 129-131)
Extrait court
« J’aimais m’isoler à quelques dizaines de mètres du camp pour écrire. J’excluais de mon champ de vision toute présence humaine et toute marque de l’homme. La nature m’inondait de son calme d’éternité, accumulé depuis le fond des âges. Mon habituelle nervosité s’estompait. Je voulais me fondre dans le paysage, en avaler la beauté. J’observais et je tentais de m’accorder au monde. C’était sans espoir. Grâce à certaines lectures, je savais vaguement en théorie ce que cela signifiait ; mais mon œil et mon esprit, rompus à la vie affairée de citadin, n’avaient jamais fait l’expérience de la véritable observation, au sens d’une contemplation. Dans Saint Exupéry Paraclet, Sylvain Fort explique que Saint Exupéry et Simone Weil, tous deux postés au seuil de la foi chrétienne, étanchent leur soif spirituelle dans l’attention extrême et la contemplation. Il y a la volonté d’établir une liaison entre soi et le monde. Dans Pilote de guerre, Saint Exupéry parle de “présence au monde” lorsqu’il évoque l’attitude du dominicain qui prie, de Louis Pasteur qui analyse le microbe ou de Cézanne qui peint. Simone Weil abonde ainsi : “Quand on écoute du Bach ou une mélodie grégorienne, toutes les facultés de l’âme se taisent et se tendent pour appréhender cette chose parfaitement belle.”
Je tentais pour ma part d’appréhender cette chose parfaitement belle qu’était la nature andine. Je m’imposais alors un jeu : je ne pouvais m’arrêter de contempler le paysage que lorsque j’en avais été repu à trois reprises. À la première saturation, je me forçais de continuer à le fixer, ainsi à la deuxième saturation ; enfin, à la troisième, je me permettais de détourner les yeux, saoulé de scénographie. Plus d’une fois, ma persévérance paya. Le paysage se comporte à l’instar d’une demoiselle prude qui cache ses trésors. La patience est le prix à payer. Après quelque temps d’observation, je découvrais une seconde couche du réel qui me faisait pourtant face dès les premiers coups d’œil. Je rentrais dans ses interstices ; ses subtilités se révélaient à moi. Et il est vrai que l’attention extrême et prolongée aiguise la familiarité et rend plus sensible. Le regard ne se lasse jamais d’un spectacle de splendeur. Plus on observe un paysage, plus il se magnifie. N’étant pas, quant à moi, au seuil de la foi chrétienne, mais bien les deux pieds dedans, je considérais le spectacle andin comme la manifestation du mystère de la Création. Et la beauté qui explosait de toutes parts affermissait ma croyance en Dieu. Je le sentais distinctement dans mon for intérieur : l’approfondissement de ma “présence au monde” accentuait Sa présence. »
(p. 82-84)
Le Nid des condors (p. 93-95)
Et la neige s’abattit (p. 129-131)
Extrait court


