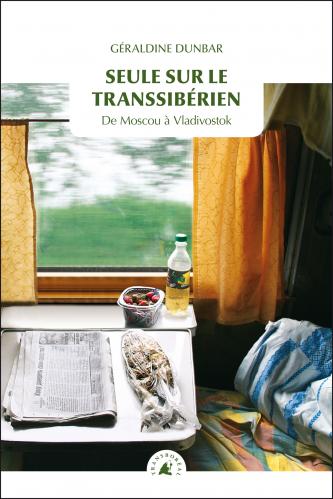
Prélude à l’aventure :
« Avril 2004. L’URSS n’existe plus depuis treize ans, remplacée par une Communauté des États indépendants (CEI). La Russie est un État dit “démocratique” qui a connu sa troisième campagne présidentielle de l’ère postcommuniste. Signe des temps, le président Vladimir Poutine a même été invité à boire le thé avec la reine d’Angleterre, honneur jusqu’alors réservé aux tsars.
La Russie est un pays dans lequel on se rend maintenant librement. En témoigne la pléthore de guides au rayon tourisme des librairies – Grand Week-End à Saint-Pétersbourg, Moscou, Moscou/Saint-Pétersbourg, La Russie? Se souvient-on de la grande époque où ne figuraient en magasin que les “Guides bleus” de l’URSS et de Leningrad en un ou deux exemplaires poussiéreux ? En découvrant la première édition du “Routard” consacré à Moscou (2002-2003), je fus envahie d’une véritable mélancolie : la Russie n’était plus une destination hors du commun. Pour connaître encore le parfum authentique de ce pays immense et nébuleux, il fallait se déplacer. Si possible vers l’est.
L’idée de prendre le Transsibérien est née d’un désir longtemps enfoui. Je devais avoir 7 ans lorsque je découvris dans un vieil atlas que cette terre, mystérieusement appelée “Sibir” par les Russes (“la terre qui sommeille”, en bouriate), occupait un tiers de l’hémisphère Nord, soit un espace plus vaste encore que les États-Unis et l’Europe réunis. En fermant les yeux, je revois mes petites mains froides caressant la double page épaisse de l’atlas? Le monde interdit. Coloré dans un rouge carmin synonyme de danger. Un monde ponctué par des villes aux noms qui suscitaient autant de curiosité que d’effroi – Sverdlovsk, Omsk, Novossibirsk, Tomsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Khabarovsk? Ma vie devait être marquée par cette vision et cette incompréhension ; je ne parvenais pas à imaginer les Russes ennemis, comme le soutenait la propagande des années 1970-1980, mais plutôt comme un peuple doté d’un courage à la hauteur de ses souffrances, d’une chaleur humaine grande comme ses plaines, ainsi que d’un héritage culturel et spirituel sans égal au vu de son passé tourmenté. Son histoire, il fallait la connaître.
We share the same biology, regardless of ideology.
Mon premier contact avec la langue et la culture russes eut lieu en 1984, lorsque ma mère m’encouragea à choisir le russe comme seconde langue au Lycée français de Londres. Je me souviens encore de la feuille sur laquelle étaient indiquées les principales langues enseignées à l’école : espagnol, allemand, italien, russe. Il fallait cocher l’une des quatre cases. Ma mère, guidée par une intuition incroyable, me fit comprendre que le russe, au-delà de sa beauté, était une langue d’avenir, car l’État soviétique n’allait pas et ne pouvait pas durer. Son avis, pour le moins excentrique à l’époque, était motivé par un profond sentiment humaniste : “Les gens qui vivent là-bas sont comme toi et moi : il ne faut pas confondre la propagande avec le peuple. Nous sommes tous sur la même terre ; 300 millions de personnes vivent là-bas, c’est ton devoir de les connaître.” Je voulais la croire et, en même temps, j’avais peur du regard des autres. Quels que soient les régimes qui se succèdent, nul individu n’échappe au regard d’autrui. Parfois ouvert, souvent fermé, destructeur donc. Mes camarades, comme je le craignais, furent unanimement surpris par mon choix peu orthodoxe. “Communiste” et “espionne” sont des mots qui ne me furent pas épargnés.
Affalée derrière la table basse de notre salon, avec le cœur qui battait fort, je cochai la case “russe” au Bic bleu, en appuyant bien fort sur la bille, sans me rendre compte de l’impact qu’aurait ce geste sur ma vie future. Je me souviens simplement de l’émotion avec laquelle ma mère inscrivit quelques mois plus tard mon nom et mon prénom en tête du Petit Larousse, en me disant qu’elle aurait rêvé d’apprendre la langue de Iouri Gagarine, mais qu’en son temps ce n’était pas possible.
Mon premier cours fut déterminant et marqua le début d’une passion durable pour ce pays. La salle de classe était la plus sombre et la plus petite du lycée – 12 mètres carrés environ –, dominée par une immense carte de l’URSS. Elle comportait quinze pupitres, mais en réalité nous n’étions que cinq ou six élèves. J’y appris l’alphabet cyrillique, puis mes premiers mots : isba (maison en bois), routchka (stylo), kochka (chat), sobaka (chien). À l’issue de ce cours, nous étions contents d’avoir réussi à formuler des questions et des réponses d’une grande complexité :
— Est-ce un chat ?
— Niet, ce n’est pas un chat, c’est un stylo.
Davantage de temps fut nécessaire pour assimiler Soyouz Sovietskikh Sotsialistitcheskikh Respublik (Union des républiques socialistes soviétiques) mais, déjà, j’étais conquise ! »
Du Baïkal à Vladivostok (p. 187-190)
Épilogue (p. 315-319)
Extrait court
« Avril 2004. L’URSS n’existe plus depuis treize ans, remplacée par une Communauté des États indépendants (CEI). La Russie est un État dit “démocratique” qui a connu sa troisième campagne présidentielle de l’ère postcommuniste. Signe des temps, le président Vladimir Poutine a même été invité à boire le thé avec la reine d’Angleterre, honneur jusqu’alors réservé aux tsars.
La Russie est un pays dans lequel on se rend maintenant librement. En témoigne la pléthore de guides au rayon tourisme des librairies – Grand Week-End à Saint-Pétersbourg, Moscou, Moscou/Saint-Pétersbourg, La Russie? Se souvient-on de la grande époque où ne figuraient en magasin que les “Guides bleus” de l’URSS et de Leningrad en un ou deux exemplaires poussiéreux ? En découvrant la première édition du “Routard” consacré à Moscou (2002-2003), je fus envahie d’une véritable mélancolie : la Russie n’était plus une destination hors du commun. Pour connaître encore le parfum authentique de ce pays immense et nébuleux, il fallait se déplacer. Si possible vers l’est.
L’idée de prendre le Transsibérien est née d’un désir longtemps enfoui. Je devais avoir 7 ans lorsque je découvris dans un vieil atlas que cette terre, mystérieusement appelée “Sibir” par les Russes (“la terre qui sommeille”, en bouriate), occupait un tiers de l’hémisphère Nord, soit un espace plus vaste encore que les États-Unis et l’Europe réunis. En fermant les yeux, je revois mes petites mains froides caressant la double page épaisse de l’atlas? Le monde interdit. Coloré dans un rouge carmin synonyme de danger. Un monde ponctué par des villes aux noms qui suscitaient autant de curiosité que d’effroi – Sverdlovsk, Omsk, Novossibirsk, Tomsk, Krasnoïarsk, Irkoutsk, Khabarovsk? Ma vie devait être marquée par cette vision et cette incompréhension ; je ne parvenais pas à imaginer les Russes ennemis, comme le soutenait la propagande des années 1970-1980, mais plutôt comme un peuple doté d’un courage à la hauteur de ses souffrances, d’une chaleur humaine grande comme ses plaines, ainsi que d’un héritage culturel et spirituel sans égal au vu de son passé tourmenté. Son histoire, il fallait la connaître.
We share the same biology, regardless of ideology.
Mon premier contact avec la langue et la culture russes eut lieu en 1984, lorsque ma mère m’encouragea à choisir le russe comme seconde langue au Lycée français de Londres. Je me souviens encore de la feuille sur laquelle étaient indiquées les principales langues enseignées à l’école : espagnol, allemand, italien, russe. Il fallait cocher l’une des quatre cases. Ma mère, guidée par une intuition incroyable, me fit comprendre que le russe, au-delà de sa beauté, était une langue d’avenir, car l’État soviétique n’allait pas et ne pouvait pas durer. Son avis, pour le moins excentrique à l’époque, était motivé par un profond sentiment humaniste : “Les gens qui vivent là-bas sont comme toi et moi : il ne faut pas confondre la propagande avec le peuple. Nous sommes tous sur la même terre ; 300 millions de personnes vivent là-bas, c’est ton devoir de les connaître.” Je voulais la croire et, en même temps, j’avais peur du regard des autres. Quels que soient les régimes qui se succèdent, nul individu n’échappe au regard d’autrui. Parfois ouvert, souvent fermé, destructeur donc. Mes camarades, comme je le craignais, furent unanimement surpris par mon choix peu orthodoxe. “Communiste” et “espionne” sont des mots qui ne me furent pas épargnés.
Affalée derrière la table basse de notre salon, avec le cœur qui battait fort, je cochai la case “russe” au Bic bleu, en appuyant bien fort sur la bille, sans me rendre compte de l’impact qu’aurait ce geste sur ma vie future. Je me souviens simplement de l’émotion avec laquelle ma mère inscrivit quelques mois plus tard mon nom et mon prénom en tête du Petit Larousse, en me disant qu’elle aurait rêvé d’apprendre la langue de Iouri Gagarine, mais qu’en son temps ce n’était pas possible.
Mon premier cours fut déterminant et marqua le début d’une passion durable pour ce pays. La salle de classe était la plus sombre et la plus petite du lycée – 12 mètres carrés environ –, dominée par une immense carte de l’URSS. Elle comportait quinze pupitres, mais en réalité nous n’étions que cinq ou six élèves. J’y appris l’alphabet cyrillique, puis mes premiers mots : isba (maison en bois), routchka (stylo), kochka (chat), sobaka (chien). À l’issue de ce cours, nous étions contents d’avoir réussi à formuler des questions et des réponses d’une grande complexité :
— Est-ce un chat ?
— Niet, ce n’est pas un chat, c’est un stylo.
Davantage de temps fut nécessaire pour assimiler Soyouz Sovietskikh Sotsialistitcheskikh Respublik (Union des républiques socialistes soviétiques) mais, déjà, j’étais conquise ! »
(p. 29-32)
Du Baïkal à Vladivostok (p. 187-190)
Épilogue (p. 315-319)
Extrait court


