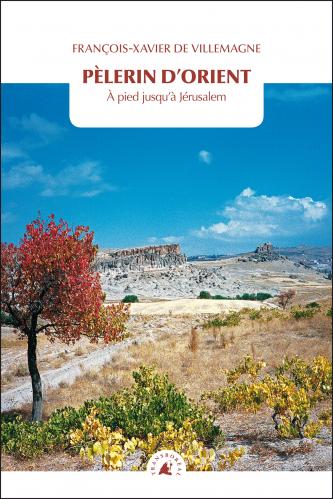
La onzième heure :
« Délaissant l’autoroute qui me conduirait à la Vieille Ville en trois heures, je m’enfonce dans les collines boisées de Judée. Au bout d’une quinzaine de kilomètres, j’atteins la voie ferrée désaffectée qui reliait Tel-Aviv et Jérusalem. Celle qu’empruntaient, au début du XXe siècle, les pèlerins débarqués à Jaffa. Certains nostalgiques se lamentaient déjà des ravages du progrès qui bouleversait leur vision surannée d’une Jérusalem biblique où l’on ne pourrait sans doute pénétrer qu’à dos d’âne, comme Jésus le jour des Rameaux.
La ligne serpente et s’élève lentement entre les collines silencieuses. Dans la lumière limpide de cette matinée d’hiver, le paysage respire une paix à démentir toute la folie des hommes. Achever la montée à Jérusalem dans une telle sérénité lumineuse est un pur bonheur. Frayant mon chemin au flanc des versants boisés, je demeure concentré sur l’ultime poignée de kilomètres, mais intérieurement tout mon être galope avec ivresse sur les nuées imaginaires de la victoire.
Un cueilleur de champignons m’avertit : “La voie trace la frontière avec les territoires palestiniens. C’est la Ligne verte. Il serait plus prudent de rester du côté nord, en Israël.”
Ainsi, les deux rails de fer seront mon dernier fil de funambule. Le danger de tutoyer cette lisière entre deux mondes m’attire irrésistiblement. J’y verrais volontiers un infime espace de paix, mais ce n’est qu’une illusion de neutralité où chacun pourrait bien me confondre avec l’ennemi.
Dans une courbe, la voie enserre un village arabe. Les maisons s’étagent sur le coteau d’en face, groupées autour de la mosquée. Des passants couverts du keffieh déambulent dans les rues. On entend les élèves crier sous le préau de la cour de récréation. La vie normale de n’importe quel village en paix. Mais ils sont “de l’autre bord”. Terriblement étrangers. Sous mes pieds, les rails rouillés s’enfuient honteusement, aussi barbares qu’une ligne de fer barbelé, tandis que les collines des alentours se couronnent de quartiers juifs à l’allure de forteresses imprenables. »
Jandarma (p. 189-193)
Les roses de Quasimodo (p. 218-222)
Hadji François (p. 257-260)
« Délaissant l’autoroute qui me conduirait à la Vieille Ville en trois heures, je m’enfonce dans les collines boisées de Judée. Au bout d’une quinzaine de kilomètres, j’atteins la voie ferrée désaffectée qui reliait Tel-Aviv et Jérusalem. Celle qu’empruntaient, au début du XXe siècle, les pèlerins débarqués à Jaffa. Certains nostalgiques se lamentaient déjà des ravages du progrès qui bouleversait leur vision surannée d’une Jérusalem biblique où l’on ne pourrait sans doute pénétrer qu’à dos d’âne, comme Jésus le jour des Rameaux.
La ligne serpente et s’élève lentement entre les collines silencieuses. Dans la lumière limpide de cette matinée d’hiver, le paysage respire une paix à démentir toute la folie des hommes. Achever la montée à Jérusalem dans une telle sérénité lumineuse est un pur bonheur. Frayant mon chemin au flanc des versants boisés, je demeure concentré sur l’ultime poignée de kilomètres, mais intérieurement tout mon être galope avec ivresse sur les nuées imaginaires de la victoire.
Un cueilleur de champignons m’avertit : “La voie trace la frontière avec les territoires palestiniens. C’est la Ligne verte. Il serait plus prudent de rester du côté nord, en Israël.”
Ainsi, les deux rails de fer seront mon dernier fil de funambule. Le danger de tutoyer cette lisière entre deux mondes m’attire irrésistiblement. J’y verrais volontiers un infime espace de paix, mais ce n’est qu’une illusion de neutralité où chacun pourrait bien me confondre avec l’ennemi.
Dans une courbe, la voie enserre un village arabe. Les maisons s’étagent sur le coteau d’en face, groupées autour de la mosquée. Des passants couverts du keffieh déambulent dans les rues. On entend les élèves crier sous le préau de la cour de récréation. La vie normale de n’importe quel village en paix. Mais ils sont “de l’autre bord”. Terriblement étrangers. Sous mes pieds, les rails rouillés s’enfuient honteusement, aussi barbares qu’une ligne de fer barbelé, tandis que les collines des alentours se couronnent de quartiers juifs à l’allure de forteresses imprenables. »
(p. 364-365)
Jandarma (p. 189-193)
Les roses de Quasimodo (p. 218-222)
Hadji François (p. 257-260)


