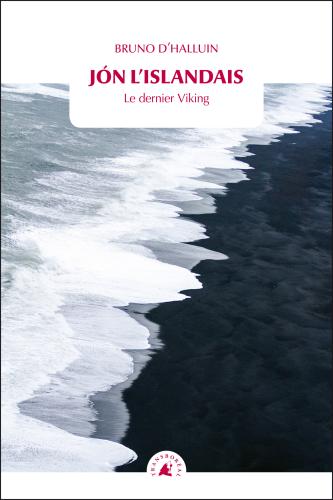
Naviguer à l’estime :
« Les hommes savaient que lorsqu’on poursuivait un dessein exigeant, tout le reste devait s’effacer, sous peine de risquer l’échec. C’était ingrat et exaltant. Quitte à sacrifier des amitiés, des amours, ils devaient suivre leur destin sans compromission.
La vision du corps d’Alice se serrant contre le sien hantait souvent les nuits de Jón. Il savait qu’il ne la reverrait plus. Il savait aussi qu’il toucherait à d’autres femmes, c’était en tout cas ce que lui prédisait Thorkell. En attendant, il fixait l’image de la jeune Anglaise dans ses pensées, depuis ses mèches blondes jusqu’à ses pieds fins, redessinant une boucle, s’attardant sur une courbe. Toutefois, la perception de sensations plus fines s’estompait malgré lui : son parfum, le goût de ses lèvres. Alice commençait à lui échapper, à devenir plus diffuse. Cela l’irritait et le soulageait à la fois.
Durant ses quarts, il n’y pensait jamais. Ce jour-là, Brian lui enseigna ce qu’était la navigation à l’estime. Lorsqu’on s’éloignait des repères qu’offrait la terre, il fallait évaluer continuellement son cap et sa vitesse afin d’en déduire la route suivie. Depuis l’archipel des Shetland jusqu’en Islande, c’était la pleine mer et il faudrait naviguer à l’estime. Brian lui apprit comment certains capitaines mesuraient la vitesse de leur bateau. Il dit à Jón d’aller à la proue et de lancer une vieille planche par-dessus bord, le long du flanc du navire. Il se posta lui-même à la poupe. Lorsque le morceau de bois fut lancé, il le scruta attentivement à la surface de l’eau, puis leva le bras quand il passa devant lui. Il déclara, énigmatique :
— Le problème, c’est qu’on n’a pas de sablier à bord.
Comme l’apprenti matelot restait interdit, Brian expliqua que si on mesurait le temps que la planche avait mis pour aller de la proue à la poupe, et si on connaissait la distance entre ces deux extrémités, on pouvait en déduire la vitesse du bateau. Jón resta un moment à regarder la mer, puis s’empara d’un bout de bois et le lança dans la vague d’étrave. Sur toute sa longueur, la coque glissa le long du bâton. Il commençait à comprendre.
— Comment on va faire, sans sablier, en pleine mer ?
Depuis longtemps, Brian savait estimer la vitesse des bateaux sans sablier, au défilement des vagues, à l’angle de gîte, au chuintement de l’étrave, aux marques du sillage. Il répondit :
— On essaiera d’en trouver un aux Shetland.
— Donc, l’aiguille et la pierre d’aimant pour le cap, la planche et le sablier pour la vitesse. Et l’estime est faite ! déclara Jón, ravi.
— C’est pas si simple, tempéra Brian. N’oublie jamais la règle de base : il faut toujours rester humble devant la mer. Il n’y a pas de sablier ou d’aiguille qui sache donner la force et la direction des courants. Faut savoir se passer des instruments. Je me souviens, j’ai navigué une fois en mer du Nord sur un bateau marchand, sous les ordres d’un espèce de jeune blanc-bec, un fils d’armateur. Le ciel était couvert, on pouvait pas voir l’étoile-guide. Et le capitaine ne trouvait plus son chemin, parce qu’il avait perdu sa pierre d’aimant. Mais le vieux timonier, lui, n’avait pas besoin de consignes pour ramener le bateau. Il connaissait la houle, les nuages, les oiseaux de mer, les algues flottantes, tout ça.
Ce n’était guère encourageant. L’apprentissage de la navigation requérait-il donc de si longues années ? Brian sourit en avisant la mine déconfite de son élève.
— Il y en a qui apprennent plus vite que d’autres. Ceux qui observent tout le temps, les mouvements du bateau, la forme des nuages, ceux qui sont à l’affût du moindre changement de l’air, de la luminosité, de la température. Bref, ceux qui ne dorment que d’un œil. C’est ceux-là qui font des bons marins.
Le Unicorn avait laissé les Hébrides dans son sillage et l’on apercevait au loin l’archipel des Orcades.
— Les jeunes, vous allez pouvoir discuter avec les gens, dans ce coin-là, dit Brian. Ils parlent presque la même langue que vous !
Les Orcades et les Shetland n’étaient passées sous domination écossaise qu’une quinzaine d’années auparavant. Alors qu’elles étaient de culture nordique depuis des siècles, elles avaient été offertes en dot par l’ancien roi du Danemark Christian Ier, pour le mariage de sa fille Margrethe avec le roi d’Écosse James III.
Parce qu’il voulait longer la terre de ses ancêtres, Brian choisit d’emprunter le détroit de Pentland, entre les Orcades et l’Écosse. Le voilier y fut entraîné par un courant si terrible que la mer faisait d’énormes tourbillons, que les vagues ricochaient les unes contre les autres, que la barre ne répondait plus guère aux gesticulations de Thorkell, qui pâlissait autant que sa peau claire le lui permettait. Brian sourit en considérant les longs bras de son timonier, qui s’agitaient de manière aussi désordonnée que le faisait la mer.
— C’est le plus fort courant que je connaisse, affirma-t-il. Regardez ça, à quelle vitesse la terre défile ! Évidemment, le passage est pas possible par mauvais temps. Quand le vent vient contre le courant, ça lève un de ces clapots, ça déferle dans tous les sens ! Aujourd’hui, ça va, c’est plutôt calme.
Thorkell soupira et hocha la tête en signe d’incrédulité. Brian poursuivit :
— À bâbord, ce sont les Orcades. Et à tribord, le Caithness en Écosse. Les rois ont toujours eu du mal à tenir les clans qui dominent ce coin-là. Mon père a quitté le pays parce qu’il avait eu des ennuis avec un de leurs chefs.
Décidément, Brian était bien plus loquace en mer qu’à terre. Cependant, il pouvait se fermer comme une huître. Il s’accouda au bastingage et observa longuement la côte écossaise. Personne ne songea à le déranger. Bientôt la mer s’apaisa : le passage difficile était dans leur sillage. Brian sortit de sa torpeur et l’on remit le cap au nord. Il se félicita des conditions rencontrées. “Belle mer et bon vent”, répétait-il. »
La « saga des groenlandais » (p. 288-292)
Des runes éloquentes (p. 463-468)
Extrait court
« Les hommes savaient que lorsqu’on poursuivait un dessein exigeant, tout le reste devait s’effacer, sous peine de risquer l’échec. C’était ingrat et exaltant. Quitte à sacrifier des amitiés, des amours, ils devaient suivre leur destin sans compromission.
La vision du corps d’Alice se serrant contre le sien hantait souvent les nuits de Jón. Il savait qu’il ne la reverrait plus. Il savait aussi qu’il toucherait à d’autres femmes, c’était en tout cas ce que lui prédisait Thorkell. En attendant, il fixait l’image de la jeune Anglaise dans ses pensées, depuis ses mèches blondes jusqu’à ses pieds fins, redessinant une boucle, s’attardant sur une courbe. Toutefois, la perception de sensations plus fines s’estompait malgré lui : son parfum, le goût de ses lèvres. Alice commençait à lui échapper, à devenir plus diffuse. Cela l’irritait et le soulageait à la fois.
Durant ses quarts, il n’y pensait jamais. Ce jour-là, Brian lui enseigna ce qu’était la navigation à l’estime. Lorsqu’on s’éloignait des repères qu’offrait la terre, il fallait évaluer continuellement son cap et sa vitesse afin d’en déduire la route suivie. Depuis l’archipel des Shetland jusqu’en Islande, c’était la pleine mer et il faudrait naviguer à l’estime. Brian lui apprit comment certains capitaines mesuraient la vitesse de leur bateau. Il dit à Jón d’aller à la proue et de lancer une vieille planche par-dessus bord, le long du flanc du navire. Il se posta lui-même à la poupe. Lorsque le morceau de bois fut lancé, il le scruta attentivement à la surface de l’eau, puis leva le bras quand il passa devant lui. Il déclara, énigmatique :
— Le problème, c’est qu’on n’a pas de sablier à bord.
Comme l’apprenti matelot restait interdit, Brian expliqua que si on mesurait le temps que la planche avait mis pour aller de la proue à la poupe, et si on connaissait la distance entre ces deux extrémités, on pouvait en déduire la vitesse du bateau. Jón resta un moment à regarder la mer, puis s’empara d’un bout de bois et le lança dans la vague d’étrave. Sur toute sa longueur, la coque glissa le long du bâton. Il commençait à comprendre.
— Comment on va faire, sans sablier, en pleine mer ?
Depuis longtemps, Brian savait estimer la vitesse des bateaux sans sablier, au défilement des vagues, à l’angle de gîte, au chuintement de l’étrave, aux marques du sillage. Il répondit :
— On essaiera d’en trouver un aux Shetland.
— Donc, l’aiguille et la pierre d’aimant pour le cap, la planche et le sablier pour la vitesse. Et l’estime est faite ! déclara Jón, ravi.
— C’est pas si simple, tempéra Brian. N’oublie jamais la règle de base : il faut toujours rester humble devant la mer. Il n’y a pas de sablier ou d’aiguille qui sache donner la force et la direction des courants. Faut savoir se passer des instruments. Je me souviens, j’ai navigué une fois en mer du Nord sur un bateau marchand, sous les ordres d’un espèce de jeune blanc-bec, un fils d’armateur. Le ciel était couvert, on pouvait pas voir l’étoile-guide. Et le capitaine ne trouvait plus son chemin, parce qu’il avait perdu sa pierre d’aimant. Mais le vieux timonier, lui, n’avait pas besoin de consignes pour ramener le bateau. Il connaissait la houle, les nuages, les oiseaux de mer, les algues flottantes, tout ça.
Ce n’était guère encourageant. L’apprentissage de la navigation requérait-il donc de si longues années ? Brian sourit en avisant la mine déconfite de son élève.
— Il y en a qui apprennent plus vite que d’autres. Ceux qui observent tout le temps, les mouvements du bateau, la forme des nuages, ceux qui sont à l’affût du moindre changement de l’air, de la luminosité, de la température. Bref, ceux qui ne dorment que d’un œil. C’est ceux-là qui font des bons marins.
Le Unicorn avait laissé les Hébrides dans son sillage et l’on apercevait au loin l’archipel des Orcades.
— Les jeunes, vous allez pouvoir discuter avec les gens, dans ce coin-là, dit Brian. Ils parlent presque la même langue que vous !
Les Orcades et les Shetland n’étaient passées sous domination écossaise qu’une quinzaine d’années auparavant. Alors qu’elles étaient de culture nordique depuis des siècles, elles avaient été offertes en dot par l’ancien roi du Danemark Christian Ier, pour le mariage de sa fille Margrethe avec le roi d’Écosse James III.
Parce qu’il voulait longer la terre de ses ancêtres, Brian choisit d’emprunter le détroit de Pentland, entre les Orcades et l’Écosse. Le voilier y fut entraîné par un courant si terrible que la mer faisait d’énormes tourbillons, que les vagues ricochaient les unes contre les autres, que la barre ne répondait plus guère aux gesticulations de Thorkell, qui pâlissait autant que sa peau claire le lui permettait. Brian sourit en considérant les longs bras de son timonier, qui s’agitaient de manière aussi désordonnée que le faisait la mer.
— C’est le plus fort courant que je connaisse, affirma-t-il. Regardez ça, à quelle vitesse la terre défile ! Évidemment, le passage est pas possible par mauvais temps. Quand le vent vient contre le courant, ça lève un de ces clapots, ça déferle dans tous les sens ! Aujourd’hui, ça va, c’est plutôt calme.
Thorkell soupira et hocha la tête en signe d’incrédulité. Brian poursuivit :
— À bâbord, ce sont les Orcades. Et à tribord, le Caithness en Écosse. Les rois ont toujours eu du mal à tenir les clans qui dominent ce coin-là. Mon père a quitté le pays parce qu’il avait eu des ennuis avec un de leurs chefs.
Décidément, Brian était bien plus loquace en mer qu’à terre. Cependant, il pouvait se fermer comme une huître. Il s’accouda au bastingage et observa longuement la côte écossaise. Personne ne songea à le déranger. Bientôt la mer s’apaisa : le passage difficile était dans leur sillage. Brian sortit de sa torpeur et l’on remit le cap au nord. Il se félicita des conditions rencontrées. “Belle mer et bon vent”, répétait-il. »
(p. 133-137)
La « saga des groenlandais » (p. 288-292)
Des runes éloquentes (p. 463-468)
Extrait court


