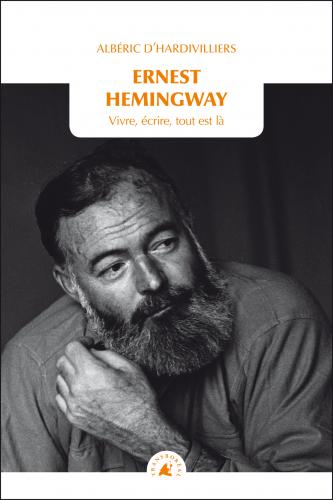
Un Paris littéraire :
« Les premiers mois à Paris sont pour Ernest une période heureuse, excitante même. Les portes s’ouvrent une à une devant lui : il a rencontré en moins de six mois tous les plus grands auteurs présents dans la capitale et, pour le moment, tout se passe bien avec Hadley. À Paris, Ernest renoue aussi avec une ancienne passion, laissée de côté depuis San Siro : les chevaux. Avec l’application qu’il met dans toute chose, il devient vite un habitué et un spécialiste des champs de courses. Il est même, à l’époque, le seul étranger à avoir accès aux entraînements, avantage non négligeable lorsqu’il s’agit de parier. Car Ernest est bien plus qu’un spectateur, c’est un joueur, même si, en esthète, il apprécie le spectacle : “Tout est si beau dans cette lumière bruineuse. Degas aurait pu peindre cette scène et rendre cette lumière de telle façon qu’elle aurait été encore plus vraie sur la toile que celle que nous voyons en ce moment, dira-t-il en 1950 à Hotchner avec qui il séjourne à Paris. Voilà quel doit être le rôle de l’artiste. Il faut que sur une toile, ou sur une page imprimée, il capture la chose avec une telle vérité que son exaltation se perpétue dans son œuvre.” Il est étonnant de constater que, trente plus tard, les préoccupations littéraires d’Ernest restent les mêmes : vérité, honnêteté, sincérité. Tout est littérature, même les courses. Pour l’heure, cependant, Ernest n’y va pas chercher l’inspiration. C’est d’argent dont il a besoin. Il joue, gagne parfois de quoi vivre six ou huit mois, mais perd aussi sans doute, et plus de temps que d’argent. Car la grande affaire d’Ernest reste encore et toujours la littérature. Écrire, se battre avec les mots, apprendre le métier, devenir, enfin, un écrivain.
Derrière cette vie apparemment insouciante, Ernest vit dans l’angoisse de ne pas devenir le grand homme qu’il se sent être au fond de lui-même. Et pour cela, une seule solution, le travail, encore. “Rien ne lui vient facilement, écrit Dorothy Parker, la scénariste. Il se bat, pose un mot, le barre et recommence. [?] Il est d’un courage absolu.” Sueur, chance, courage, comme sur un ring, Ernest n’abandonne pas le combat si facilement. Voilà sans doute ce qui le différencie de la bohème américaine qui, en quelques années, a envahi Paris. Dans un article pour le Toronto Star, daté du 25 mars 1922, Hemingway n’a pas de mots assez durs pour qualifier les faiseurs qui encombrent le boulevard Montparnasse : “La fange de Greenwich Village a été écumée et déversée sur ce secteur de Paris attenant au café de la Rotonde. [?] C’est une race aux comportements étranges et aux allures étranges. [?] Ils se sont tous donné tant de mal pour obtenir un individualisme débraillé dans leurs vêtements qu’ils sont parvenus à une espèce d’uniformité dans l’excentricité. [?] Ce sont presque tous des fainéants dépensant l’énergie que met un artiste dans son œuvre créatrice à parler de ce qu’ils vont faire et à condamner l’œuvre de tous les artistes qui ont atteint quelque degré de notoriété.” Pas de Rotonde alors, ni de Select pour Ernest. Il est impensable pour lui d’être un tant soit peu comparé à ce groupe de gens qui profitent de la vie sans la respecter ni travailler. Il n’y a pour Hemingway qu’un seul mot d’ordre : écrire. »
L’Espagne, le soleil et le sang (p. 88-91)
Conclusion – Un homme à la hauteur (p. 161-163)
Extrait court
« Les premiers mois à Paris sont pour Ernest une période heureuse, excitante même. Les portes s’ouvrent une à une devant lui : il a rencontré en moins de six mois tous les plus grands auteurs présents dans la capitale et, pour le moment, tout se passe bien avec Hadley. À Paris, Ernest renoue aussi avec une ancienne passion, laissée de côté depuis San Siro : les chevaux. Avec l’application qu’il met dans toute chose, il devient vite un habitué et un spécialiste des champs de courses. Il est même, à l’époque, le seul étranger à avoir accès aux entraînements, avantage non négligeable lorsqu’il s’agit de parier. Car Ernest est bien plus qu’un spectateur, c’est un joueur, même si, en esthète, il apprécie le spectacle : “Tout est si beau dans cette lumière bruineuse. Degas aurait pu peindre cette scène et rendre cette lumière de telle façon qu’elle aurait été encore plus vraie sur la toile que celle que nous voyons en ce moment, dira-t-il en 1950 à Hotchner avec qui il séjourne à Paris. Voilà quel doit être le rôle de l’artiste. Il faut que sur une toile, ou sur une page imprimée, il capture la chose avec une telle vérité que son exaltation se perpétue dans son œuvre.” Il est étonnant de constater que, trente plus tard, les préoccupations littéraires d’Ernest restent les mêmes : vérité, honnêteté, sincérité. Tout est littérature, même les courses. Pour l’heure, cependant, Ernest n’y va pas chercher l’inspiration. C’est d’argent dont il a besoin. Il joue, gagne parfois de quoi vivre six ou huit mois, mais perd aussi sans doute, et plus de temps que d’argent. Car la grande affaire d’Ernest reste encore et toujours la littérature. Écrire, se battre avec les mots, apprendre le métier, devenir, enfin, un écrivain.
Derrière cette vie apparemment insouciante, Ernest vit dans l’angoisse de ne pas devenir le grand homme qu’il se sent être au fond de lui-même. Et pour cela, une seule solution, le travail, encore. “Rien ne lui vient facilement, écrit Dorothy Parker, la scénariste. Il se bat, pose un mot, le barre et recommence. [?] Il est d’un courage absolu.” Sueur, chance, courage, comme sur un ring, Ernest n’abandonne pas le combat si facilement. Voilà sans doute ce qui le différencie de la bohème américaine qui, en quelques années, a envahi Paris. Dans un article pour le Toronto Star, daté du 25 mars 1922, Hemingway n’a pas de mots assez durs pour qualifier les faiseurs qui encombrent le boulevard Montparnasse : “La fange de Greenwich Village a été écumée et déversée sur ce secteur de Paris attenant au café de la Rotonde. [?] C’est une race aux comportements étranges et aux allures étranges. [?] Ils se sont tous donné tant de mal pour obtenir un individualisme débraillé dans leurs vêtements qu’ils sont parvenus à une espèce d’uniformité dans l’excentricité. [?] Ce sont presque tous des fainéants dépensant l’énergie que met un artiste dans son œuvre créatrice à parler de ce qu’ils vont faire et à condamner l’œuvre de tous les artistes qui ont atteint quelque degré de notoriété.” Pas de Rotonde alors, ni de Select pour Ernest. Il est impensable pour lui d’être un tant soit peu comparé à ce groupe de gens qui profitent de la vie sans la respecter ni travailler. Il n’y a pour Hemingway qu’un seul mot d’ordre : écrire. »
(p. 51-53)
L’Espagne, le soleil et le sang (p. 88-91)
Conclusion – Un homme à la hauteur (p. 161-163)
Extrait court


