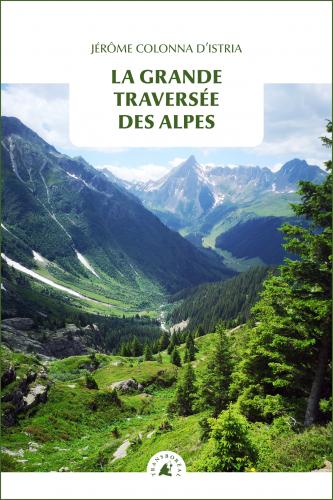
De Roure aux Granges de la Brasque :
« Je quitte tranquillement les derniÃĻres habitations du bourg pour m’engouffrer dans les vallons de la forÊt de Valdeblore. L’orage menace clairement, et l’endroit oÃđ je vais est trÃĻs exposÃĐ. Je dÃĐcide de poursuivre en direction du CaÃŊre Gros, sorte de promontoire arrondi surplombant d’environ 700 mÃĻtres le village que je viens de quitter, et j’anticipe de faire demi-tour par le fond des vallons si les ÃĐclairs arrivent. Il est 15 heures, toujours pas de pluie, peut Être le cumulonimbus va-t-il se vider et cracher sa rage plus loin ? Peut-Être ne vais-je pas Être obligÃĐ de rebrousser chemin. Je prolonge un peu le dÃĐfi, j’ose la provocation. Le sentier contourne le dÃīme du CaÃŊre Gros par le nord à flanc de coteau dans la forÊt et remonte par de petits lacets vers le col des Deux-CaÃŊres. De là-haut, je sais que je verrai plus clair sur la suite, la vue y sera dÃĐgagÃĐe, et j’ai repÃĐrÃĐ sur la carte un abri au besoin, dans une construction militaire. Je sais que ces casemates fortifiÃĐes ne protÃĻgent pas forcÃĐment de la foudre en cas d’orage mais elles constituent au moins un auvent pour la pluie.
J’ai croisÃĐ des Marseillais dans la courte remontÃĐe vers ce fameux col. J’ai entendu de loin leurs clameurs qui perturbaient le silence de la forÊt. Je les ai rejoints juste avant la fin de l’ascension. Tout un groupe, au moins quinze personnes, avec des ÃĒnes et des enfants qui hurlent. Les adultes, eux, peinent à grimper. Je n’ai pas envie de rester, pas le cœur à la discussion. Alors en arrivant au point culminant de la crÊte entre les deux CaÃŊres, je ne jette qu’un regard furtif vers le ciel, et j’avance sans me poser de question, sans me retourner. Je n’ai ÃĐcoutÃĐ que ma stupide misanthropie. Ce que je dÃĐsire par-dessus tout, à ce moment prÃĐcis, c’est fuir le bruit des gens et replonger dans le monde des montagnes sauvages. Qu’importe l’orage, pourvu que je sois seul. Je n’irai pas à l’abri militaire, j’ai eu peur du groupe, peur de me sentir ÃĐtranger. Peur des hommes.
On est toujours le con d’un autre ; là, j’ai ÃĐtÃĐ le con de moi-mÊme. J’ai sacrifiÃĐ toute la sÃĐcuritÃĐ ÃĐlÃĐmentaire du montagnard averti à mon ÃĐgoÃŊsme crÃĐtin. Je m’ÃĐlance à toute vitesse, en fuyant, tÊte baissÃĐe, comme l’enfant qui dit non, sur l’arÊte exposÃĐe du mont Chalancha et de la Partissuollo. La bÊtise, c’est terrible, c’est elle qui nous met en danger. Et alors que je progresse sur ces cimes dÃĐgagÃĐes, ce qui devait arriver finit par arriver. L’atmosphÃĻre se charge rapidement, le vent fulgurant de la dÃĐpression se met à claquer dans mes oreilles, j’entends bourdonner les abeilles, celles qui annoncent la frappe de la foudre. Dans l’instant, une dÃĐtonation sourde a explosÃĐ dans le ciel bousculÃĐ, comme un coup de canon qui soulÃĻve la poitrine et fait vibrer tout le corps. Je n’ai mÊme pas eu le temps de voir l’ÃĐclair. Et la pluie gelÃĐe s’est mise à tomber de toute part, comme si elle venait du sol mÊme. Puis les crÃĐpitements incessants et le vacarme du tonnerre qui tapait partout à la fois. Je suis au beau milieu de l’orage, au cœur de la tempÊte. C’est effrayant et beau à la fois, comme les marins de l’AntiquitÃĐ entendant les sirÃĻnes. Alors je me suis recroquevillÃĐ sur moi-mÊme, sur mon sac – c’est le meilleur moyen de ne pas prendre la foudre, paraÃŪt-il –, et j’ai patiemment attendu que tout se calme. Mon grand-pÃĻre, qui ÃĐtait aussi mÃĐdecin, avait dÃĐveloppÃĐ au cours de sa carriÃĻre toute une dialectique pour adoucir certains moments douloureux qu’allaient vivre ses patients. Par exemple, pour l’annonce d’un cancer, il ne parlait pas de maladie “grave” mais de situation “sÃĐrieuse”, comme si le choix de certains mots pouvait presque inconsciemment mieux faire passer la pilule. Alors je me suis dit que mon cas à moi, là, sur mon petit ÃŪlot de solitude en forme d’arÊte dÃĐnudÃĐe, ÃĐtait “sÃĐrieux”, et d’un coup je me suis aussi mis à aller mieux. J’ai pensÃĐ à ma mort. À force de cÃītoyer celle des autres, j’y pense souvent, en fait, à ma mort.
C’est le clapotis de la pluie sur les ÃĐpaules et le petit ruissellement gelÃĐ dans le bas du dos qui m’ont rÃĐveillÃĐ. Quand je rouvre les yeux, l’orage s’est ÃĐloignÃĐ, il est allÃĐ effrayer d’autres montagnards. Je perçois la clameur du tonnerre au loin dÃĐsormais. Je n’entends que le son de l’eau qui perle sur la montagne, le vent furieux a cessÃĐ. Je n’ÃĐtais pas tombÃĐ au champ des fleurs. J’ai dormi ainsi presque deux heures, en boule, sur mon sac.
J’ai l’air un peu stupide, un peu bÊta, comme le gamin qui vient de recevoir une grosse fessÃĐe aprÃĻs une bÊtise. J’ai l’impression que tous les animaux me regardent, me jugent. “HÃĐ ! oh ! c’est bon, quoi. Ãa ne vous est jamais arrivÃĐ à vous, de faire une connerie ?” Alors je me remets en route, la queue entre les jambes. J’ai besoin de me stimuler, me rÃĐchauffer l’ardeur. »
De SamoÃŦns au col d’Anterne (p. 52-54)
De Briançon à Arvieux (p. 136-139)
Extrait court
« Je quitte tranquillement les derniÃĻres habitations du bourg pour m’engouffrer dans les vallons de la forÊt de Valdeblore. L’orage menace clairement, et l’endroit oÃđ je vais est trÃĻs exposÃĐ. Je dÃĐcide de poursuivre en direction du CaÃŊre Gros, sorte de promontoire arrondi surplombant d’environ 700 mÃĻtres le village que je viens de quitter, et j’anticipe de faire demi-tour par le fond des vallons si les ÃĐclairs arrivent. Il est 15 heures, toujours pas de pluie, peut Être le cumulonimbus va-t-il se vider et cracher sa rage plus loin ? Peut-Être ne vais-je pas Être obligÃĐ de rebrousser chemin. Je prolonge un peu le dÃĐfi, j’ose la provocation. Le sentier contourne le dÃīme du CaÃŊre Gros par le nord à flanc de coteau dans la forÊt et remonte par de petits lacets vers le col des Deux-CaÃŊres. De là-haut, je sais que je verrai plus clair sur la suite, la vue y sera dÃĐgagÃĐe, et j’ai repÃĐrÃĐ sur la carte un abri au besoin, dans une construction militaire. Je sais que ces casemates fortifiÃĐes ne protÃĻgent pas forcÃĐment de la foudre en cas d’orage mais elles constituent au moins un auvent pour la pluie.
J’ai croisÃĐ des Marseillais dans la courte remontÃĐe vers ce fameux col. J’ai entendu de loin leurs clameurs qui perturbaient le silence de la forÊt. Je les ai rejoints juste avant la fin de l’ascension. Tout un groupe, au moins quinze personnes, avec des ÃĒnes et des enfants qui hurlent. Les adultes, eux, peinent à grimper. Je n’ai pas envie de rester, pas le cœur à la discussion. Alors en arrivant au point culminant de la crÊte entre les deux CaÃŊres, je ne jette qu’un regard furtif vers le ciel, et j’avance sans me poser de question, sans me retourner. Je n’ai ÃĐcoutÃĐ que ma stupide misanthropie. Ce que je dÃĐsire par-dessus tout, à ce moment prÃĐcis, c’est fuir le bruit des gens et replonger dans le monde des montagnes sauvages. Qu’importe l’orage, pourvu que je sois seul. Je n’irai pas à l’abri militaire, j’ai eu peur du groupe, peur de me sentir ÃĐtranger. Peur des hommes.
On est toujours le con d’un autre ; là, j’ai ÃĐtÃĐ le con de moi-mÊme. J’ai sacrifiÃĐ toute la sÃĐcuritÃĐ ÃĐlÃĐmentaire du montagnard averti à mon ÃĐgoÃŊsme crÃĐtin. Je m’ÃĐlance à toute vitesse, en fuyant, tÊte baissÃĐe, comme l’enfant qui dit non, sur l’arÊte exposÃĐe du mont Chalancha et de la Partissuollo. La bÊtise, c’est terrible, c’est elle qui nous met en danger. Et alors que je progresse sur ces cimes dÃĐgagÃĐes, ce qui devait arriver finit par arriver. L’atmosphÃĻre se charge rapidement, le vent fulgurant de la dÃĐpression se met à claquer dans mes oreilles, j’entends bourdonner les abeilles, celles qui annoncent la frappe de la foudre. Dans l’instant, une dÃĐtonation sourde a explosÃĐ dans le ciel bousculÃĐ, comme un coup de canon qui soulÃĻve la poitrine et fait vibrer tout le corps. Je n’ai mÊme pas eu le temps de voir l’ÃĐclair. Et la pluie gelÃĐe s’est mise à tomber de toute part, comme si elle venait du sol mÊme. Puis les crÃĐpitements incessants et le vacarme du tonnerre qui tapait partout à la fois. Je suis au beau milieu de l’orage, au cœur de la tempÊte. C’est effrayant et beau à la fois, comme les marins de l’AntiquitÃĐ entendant les sirÃĻnes. Alors je me suis recroquevillÃĐ sur moi-mÊme, sur mon sac – c’est le meilleur moyen de ne pas prendre la foudre, paraÃŪt-il –, et j’ai patiemment attendu que tout se calme. Mon grand-pÃĻre, qui ÃĐtait aussi mÃĐdecin, avait dÃĐveloppÃĐ au cours de sa carriÃĻre toute une dialectique pour adoucir certains moments douloureux qu’allaient vivre ses patients. Par exemple, pour l’annonce d’un cancer, il ne parlait pas de maladie “grave” mais de situation “sÃĐrieuse”, comme si le choix de certains mots pouvait presque inconsciemment mieux faire passer la pilule. Alors je me suis dit que mon cas à moi, là, sur mon petit ÃŪlot de solitude en forme d’arÊte dÃĐnudÃĐe, ÃĐtait “sÃĐrieux”, et d’un coup je me suis aussi mis à aller mieux. J’ai pensÃĐ à ma mort. À force de cÃītoyer celle des autres, j’y pense souvent, en fait, à ma mort.
C’est le clapotis de la pluie sur les ÃĐpaules et le petit ruissellement gelÃĐ dans le bas du dos qui m’ont rÃĐveillÃĐ. Quand je rouvre les yeux, l’orage s’est ÃĐloignÃĐ, il est allÃĐ effrayer d’autres montagnards. Je perçois la clameur du tonnerre au loin dÃĐsormais. Je n’entends que le son de l’eau qui perle sur la montagne, le vent furieux a cessÃĐ. Je n’ÃĐtais pas tombÃĐ au champ des fleurs. J’ai dormi ainsi presque deux heures, en boule, sur mon sac.
J’ai l’air un peu stupide, un peu bÊta, comme le gamin qui vient de recevoir une grosse fessÃĐe aprÃĻs une bÊtise. J’ai l’impression que tous les animaux me regardent, me jugent. “HÃĐ ! oh ! c’est bon, quoi. Ãa ne vous est jamais arrivÃĐ à vous, de faire une connerie ?” Alors je me remets en route, la queue entre les jambes. J’ai besoin de me stimuler, me rÃĐchauffer l’ardeur. »
(p. 207-210)
De SamoÃŦns au col d’Anterne (p. 52-54)
De Briançon à Arvieux (p. 136-139)
Extrait court


