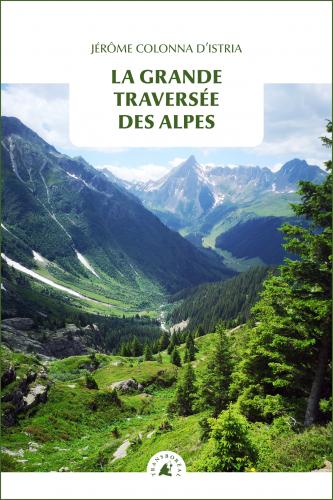
De Briançon à Arvieux :
« Et alors que je suis accroupi à observer à la loupe cette bizarrerie, alors que je me trouve dans ce bois à l’écart du monde depuis plusieurs heures, dans un isolement savamment orchestré, alors que personne ne devrait pénétrer dans ce huis clos sartrien, j’entends un bruissement de feuillage à quelques mètres derrière moi. Je me retourne rapidement, discrètement, non par peur, pas du tout, mais j’ai toujours à l’esprit l’espoir d’une rencontre, d’un tête-à-tête animal, comme la fois où je courais dans les bois des Houches sur le sentier à l’écart de la vallée et que j’étais tombé nez à mufle avec un grand cerf, un beau mâle, un huit cors. On s’était toisés quelques secondes, fixés un court moment, et il était parti dans un grand bruit de galop. Moment magique. À cet instant, je vois surgir de la pente, haletant, un homme. Il est seul, il n’a pas de sac, pas d’affaires avec lui. Il est très imposant, un physique d’ursidé suant. Il s’arrête, on se regarde. Je le dévisage, pas par crainte non plus ou par quelconque méfiance, mais par souci d’entraide, presque par conscience professionnelle. Peut-être est-il blessé ? Peut-être un criminel évadé ? Un ermite qui vit dans les parages et qui revoit son premier homme depuis des années ? Un doux psychotique échappé d’un asile, dont on recherche la trace éperdument ? Toutes les options me vont, pourvu qu’elles pimentent la vie. Il est habillé d’un T-shirt gris sale, trop petit, tout déchiré au col et aux basques, taché d’auréoles de transpiration qui lui moulent le torse. Un short manifestement trop serré aussi laisse dépasser une copieuse bedaine. Ses mollets éclatent hors de chaussettes toutes filées et il marche dans des espèces de chaussures crevées de toute part, complètement inadaptées à ces pentes abruptes. Son visage est rond, gras, les cheveux plaqués en bataille, trempés, tombant sur sa face mafflue, ruisselante, lunaire et pâle. Une courte barbe de quelques jours tapisse ses joues et son double menton, maculés aussi de traces de boue et de salissures forestières.
— Bonjour, M’sieur !
Ce bref salut m’arrache à ma penaude solitude florale comme si, naufragé solitaire dormant sur la plage de sable blanc d’un atoll perdu du Pacifique, j’étais soudainement réveillé par un seau d’eau jeté en pleine figure.
— Bonjour, Monsieur.
Sa voix est curieusement en inadéquation avec son physique : elle est aiguë, fluette. Un silence de quelques secondes flotte dans l’air, sans que nous n’en ressentions ni l’un ni l’autre la moindre pesanteur. Puis la météorologie, toujours, comme sujet universel de conversation.
— Fait chaud, hein ?
— Ouais.
Il ajoute.
— On croise pas grand monde dans le coin. Qu’est-ce que vous faites donc par là ?
Lui me vouvoie. On n’est pas de la même communauté tous les deux. On conserve les règles de la civilisation, dont je me rends compte qu’elles gagnent même le fond des pentes perdues du vallon des Ayes.
— Oh, moi, je me promène. Je vais à Arvieux ce soir.
— Arvieux !? Vin diou ! Arvieux !? Mais c’est loin ça !? Mais vous dormez où ?
Il ne s’en remet pas. Arvieux est le village en contrebas du col des Ayes. J’en ai encore bien pour quatre à cinq heures de route. Mais on est dans des mondes différents, lui et moi. Je suis un arpenteur de montagnes, un rêveur des cimes, lui fait partie intégrante du rêve, c’est un berger, il garde ses vaches. Il est venu d’en bas pour planter des barrières.
— Ch’uis venu fermer là-bas. J’ai monté le troupeau c’tantôt.
Et, dans une sorte de candeur journalistique, je le questionne un peu. Dans ces approches très concrètes du monde, on convoque parfois les plus grandes sagesses. De la simplicité rustique naît souvent le bon sens le plus abouti.
— Vous êtes bien vous, ici, avec vos vaches ? Ce n’est pas trop dur, tout seul au milieu de vos montagnes ?
— Ah, ben oui ! Hein, moi je me pose pas la question hein. Ch’uis bien. On est mieux que dans la vallée. On est au bon air, hein. Toute l’année. Moi je dis toujours, y a ceux de la France d’en bas, et nous, on est la France d’en haut !
Et voici que, dévoilant toutes ses dents mal agencées, ponctuées çà et là de quelques chicots instables et jaunis, il éclate dans un grand rire qui résonne dans tout le vallon. On sent qu’il transporte partout son trait d’esprit bien trouvé, son calembour qui fait sienne la fameuse formule politique de Jean-Pierre Raffarin. Avec son autodérision, son détournement des mots, lui, le berger en haillons, tout dépenaillé comme ça, il m’a plu. Lui, c’est la France qui domine, la France d’en haut, la France des montagnes.
Je quitte ce bois avec l’étrange sensation d’avoir serré dans mes bras la montagne tout entière. »
De Samoëns au col d’Anterne (p. 52-54)
De Roure aux Granges de la Brasque (p. 207-210)
Extrait court
« Et alors que je suis accroupi à observer à la loupe cette bizarrerie, alors que je me trouve dans ce bois à l’écart du monde depuis plusieurs heures, dans un isolement savamment orchestré, alors que personne ne devrait pénétrer dans ce huis clos sartrien, j’entends un bruissement de feuillage à quelques mètres derrière moi. Je me retourne rapidement, discrètement, non par peur, pas du tout, mais j’ai toujours à l’esprit l’espoir d’une rencontre, d’un tête-à-tête animal, comme la fois où je courais dans les bois des Houches sur le sentier à l’écart de la vallée et que j’étais tombé nez à mufle avec un grand cerf, un beau mâle, un huit cors. On s’était toisés quelques secondes, fixés un court moment, et il était parti dans un grand bruit de galop. Moment magique. À cet instant, je vois surgir de la pente, haletant, un homme. Il est seul, il n’a pas de sac, pas d’affaires avec lui. Il est très imposant, un physique d’ursidé suant. Il s’arrête, on se regarde. Je le dévisage, pas par crainte non plus ou par quelconque méfiance, mais par souci d’entraide, presque par conscience professionnelle. Peut-être est-il blessé ? Peut-être un criminel évadé ? Un ermite qui vit dans les parages et qui revoit son premier homme depuis des années ? Un doux psychotique échappé d’un asile, dont on recherche la trace éperdument ? Toutes les options me vont, pourvu qu’elles pimentent la vie. Il est habillé d’un T-shirt gris sale, trop petit, tout déchiré au col et aux basques, taché d’auréoles de transpiration qui lui moulent le torse. Un short manifestement trop serré aussi laisse dépasser une copieuse bedaine. Ses mollets éclatent hors de chaussettes toutes filées et il marche dans des espèces de chaussures crevées de toute part, complètement inadaptées à ces pentes abruptes. Son visage est rond, gras, les cheveux plaqués en bataille, trempés, tombant sur sa face mafflue, ruisselante, lunaire et pâle. Une courte barbe de quelques jours tapisse ses joues et son double menton, maculés aussi de traces de boue et de salissures forestières.
— Bonjour, M’sieur !
Ce bref salut m’arrache à ma penaude solitude florale comme si, naufragé solitaire dormant sur la plage de sable blanc d’un atoll perdu du Pacifique, j’étais soudainement réveillé par un seau d’eau jeté en pleine figure.
— Bonjour, Monsieur.
Sa voix est curieusement en inadéquation avec son physique : elle est aiguë, fluette. Un silence de quelques secondes flotte dans l’air, sans que nous n’en ressentions ni l’un ni l’autre la moindre pesanteur. Puis la météorologie, toujours, comme sujet universel de conversation.
— Fait chaud, hein ?
— Ouais.
Il ajoute.
— On croise pas grand monde dans le coin. Qu’est-ce que vous faites donc par là ?
Lui me vouvoie. On n’est pas de la même communauté tous les deux. On conserve les règles de la civilisation, dont je me rends compte qu’elles gagnent même le fond des pentes perdues du vallon des Ayes.
— Oh, moi, je me promène. Je vais à Arvieux ce soir.
— Arvieux !? Vin diou ! Arvieux !? Mais c’est loin ça !? Mais vous dormez où ?
Il ne s’en remet pas. Arvieux est le village en contrebas du col des Ayes. J’en ai encore bien pour quatre à cinq heures de route. Mais on est dans des mondes différents, lui et moi. Je suis un arpenteur de montagnes, un rêveur des cimes, lui fait partie intégrante du rêve, c’est un berger, il garde ses vaches. Il est venu d’en bas pour planter des barrières.
— Ch’uis venu fermer là-bas. J’ai monté le troupeau c’tantôt.
Et, dans une sorte de candeur journalistique, je le questionne un peu. Dans ces approches très concrètes du monde, on convoque parfois les plus grandes sagesses. De la simplicité rustique naît souvent le bon sens le plus abouti.
— Vous êtes bien vous, ici, avec vos vaches ? Ce n’est pas trop dur, tout seul au milieu de vos montagnes ?
— Ah, ben oui ! Hein, moi je me pose pas la question hein. Ch’uis bien. On est mieux que dans la vallée. On est au bon air, hein. Toute l’année. Moi je dis toujours, y a ceux de la France d’en bas, et nous, on est la France d’en haut !
Et voici que, dévoilant toutes ses dents mal agencées, ponctuées çà et là de quelques chicots instables et jaunis, il éclate dans un grand rire qui résonne dans tout le vallon. On sent qu’il transporte partout son trait d’esprit bien trouvé, son calembour qui fait sienne la fameuse formule politique de Jean-Pierre Raffarin. Avec son autodérision, son détournement des mots, lui, le berger en haillons, tout dépenaillé comme ça, il m’a plu. Lui, c’est la France qui domine, la France d’en haut, la France des montagnes.
Je quitte ce bois avec l’étrange sensation d’avoir serré dans mes bras la montagne tout entière. »
(p. 136-139)
De Samoëns au col d’Anterne (p. 52-54)
De Roure aux Granges de la Brasque (p. 207-210)
Extrait court


