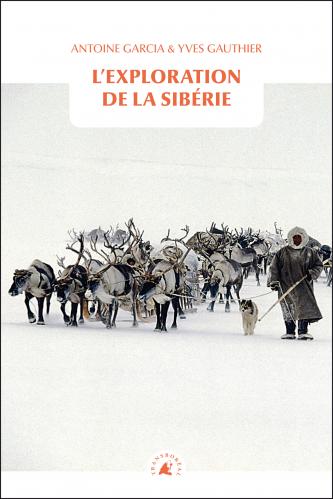
À l’école de Dersou (Arséniev) :
« “L’ami et le frère” des aborigènes est le premier sibériologue à s’essayer à l’expression cinématographique. Dans les années 1920, il est le scénariste et le consultant d’un film-document, Oudè (Hommes des bois), tourné dans les profondeurs de la taïga pour immortaliser les images d’un peuple menacé de disparition (1 370 âmes à l’époque)? Une indigène oudèguée est enceinte. On la place dans une yourte isolée, la privant de contact avec l’extérieur. Seules quelques femmes lui apportent à manger, mais sans lui adresser la parole. L’enfant vient au monde. Deux années plus tard, il tète encore le sein de sa mère tout en tirant ses premières bouffées sur la pipe de son père. À 4 ans, le petit d’homme est d’un secours indispensable à la chasse. Il conduit superbement un canot taillé dans la masse d’un tronc d’arbre. Scènes de chasse, partage du travail entre les hommes et les femmes, fêtes, oraisons chamaniques, rite de la tête d’ours mangée après la chasse, tels sont les grands moments mis en scène. Le scénariste continue avec La Taïga de l’Oussouri, Toumgou, Les Éleveurs de rennes.
En 1918, Arséniev se rend au Kamtchatka. Archéologue improvisé, il y découvre les vestiges du fortin d’Atlassov sur le haut cours du fleuve Kamtchatka. Au village de Kamaki, il visite un vieux campement kamtchadale décrit en son temps par Krachéninnikov. Il rencontre aussi Roublev, ancien compagnon de voyage de Prjévalski. Atlassov-Krachéninnikov-Prjévalski : partout le voyageur reconstitue la chaîne des explorations, dont il se veut l’un des maillons. Surtout, il se réjouit de voir de si près le matin du monde. Extrait de journal : “Que le Kamtchatka est une contrée primitive ! Les habitants y utilisent encore le silex et le briquet. Chaque Kamtchadale en a toujours sur soi. On cueille l’amadouvier dans les bois, sur les bouleaux. On frotte une mèche brûlée à l’amadou. Où qu’on aille, on emporte un silex, un briquet, de l’amadou. Les allumettes peuvent manquer, s’abîmer, prendre l’humidité ; mais le silex, le briquet et l’amadou, jamais. De plus, les gens savent encore faire le feu par frottement. Un procédé auquel ils recourent continuellement, quand ils n’ont plus d’allumettes, de silex, de briquet ou d’amadou. Pour ce faire, ils utilisent une plaquette tendre de peuplier et une tige sèche de mélèze ou d’aune. Détail intéressant, leurs pièces de silex sont d’anciens racloirs [à peau] taillés et retouchés. Mais ils n’en savent rien et pensent que leurs ancêtres en faisaient le même usage.”
Arséniev vieillissant continue de trop bouger. Dans les années 1920, il explore la vallée de la Guijiga, visite les îles du Commandeur, escalade le mont Avatchinskaya, conduit une expédition de Sovietskaïa Gavan à Khabarovsk en 1927. “J’ai parcouru la distance en cent seize jours. Il m’a fallu franchir cinq cols et creuser neuf canots. Pas une âme qui vive rencontrée en chemin. Des conditions météorologiques détestables : un été de pluie, 63,3 % de journées pluvieuses. Nous avons été attaqués par un tigre?” Il en va de ses charges administratives et professionnelles comme de ses expéditions : impossibles à énumérer toutes. RGO, musées régionaux (inexistants avant lui), Société d’archéologie, comité des archives d’Extrême-Orient, Société des orientalistes, Société nationale de géographie de Washington, Université de Vladivostok, Société des randonneurs? Ses biographes applaudissent bruyamment à l’énergie bouillonnante du grand explorateur.
À tort, peut-être. Il y a en effet comme un voile d’amertume sur la dernière décennie de sa vie, d’ailleurs gâchée par une sanglante tragédie familiale : ses parents, son frère, sa belle-sœur et ses deux sœurs massacrés par des voleurs à Doubobchtchina, en Ukraine (novembre 1918). En proie à une “routine insoutenable”, il se sent privé de sa liberté d’écrire. “Il ne me reste plus guère qu’une dizaine d’années à travailler, confie-t-il à l’académicien Oldenbourg. Après, on aura beau me passer au pressoir, plus une goutte ne sortira. Je songe à quitter mes charges administratives. Je ne répugnerais pas à prendre un petit emploi de relieur d’archives, pourvu que je puisse me libérer à 3 heures de l’après-midi pour mes activités favorites qui sont le sens de ma vie?” À l’évidence, ce ne sont pas là les propos d’un homme en harmonie avec lui-même. Mais il y a d’autres signes de contrariété : “La première fois que je suis arrivé dans le pays, les environs de Vladivostok étaient couverts de forêts où couraient toutes sortes de bêtes sauvages. Il n’y avait alors ni routes ni sentes. Chaque voyage dans la taïga imposait des privations et présentait même des risques de mort. Je me revois gravissant avec peine le “mont Chauve” à la source de la rivière Sédanka. Vingt-huit ans plus tard, j’y suis retourné. J’y ai trouvé des jeunes gens, garçons et filles, venus là en automobile? Ils avaient le cœur à rire, à plaisanter. Jamais ils n’auraient pu penser que l’homme qui passait près d’eux avait été le premier à tracer le chemin jusqu’ici, une lourde besace aux épaules, les vêtements déchirés, le visage en sueur.”
Arséniev, lui, n’a pas le cœur à rire. Il voit se faner la virginité d’un pays, pour laquelle il a milité, écrit. Les gens d’ici qui le tiennent pour leur “frère” sont en train de disparaître, emportant avec eux dans le néant une culture multiséculaire de communion avec la taïga. Leurs lettres sont des cris de mourants. Les jeunes automobilistes hilares l’agacent pour l’oubli qu’ils incarnent de ce savoir-vivre ancestral. Non que notre homme – pionnier du cinéma ethnographique – boude la modernité, mais il se regimbe contre l’acculturation qu’elle entraîne et sent bien que cette bataille est perdue.
En 1930, on le charge de superviser quatre expéditions de reconnaissance en vue de la construction d’un vaste réseau ferroviaire, ambitieux chantier de développement économique de la région. “Ce sera mon chant du cygne”, devine Arséniev. Il en revient malade, en effet, et s’éteint le 4 septembre de la même année. Ultime contrariété, celui qui rêvait d’être inhumé dans la taïga connaîtra un enterrement de ville dont parle ici sa femme : “Vladimir Klavdiévitch est mort d’un arrêt du cœur le surlendemain d’un accès de pneumonie striduleuse contractée sur le cours inférieur de l’Amour lors de sa dernière expédition. La ville entière était à ses obsèques, un cortège de plusieurs milliers de personnes. Je savais qu’il était populaire et chéri de beaucoup, mais jamais je n’aurais osé croire qu’il avait tant d’amis, qu’il était apprécié et respecté de tous.” En 1952, la bourgade de Semenovka fut rebaptisée Arséniev. On peut y voir, depuis 1972, un monument à la gloire conjointe du voyageur et de son ami Dersou.
Ce tandem de l’explorateur-écrivain et du guide indigène n’est pas un cas unique dans la Sibérie du XXe siècle. Il n’est qu’à citer l’exemple moins connu du géodésien Grigori Fédosseïev (1899-1968), continuateur de la tradition arséniévienne : Pachka de la tanière aux ours, L’Esprit mauvais de Yambouï, La mort m’attendra? Dans Le Chemin de l’épreuve, l’auteur brosse le portrait d’un guide évenk nommé Ouloukitkan, incarnation de cette même culture taïguéenne. (Mort nonagénaire d’un accident de chasse, l’Évenk survivra à “son” roman.) »
Par-delà la « Grande Pierre » (p. 45-50)
En guise d’épilogue (p. 553-557)
Extrait court
« “L’ami et le frère” des aborigènes est le premier sibériologue à s’essayer à l’expression cinématographique. Dans les années 1920, il est le scénariste et le consultant d’un film-document, Oudè (Hommes des bois), tourné dans les profondeurs de la taïga pour immortaliser les images d’un peuple menacé de disparition (1 370 âmes à l’époque)? Une indigène oudèguée est enceinte. On la place dans une yourte isolée, la privant de contact avec l’extérieur. Seules quelques femmes lui apportent à manger, mais sans lui adresser la parole. L’enfant vient au monde. Deux années plus tard, il tète encore le sein de sa mère tout en tirant ses premières bouffées sur la pipe de son père. À 4 ans, le petit d’homme est d’un secours indispensable à la chasse. Il conduit superbement un canot taillé dans la masse d’un tronc d’arbre. Scènes de chasse, partage du travail entre les hommes et les femmes, fêtes, oraisons chamaniques, rite de la tête d’ours mangée après la chasse, tels sont les grands moments mis en scène. Le scénariste continue avec La Taïga de l’Oussouri, Toumgou, Les Éleveurs de rennes.
En 1918, Arséniev se rend au Kamtchatka. Archéologue improvisé, il y découvre les vestiges du fortin d’Atlassov sur le haut cours du fleuve Kamtchatka. Au village de Kamaki, il visite un vieux campement kamtchadale décrit en son temps par Krachéninnikov. Il rencontre aussi Roublev, ancien compagnon de voyage de Prjévalski. Atlassov-Krachéninnikov-Prjévalski : partout le voyageur reconstitue la chaîne des explorations, dont il se veut l’un des maillons. Surtout, il se réjouit de voir de si près le matin du monde. Extrait de journal : “Que le Kamtchatka est une contrée primitive ! Les habitants y utilisent encore le silex et le briquet. Chaque Kamtchadale en a toujours sur soi. On cueille l’amadouvier dans les bois, sur les bouleaux. On frotte une mèche brûlée à l’amadou. Où qu’on aille, on emporte un silex, un briquet, de l’amadou. Les allumettes peuvent manquer, s’abîmer, prendre l’humidité ; mais le silex, le briquet et l’amadou, jamais. De plus, les gens savent encore faire le feu par frottement. Un procédé auquel ils recourent continuellement, quand ils n’ont plus d’allumettes, de silex, de briquet ou d’amadou. Pour ce faire, ils utilisent une plaquette tendre de peuplier et une tige sèche de mélèze ou d’aune. Détail intéressant, leurs pièces de silex sont d’anciens racloirs [à peau] taillés et retouchés. Mais ils n’en savent rien et pensent que leurs ancêtres en faisaient le même usage.”
Arséniev vieillissant continue de trop bouger. Dans les années 1920, il explore la vallée de la Guijiga, visite les îles du Commandeur, escalade le mont Avatchinskaya, conduit une expédition de Sovietskaïa Gavan à Khabarovsk en 1927. “J’ai parcouru la distance en cent seize jours. Il m’a fallu franchir cinq cols et creuser neuf canots. Pas une âme qui vive rencontrée en chemin. Des conditions météorologiques détestables : un été de pluie, 63,3 % de journées pluvieuses. Nous avons été attaqués par un tigre?” Il en va de ses charges administratives et professionnelles comme de ses expéditions : impossibles à énumérer toutes. RGO, musées régionaux (inexistants avant lui), Société d’archéologie, comité des archives d’Extrême-Orient, Société des orientalistes, Société nationale de géographie de Washington, Université de Vladivostok, Société des randonneurs? Ses biographes applaudissent bruyamment à l’énergie bouillonnante du grand explorateur.
À tort, peut-être. Il y a en effet comme un voile d’amertume sur la dernière décennie de sa vie, d’ailleurs gâchée par une sanglante tragédie familiale : ses parents, son frère, sa belle-sœur et ses deux sœurs massacrés par des voleurs à Doubobchtchina, en Ukraine (novembre 1918). En proie à une “routine insoutenable”, il se sent privé de sa liberté d’écrire. “Il ne me reste plus guère qu’une dizaine d’années à travailler, confie-t-il à l’académicien Oldenbourg. Après, on aura beau me passer au pressoir, plus une goutte ne sortira. Je songe à quitter mes charges administratives. Je ne répugnerais pas à prendre un petit emploi de relieur d’archives, pourvu que je puisse me libérer à 3 heures de l’après-midi pour mes activités favorites qui sont le sens de ma vie?” À l’évidence, ce ne sont pas là les propos d’un homme en harmonie avec lui-même. Mais il y a d’autres signes de contrariété : “La première fois que je suis arrivé dans le pays, les environs de Vladivostok étaient couverts de forêts où couraient toutes sortes de bêtes sauvages. Il n’y avait alors ni routes ni sentes. Chaque voyage dans la taïga imposait des privations et présentait même des risques de mort. Je me revois gravissant avec peine le “mont Chauve” à la source de la rivière Sédanka. Vingt-huit ans plus tard, j’y suis retourné. J’y ai trouvé des jeunes gens, garçons et filles, venus là en automobile? Ils avaient le cœur à rire, à plaisanter. Jamais ils n’auraient pu penser que l’homme qui passait près d’eux avait été le premier à tracer le chemin jusqu’ici, une lourde besace aux épaules, les vêtements déchirés, le visage en sueur.”
Arséniev, lui, n’a pas le cœur à rire. Il voit se faner la virginité d’un pays, pour laquelle il a milité, écrit. Les gens d’ici qui le tiennent pour leur “frère” sont en train de disparaître, emportant avec eux dans le néant une culture multiséculaire de communion avec la taïga. Leurs lettres sont des cris de mourants. Les jeunes automobilistes hilares l’agacent pour l’oubli qu’ils incarnent de ce savoir-vivre ancestral. Non que notre homme – pionnier du cinéma ethnographique – boude la modernité, mais il se regimbe contre l’acculturation qu’elle entraîne et sent bien que cette bataille est perdue.
En 1930, on le charge de superviser quatre expéditions de reconnaissance en vue de la construction d’un vaste réseau ferroviaire, ambitieux chantier de développement économique de la région. “Ce sera mon chant du cygne”, devine Arséniev. Il en revient malade, en effet, et s’éteint le 4 septembre de la même année. Ultime contrariété, celui qui rêvait d’être inhumé dans la taïga connaîtra un enterrement de ville dont parle ici sa femme : “Vladimir Klavdiévitch est mort d’un arrêt du cœur le surlendemain d’un accès de pneumonie striduleuse contractée sur le cours inférieur de l’Amour lors de sa dernière expédition. La ville entière était à ses obsèques, un cortège de plusieurs milliers de personnes. Je savais qu’il était populaire et chéri de beaucoup, mais jamais je n’aurais osé croire qu’il avait tant d’amis, qu’il était apprécié et respecté de tous.” En 1952, la bourgade de Semenovka fut rebaptisée Arséniev. On peut y voir, depuis 1972, un monument à la gloire conjointe du voyageur et de son ami Dersou.
Ce tandem de l’explorateur-écrivain et du guide indigène n’est pas un cas unique dans la Sibérie du XXe siècle. Il n’est qu’à citer l’exemple moins connu du géodésien Grigori Fédosseïev (1899-1968), continuateur de la tradition arséniévienne : Pachka de la tanière aux ours, L’Esprit mauvais de Yambouï, La mort m’attendra? Dans Le Chemin de l’épreuve, l’auteur brosse le portrait d’un guide évenk nommé Ouloukitkan, incarnation de cette même culture taïguéenne. (Mort nonagénaire d’un accident de chasse, l’Évenk survivra à “son” roman.) »
(p. 491-495)
Par-delà la « Grande Pierre » (p. 45-50)
En guise d’épilogue (p. 553-557)
Extrait court


