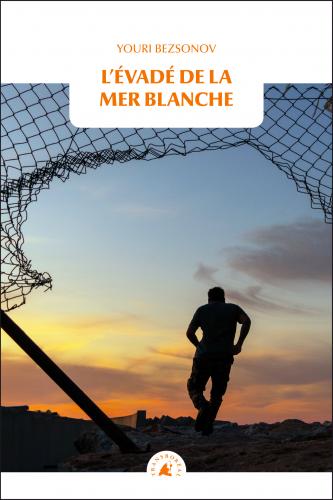
Première évasion :
« Le jour de l’évasion fut fixé. Il ne restait qu’à fuir.
Je souligne le fait que tout travail d’organisation en Russie est excessivement difficile. Les hommes ont peur les uns des autres, se méfient et craignent la provocation. Les nerfs se détraquent et, à mon avis, toute organisation dépassant plus de quatre à cinq personnes, et qui n’a pas passé, dans le plus court délai, des paroles aux actes, est vouée à la ruine. Cette situation fut la nôtre. Je jugeai que les préparatifs et les pourparlers étaient achevés. Il fallait agir sans retard.
Le 16 octobre 1919, je quittai le village Feodorovo. Il faisait très froid dehors, il n’y avait pas encore de neige. Le jour commençait à peine à poindre.
Il restait trois heures jusqu’au nettoyage des chevaux ; je voulais gagner du temps pour que, entre la poursuite et nous, il y eût une distance suffisante.
Je savais qu’après ma fuite il y aurait sûrement une enquête et, pour que les bolcheviks n’apprissent pas les noms de ceux qui m’avaient aidé à fuir, je devais me rencontrer avec mon guide dans un petit village voisin, ayant en tout cinq maisons et situé à 3 verstes du nôtre. Il avait été convenu que celui de nous qui y arriverait le premier ferait, sur la charpente d’une des isbas, avec de la craie, un signe convenu – une poêle à frire à manche –, entrerait dans cette même isba et y attendrait l’autre. Cela ne pouvait inspirer aucun soupçon, attendu que dans la zone du front il passe toujours beaucoup de monde.
J’arrivai le premier. Je traversai le village. Pas de signe? Je dessinai la poêle à frire, sans être aperçu, j’entrai dans l’isba et, ayant salué les maîtres et demandé un renseignement quelconque sur le débarcadère et les barques en partance, je m’assis et commençai à attendre?
Une demi-heure? puis une heure passa? Je sortis dans la rue? Je traversai pour la seconde fois le village? Rien.
J’avais conscience de ma situation, ma vie était en jeu? Les nerfs commencèrent à jouer. Et alors, pour la première fois, j’eus un doute au sujet du guide? Et ce doute me gâta, par la suite, la sensation de soulagement que l’homme ressent une fois délivré de la captivité.
Mais voici que la porte de l’isba s’ouvre et j’aperçois celui que j’attendais, Ivan Ivanovitch (je le nommerai ensuite ainsi). Je le connaissais à peine, on me l’avait un jour montré de loin et, à cet instant, pour ne pas révéler notre lien, nous ne nous saluâmes pas.
Il but de l’eau et fit claquer la porte. Je pris congé des paysans et suivis le guide.
La distance qui nous séparait était de cinquante pas? La matinée s’annonçait bonne, le soleil était levé, le givre couvrait l’herbe? Nous suivions la route.
“Non, tout va bien, pourquoi douter ?” pensai-je. Mais une nouvelle chiquenaude aux nerfs m’attendait bientôt.
Nous étions déjà hors du village quand j’aperçus un soldat rouge qui marchait à notre rencontre. Cela n’avait rien d’étonnant, puisque nous nous trouvions à l’arrière de l’armée Rouge. Ayant acquis l’habitude de surveiller automatiquement les gens qui m’entouraient, je le fixai et m’aperçus que lui aussi me fixait et marchait à ma rencontre. Nous voici l’un près de l’autre et, soudain, il m’appelle par mon petit nom et mon nom patronymique. Sur le coup, je sentis que ma fuite échouait, que j’étais trahi, que j’allais être arrêté, et puis? la fin certaine.
Je fis halte et tout à coup je reconnus dans ce soldat rouge l’un de ceux qui s’étaient chargés de faire parvenir une lettre à mon frère. Il me salua avec beaucoup d’amabilité. À son grand regret, il n’avait pas pu remplir entièrement la mission dont je l’avais chargé ; il me demanda où j’allais, me salua de nouveau et, m’ayant souhaité bon voyage, il continua son chemin.
De tels hasards sont insignifiants, mêmes stupides, mais ils frappent les nerfs plus douloureusement, plus fortement qu’une fuite ouverte ou une bataille. »
Six mois en cellule (p. 245-247)
La dernière évasion (p. 365-367)
Extrait court
« Le jour de l’évasion fut fixé. Il ne restait qu’à fuir.
Je souligne le fait que tout travail d’organisation en Russie est excessivement difficile. Les hommes ont peur les uns des autres, se méfient et craignent la provocation. Les nerfs se détraquent et, à mon avis, toute organisation dépassant plus de quatre à cinq personnes, et qui n’a pas passé, dans le plus court délai, des paroles aux actes, est vouée à la ruine. Cette situation fut la nôtre. Je jugeai que les préparatifs et les pourparlers étaient achevés. Il fallait agir sans retard.
Le 16 octobre 1919, je quittai le village Feodorovo. Il faisait très froid dehors, il n’y avait pas encore de neige. Le jour commençait à peine à poindre.
Il restait trois heures jusqu’au nettoyage des chevaux ; je voulais gagner du temps pour que, entre la poursuite et nous, il y eût une distance suffisante.
Je savais qu’après ma fuite il y aurait sûrement une enquête et, pour que les bolcheviks n’apprissent pas les noms de ceux qui m’avaient aidé à fuir, je devais me rencontrer avec mon guide dans un petit village voisin, ayant en tout cinq maisons et situé à 3 verstes du nôtre. Il avait été convenu que celui de nous qui y arriverait le premier ferait, sur la charpente d’une des isbas, avec de la craie, un signe convenu – une poêle à frire à manche –, entrerait dans cette même isba et y attendrait l’autre. Cela ne pouvait inspirer aucun soupçon, attendu que dans la zone du front il passe toujours beaucoup de monde.
J’arrivai le premier. Je traversai le village. Pas de signe? Je dessinai la poêle à frire, sans être aperçu, j’entrai dans l’isba et, ayant salué les maîtres et demandé un renseignement quelconque sur le débarcadère et les barques en partance, je m’assis et commençai à attendre?
Une demi-heure? puis une heure passa? Je sortis dans la rue? Je traversai pour la seconde fois le village? Rien.
J’avais conscience de ma situation, ma vie était en jeu? Les nerfs commencèrent à jouer. Et alors, pour la première fois, j’eus un doute au sujet du guide? Et ce doute me gâta, par la suite, la sensation de soulagement que l’homme ressent une fois délivré de la captivité.
Mais voici que la porte de l’isba s’ouvre et j’aperçois celui que j’attendais, Ivan Ivanovitch (je le nommerai ensuite ainsi). Je le connaissais à peine, on me l’avait un jour montré de loin et, à cet instant, pour ne pas révéler notre lien, nous ne nous saluâmes pas.
Il but de l’eau et fit claquer la porte. Je pris congé des paysans et suivis le guide.
La distance qui nous séparait était de cinquante pas? La matinée s’annonçait bonne, le soleil était levé, le givre couvrait l’herbe? Nous suivions la route.
“Non, tout va bien, pourquoi douter ?” pensai-je. Mais une nouvelle chiquenaude aux nerfs m’attendait bientôt.
Nous étions déjà hors du village quand j’aperçus un soldat rouge qui marchait à notre rencontre. Cela n’avait rien d’étonnant, puisque nous nous trouvions à l’arrière de l’armée Rouge. Ayant acquis l’habitude de surveiller automatiquement les gens qui m’entouraient, je le fixai et m’aperçus que lui aussi me fixait et marchait à ma rencontre. Nous voici l’un près de l’autre et, soudain, il m’appelle par mon petit nom et mon nom patronymique. Sur le coup, je sentis que ma fuite échouait, que j’étais trahi, que j’allais être arrêté, et puis? la fin certaine.
Je fis halte et tout à coup je reconnus dans ce soldat rouge l’un de ceux qui s’étaient chargés de faire parvenir une lettre à mon frère. Il me salua avec beaucoup d’amabilité. À son grand regret, il n’avait pas pu remplir entièrement la mission dont je l’avais chargé ; il me demanda où j’allais, me salua de nouveau et, m’ayant souhaité bon voyage, il continua son chemin.
De tels hasards sont insignifiants, mêmes stupides, mais ils frappent les nerfs plus douloureusement, plus fortement qu’une fuite ouverte ou une bataille. »
(p. 116-118)
Six mois en cellule (p. 245-247)
La dernière évasion (p. 365-367)
Extrait court


