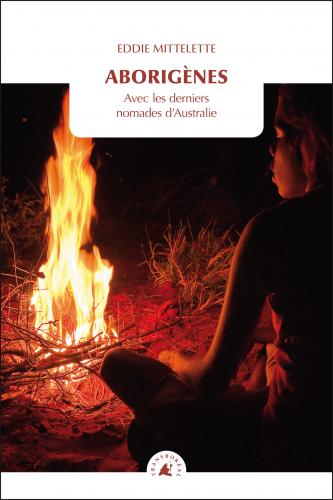
Jean-Yves Mounier, Le Randonneur n° 62, septembre 2016 :
« L’Australie, vaste pays aux distances extrêmes entre deux villes ou villages, n’est pas la destination favorite des cyclovoyageurs et c’est déjà une première bonne raison pour ouvrir ce récit qui nous narre deux voyages en solitaire sur les pistes de l’Ouest australien. Ce serait cependant une grave erreur de réduire ce livre à un simple récit de voyage car Eddie, durant ses deux années pédalées sur l’île-continent, va utiliser sa bicyclette pour aller à la rencontre, authentique et en profondeur, des derniers Natifs du désert, ces fameux Aborigènes qui peuplaient le sous-continent bien avant l’arrivée des Européens.
Sa démarche est originale et soucieuse d’aller au plus près des populations autochtones : il n’hésite ainsi pas à s’asseoir à l’ombre de l’appentis d’une épicerie, sur un banc, équivalent social des “lavoirs et parvis d’église de nos villages”, provoquant la rencontre et l’entrée dans l’intimité des familles. Le regard ethnologique d’Eddie va s’affiner au fil des kilomètres entre Territoire du Nord et Australie-Occidentale : dans un texte clair, précis et très documenté, il nous fait partager les difficultés d’intégration des Aborigènes confrontés aux intérêts économiques fort éloignés de leurs traditions, le dilemme des plus jeunes générations devant choisir entre vie moderne ou retour aux racines ancestrales ou encore les conflits nés de la conception actuelle du voyage, motorisé et rapide, et de celle plus traditionnelle des nomades. Un témoignage de très grande qualité qui relate également, même si c’est de manière plus marginale, les conditions de voyage à bicyclette à travers ces étendues inhospitalières, voyage sans impératif ni billet de retour mais avec parfois 39 litres d’eau sur le vélo pour parcourir 500 kilomètres en sept jours? »
Jonathan Rodriguez, bscnews.fr, le 6 juin 2016 :
« Un homme et son vélo. Eddie Mittelette a parcouru 11 000 kilomètres à vélo en solitaire sur les pistes de l’Ouest australien pour aller à la rencontre des Aborigènes, derniers nomades d’Australie. Un voyage incroyable et grandiose où l’on accompagne l’auteur pendant presque 300 pages aux confins d’un des pays les plus vastes du monde. Un ouvrage riche, sous forme de témoignage sincère et touchant, d’une population oubliée de notre monde, à la culture fascinante et au destin tragique.
“À quelques encablures de Marble Bar – localité qui détient le record des températures moyennes les plus élevées d’Australie – apparaissent les reliefs caractéristiques des confins du Grand Désert de sable : un horizon repoussé aux limites du monde, de longues chaînes de collines aux sommets couverts d’un tapis de Spinifex et d’arbustes rabougris [?] ‘Avant que la nuit tombe, m’explique Clifford, quand la lumière rasante nimbe la roche d’un rouge intense, on a l’impression que les gorges de Doolena sont comme la braise incandescente. Elles se reflètent dans l’eau noire avec la netteté d’un miroir.’”
Aborigènes est d’abord un beau récit de voyage. Une finesse d’écriture, qui excelle dans cette manière de capter l’essence d’un environnement, la vérité d’un instant. Il nous permet de capter l’ambiance d’un tableau magnifique que l’on construit avec lui, grâce notamment à la richesse de son vocabulaire, parsemé de métaphores, contribuant à donner pleine vie cet environnement, à ces paysages. Ces déserts de sable rouge, ces plaines perdues sont comme imprimés dans notre mémoire. Mais Aborigènes est aussi et surtout un témoignage saisissant sur cette population et sa culture. Rare et précieux, Eddie Mittelette nous livre des clés historiques, ethnologiques et politiques de compréhension d’une civilisation ancestrale en perdition. Ludique, il est aussi alarmant par le constat d’un peuple en pleine mutation, où l’économie matérialiste est venue s’imposer dans son mode de vie.
“Cependant, alors que j’accumule des connaissances sur cette civilisation à l’agonie, le délitement de ses richesses immatérielles accroît mon dégoût du monde dans lequel j’évolue, du paradoxe que nous édifions en pansant nos saccages au lieu de les prévenir. Pour ensuite avoir l’audace de nous en émouvoir. L’époque actuelle devrait tirer les enseignements d’un peuple qu’elle a considéré comme primitif et ourlé de mœurs douteuses ; lui qui, en près de soixante mille ans, n’a pas échafaudé sa propre destruction en sciant la branche sur laquelle il est assis. Car chez les Aborigènes, l’homme appartient à la nature, pas l’inverse. Il ne la cultive pas ni ne tente de la dompter. Il cohabite intelligemment avec elle.”
Cette multiplicité d’apports et d’analyses en fait sa force et sa singularité. Réellement humaniste, profondément sincère et d’une humilité revigorante, le livre d’Eddie Mittelette est d’une vraie richesse : à la fois cri d’amour, pamphlet écologique, récit humain, analyse documentée et déclaration de la beauté de ce monde. On l’accompagne volontiers dans cette intime compréhension de la culture aborigène. Las, on devient également spectateur de l’effondrement d’une civilisation et au dérèglement d’un territoire ayant vécu la violence des premiers colons – à l’instar des Indiens d’Amérique – et de leur politique d’assimilation forcée dès le berceau, forcément dévastatrice, aujourd’hui condamnée à s’adapter au monde libéral sous peine de disparaître. Ce qu’il appelle “les sirènes de la consommation”. Un sursaut d’espoir persiste tout de même : celui d’une culture inhérente à son peuple, qui conserve une relation privilégiée avec ses racines et sa spiritualité, gardant cette part de mystère et de mystique imprévisible. Il permet aussi d’être un moyen de parler de leurs tentatives d’autodétermination depuis des décennies, maladroitement prise en considération par les actions de l’État australien.
Une phrase de Bruce Elder en 1988, habilement choisie pour introduire la seconde partie, résume le sort des derniers nomades : “Nous leur avons ôté leur raison d’exister et quand, dans leur désarroi, ils ont sombré dans l’alcool ou ont succombé au désespoir et ont renoncé à vivre, nous avons eu l’arrogance de les accuser d’ivrognerie et de paresse.” Il en reste un portrait déchirant et emphatique qui nous ouvre les yeux sur un peuple que l’on ne connaît que trop peu. Un livre pour ne jamais les oublier.
“Il est temps pour moi d’avancer, même si la bienveillance des habitants de Wiluna m’encourage à poser mes valises. Beaucoup de personnes m’ont ouvert les portes de leur maison, ont accueilli ma sincérité sans délai ni contrepartie. Ils me prouvent d’une belle manière que les préjugés ont bâti de solides remparts entre les Aborigènes de cette région et leurs détracteurs – qui pour certains n’y ont jamais posé le pied. Ces familles m’ont fourni des arguments imparables à opposer aux inepties qui circulent sur leur compte. C’est un formidable cadeau de paix.” »
Joëlle Costagliola, lectrice, le 6 juin 2016 :
« Merci de m’avoir fait voyager avec vous en Australie. Votre témoignage de la vie actuelle des Aborigènes fait suite et complète ce que j’avais pu lire sur la colonisation et les peintures de cette population pour qui j’ai un grand respect. J’ai partagé avec bonheur votre tendresse et votre émerveillement tout au long de votre parcours et vous en suis très reconnaissante. »
David Fillon, lecteur, le 31 mai 2016 :
« Je viens de terminer votre livre qui m’a donc beaucoup plu et intéressé. Il est instructif, esthétique et politique (dans le sens noble du terme).
Instructif, parce qu’il dispense des connaissances : géographiques, historiques, ethnologiques, sociologiques sur un pays qui m’a toujours attiré et fasciné (eh oui, moi aussi je suis australophile?) et constitue une forme de somme accessible sur les Aborigènes (bien que j’avoue avoir un tantinet décroché lorsque vous évoquez la question des “groupes de peau” et des sous-groupes : j’aurais besoin d’un cours de rattrapage !).
Esthétique, parce qu’il est très bien écrit, et le récit de la belle aventure courageuse, faite d’efforts récompensés au centuple, bien mené : le contemplatif que je suis y trouve les belles images littéraires dont il se réjouit telle que “Devant nous, une plaine de Spinifex étend son tapis vert-de-gris aux notes bleutées. Mes pensées naviguent sur ce sentier qui s’éloigne et plonge derrière l’horizon comme un sillage orangé sur une mer étale” – transcription de moments et de sensations qui font se sentir incroyablement vivant.
Politique pour l’humanité et l’état d’esprit qu’il renvoie. Des références qui sont aussi les miennes m’ont touché : notamment Midnight Oil, Bouvier, Kenneth Cook dans Cinq matins de trop, comme l’influence perceptible de Chatwin et d’Abbey. Je vous reçois 5/5 lorsque vous évoquez le “dégoût du monde [matérialiste et cupide] dans lequel j’évolue”, “les succulences brutes et non frelatées” de l’outarde dégustée autour du waru, Internet et la télévision qui “se chargent de l’éducation des adolescents en leur servant des contenus vidangés de toute profondeur spirituelle” (ce qui est certainement devenu vrai partout dans le monde).
Enfin, et c’est précieux à ce moment de ma vie, votre livre me conforte dans l’idée d’en changer, me donne l’envie de parcourir le monde lentement, de m’imprégner des lieux et des us des habitants, de retourner pourquoi pas en Australie (l’un de mes vieux projets, après avoir trop peu goûté en 2010 la sérénité et la beauté austère des MacDonnell, serait d’en effectuer à pied la traversée est-ouest : dans le bon sens du vent donc !
Re-enfin : les photos sont très belles et, avec l’insertion de cartes bien utiles, complètent la réussite de votre livre, qui m’habitera.
Des critiques négatives ? Ben, je suis désolé, j’en ai pas ! Bon allez, une en me forçant un peu : j’aurais choisi une autre photo (peut-être plus “emblématique”) pour la couverture. »
Joëlle Saulas, enlisantenvoyageant.blogspot.fr, le 20 novembre 2015 :
La présentation d’Eddie Mittelette sur le site de l’éditeur est parfaite (je la découvre en terminant ce récit?) car elle montre bien que l’auteur en a sous la pédale question Australie et ne s’est pas lancé comme ça en 2010 puis en 2013 à vélo dans l’Ouest australien pour vivre quelques mois avec les Martu. Fasciné par le récit de l’expédition Peasley en 1977, organisée pour récupérer un couple d’Aborigènes en plein désert (les derniers à vivre ainsi) et champion de boomerang, Eddie Mittelette désire passer du temps avec les habitants du désert et séjourne avec la tribu martu, dont il nous fait découvrir la vie, entre modernisme et tradition. On sent parfaitement son respect lucide à l’égard des personnes rencontrées. Il ne nous impose pas des pages arides sur leur histoire et leurs façons de vivre, leurs problèmes de santé par exemple ou les spoliations dont ils ont été victimes ; il en dit juste assez. Au lecteur d’aller plus loin en compulsant l’abondante bibliographie (et une bibliographie commentée, ça c’est excellent, et même une filmographie ainsi qu’une discographie commentées, une vraie mine !). J’ai dévoré ce récit, qui a trouvé le juste équilibre en longueur, je tiens à le signaler, non dénué d’humour et quand même plein d’informations sur la faune et la flore, en plus du récit de rencontres fortes. »


