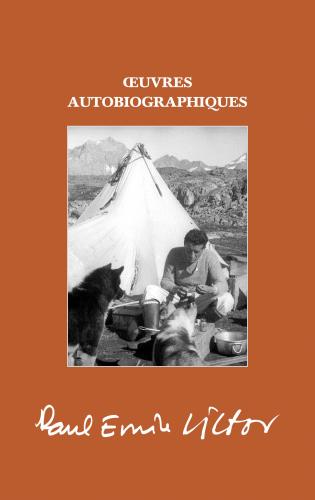
Tome I, La Mansarde – La villa Bernard, le séquoia et le gibus à poils :
« Cinq heures du matin. Le train entre en gare de Lons. Il pleut. La pluie descend des montagnes du Jura. La gare disparaît dans la vapeur qui s’échappe des flancs de la locomotive essoufflée. Les quais noirs brillent comme ceux d’un port. L’air est saturé de l’odeur des chemins de fer : fumée de charbon, graisse de locomotive, acétylène de lampistes et tabliers d’écoliers revenant de l’école, puanteur doucereuse que les grandes personnes donnent aux compartiments toujours fermés, comme les enfants aux classes hermétiques. L’odeur des premières images de Zéro de conduite, le film de Jean Vigo.
La pluie fine, huileuse, tombe lentement. Elle brille comme de la neige dans la lumière de la lampe qui éclaire (mal) la pancarte d’émail bleu ébréché des “cabinets hommes”. Je tends mon billet à l’employé, mal réveillé comme moi-même.
Les maisons et les rues encore endormies. La solitude d’une fenêtre éclairée. Sur mon dos, le sac pèse lourd : je reviens d’un camp scout. La pluie rafraîchit mon visage marqué de suie et mes genoux barbouillés de terre. J’ai 14 ans.
Dans le jardin paternel, l’odeur des trains fait place au parfum des iris, des feuilles vertes et de la terre mouillée. Sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit sur le gravier, je passe devant les bas-reliefs de stuc qui m’effrayaient tant, le soir, lorsque j’étais enfant. Le jardin qui me paraissait immense, complexe, mystérieux, a depuis longtemps repris des proportions normales.
Aux fenêtres, pas de lumière : on ne m’attend pas.
Le séquoia pousse au bord de l’allée de graviers. Sa pointe dépasse de peu le rebord de la fenêtre de la salle à manger, au premier étage. Par-delà, on peut voir, lorsqu’on se met à table, les collines violettes et rousses des premiers contreforts du Jura. Ses branches touffues frôlent le sol jonché d’aiguilles et la bordure de buis de l’allée.
Je ne veux pas réveiller les miens. Je veux prolonger l’“Aventure” de quelques instants encore. Je me roule dans ma couverture, tout contre le tronc, avec mon sac comme oreiller. J’écoute longtemps l’arbre et la pluie qui chuchotent. Je savoure l’odeur de résine et le parfum de la glaise. La nuit me cache la maison toute proche. Je bivouaque pour la première fois de ma vie. Je suis libre, je suis heureux.
C’est là, au pied du séquoia, que ma mère me découvrit, dormant à poings fermés, mouillé de la tête aux pieds. Je fus déçu de ne lire aucun étonnement dans son visage, surpris qu’elle ne me fît aucun reproche. En montant l’escalier derrière elle, je constatai combien elle était à la hauteur de l’événement. Je devais le constater bien souvent depuis? »
Tome II, L’Iglou – Épilogue (p. 369-370)
Tome III, Expéditions – Dialogues à une voix (p. 264-265)
Extrait court
« Cinq heures du matin. Le train entre en gare de Lons. Il pleut. La pluie descend des montagnes du Jura. La gare disparaît dans la vapeur qui s’échappe des flancs de la locomotive essoufflée. Les quais noirs brillent comme ceux d’un port. L’air est saturé de l’odeur des chemins de fer : fumée de charbon, graisse de locomotive, acétylène de lampistes et tabliers d’écoliers revenant de l’école, puanteur doucereuse que les grandes personnes donnent aux compartiments toujours fermés, comme les enfants aux classes hermétiques. L’odeur des premières images de Zéro de conduite, le film de Jean Vigo.
La pluie fine, huileuse, tombe lentement. Elle brille comme de la neige dans la lumière de la lampe qui éclaire (mal) la pancarte d’émail bleu ébréché des “cabinets hommes”. Je tends mon billet à l’employé, mal réveillé comme moi-même.
Les maisons et les rues encore endormies. La solitude d’une fenêtre éclairée. Sur mon dos, le sac pèse lourd : je reviens d’un camp scout. La pluie rafraîchit mon visage marqué de suie et mes genoux barbouillés de terre. J’ai 14 ans.
Dans le jardin paternel, l’odeur des trains fait place au parfum des iris, des feuilles vertes et de la terre mouillée. Sur la pointe des pieds pour ne pas faire de bruit sur le gravier, je passe devant les bas-reliefs de stuc qui m’effrayaient tant, le soir, lorsque j’étais enfant. Le jardin qui me paraissait immense, complexe, mystérieux, a depuis longtemps repris des proportions normales.
Aux fenêtres, pas de lumière : on ne m’attend pas.
Le séquoia pousse au bord de l’allée de graviers. Sa pointe dépasse de peu le rebord de la fenêtre de la salle à manger, au premier étage. Par-delà, on peut voir, lorsqu’on se met à table, les collines violettes et rousses des premiers contreforts du Jura. Ses branches touffues frôlent le sol jonché d’aiguilles et la bordure de buis de l’allée.
Je ne veux pas réveiller les miens. Je veux prolonger l’“Aventure” de quelques instants encore. Je me roule dans ma couverture, tout contre le tronc, avec mon sac comme oreiller. J’écoute longtemps l’arbre et la pluie qui chuchotent. Je savoure l’odeur de résine et le parfum de la glaise. La nuit me cache la maison toute proche. Je bivouaque pour la première fois de ma vie. Je suis libre, je suis heureux.
C’est là, au pied du séquoia, que ma mère me découvrit, dormant à poings fermés, mouillé de la tête aux pieds. Je fus déçu de ne lire aucun étonnement dans son visage, surpris qu’elle ne me fît aucun reproche. En montant l’escalier derrière elle, je constatai combien elle était à la hauteur de l’événement. Je devais le constater bien souvent depuis? »
(p. 59-60)
Tome II, L’Iglou – Épilogue (p. 369-370)
Tome III, Expéditions – Dialogues à une voix (p. 264-265)
Extrait court


