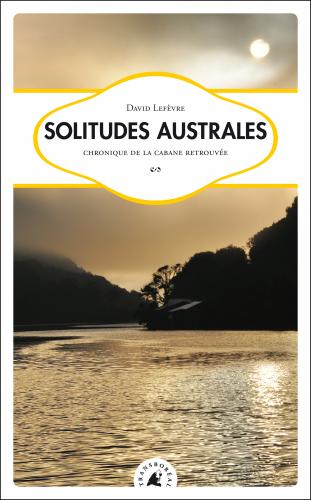
Octobre :
« Mes premières promenades jusqu’à l’océan étaient tissées de minuscules rencontres. Je ne sais pas si c’était l’effet de mon isolement, mais à Cucao chacun à sa manière semblait vivre esseulé. Les habitants paraissaient se saluer de loin, se visiter peu. Je me disais que les îles ont leurs propres codes et qu’il faudrait un temps pour que l’expérience m’enseigne les clés particulières à celle-ci. Ainsi sont les insulaires. Toujours dans l’ombre des continents, s’exprimant dans un autre langage, l’âme trempée dans un autre bois, leurs cultures empruntant d’autres postures. Puis, le moment venu, les jours et les heures ont pris toute leur place. Mes sorties au-dehors n’avaient pas à être nombreuses : ma présence était repérée. Dans les esprits, j’étais fiché. Les langues se sont déliées et, à mesure que s’allongeait mon séjour, mon statut de simple passant s’est changé en résidant. J’étais devenu quelqu’un du coin. Les gens s’intéressent toujours à celui qui montre une envie de rester, qui pose des questions. Parce qu’ils aiment satisfaire cette sorte de curiosité, parce qu’ils ont senti qu’il s’attarde pour autre chose. C’est alors que des visages s’ouvrent, qu’on aurait cru à tort froids comme la glace. Puis, un jour, on est adopté.
Souvent, je croisai le même cavalier dressé sur une jument pie. De longues traînes de cochayuyo – une laminaire comestible semblable à une lanière de cuir – étaient amoncelées sur la croupe de sa monture. L’homme semblait occupé à une espèce de soliloque intérieur, et j’hésitai à interrompre sa route. Il avait belle allure en dépit de son air renfrogné qui se repérait de loin et ne variait pas d’un pouce à mon approche. L’heure n’était pas arrivée d’engager la conversation. Ce n’était pas l’envie qui m’en manquait mais il faut savoir laisser à leur royaume les cavaliers taciturnes. Exit donc l’homme à la belle pouliche, c’est ce que je m’étais dit. Puis un jour, il a stoppé à ma hauteur et m’a questionné : “Ça fait pas mal de temps que tu es perdu dans le coin ?” J’ai avoué que le coin était plutôt vaste et qu’il y avait de quoi s’éterniser pour peu qu’on soit riche de son temps. J’ai découvert l’homme. Son visage bruni, son regard attentif, et l’air un brin roublard qu’il dissimulait derrière cette froide apparence. Je venais de passer une épreuve. Il a mis sa jument à l’attache et m’a proposé de l’accompagner. Nous avons marché, j’ai suivi son pas alerte, sa démarche légèrement chaloupée. De temps à autre, il s’écartait, se penchait sur un rocher et ajoutait une algue au millefeuille qu’il superposait sur son épaule.
Mes rencontres avec lui se sont multipliées. Si ce n’était pas dans les environs de Chanquín, c’était près de la pointe baptisée Pirulil, dans le secteur ou les derniers chercheurs d’or ont installé leurs chevalets et leurs trémies, que je le retrouvais. Je reconnaissais l’empreinte des sabots qui tassaient le sable comme à l’emporte-pièce. Au loin, dans le bandeau de vapeur, se dessinait tôt ou tard une silhouette équestre de la taille d’une allumette aux contours étirés. Nous faisions un nouveau bout de chemin ensemble. Nous échangions quelques mots.
Puis un jour, j’ai été invité. C’était une petite maison basse de plafond qui avait pourtant été plusieurs fois agrandie. Des bûches de tepu étaient soigneusement empilées sous l’avant-toit. Le poêle ronflait, sa chaleur rougissait les oreilles. J’ai donc fait la connaissance de doña Carmen, la femme de don Gustavo. Des pommettes écarlates, de beaux yeux bleus dans un visage rond.
J’ai le sentiment que c’était il y a des années. À chaque nouvelle visite, on dirait que la bande a précédé mon arrivée. L’accueil est maternel, dame Carmen est aux petits soins. Sa disponibilité est toujours la même. Qu’il ait plu, et il faut d’urgence suspendre vestes et bonnets au-dessus de la plaque en fonte. Elle me fait alors asseoir sur la banquette poussée contre le mur. Elle pose devant moi un pain chaud emmailloté dans un torchon, belle miche ronde qui emplit la pièce de son odeur. Elle apporte ensuite une petite assiette et une coupelle de beurre dans laquelle est planté un couteau. Elle sort du buffet un pot de confiture de murtas et m’oblige à manger. Après quoi, elle se prépare un maté sucré et se cache derrière son col comme une jeune fille timide. Plus tard, elle racontera. Mais je dois d’abord engloutir une ou deux tartines. »
Décembre (p. 110-111)
Janvier (p. 122-124)
Extrait court
« Mes premières promenades jusqu’à l’océan étaient tissées de minuscules rencontres. Je ne sais pas si c’était l’effet de mon isolement, mais à Cucao chacun à sa manière semblait vivre esseulé. Les habitants paraissaient se saluer de loin, se visiter peu. Je me disais que les îles ont leurs propres codes et qu’il faudrait un temps pour que l’expérience m’enseigne les clés particulières à celle-ci. Ainsi sont les insulaires. Toujours dans l’ombre des continents, s’exprimant dans un autre langage, l’âme trempée dans un autre bois, leurs cultures empruntant d’autres postures. Puis, le moment venu, les jours et les heures ont pris toute leur place. Mes sorties au-dehors n’avaient pas à être nombreuses : ma présence était repérée. Dans les esprits, j’étais fiché. Les langues se sont déliées et, à mesure que s’allongeait mon séjour, mon statut de simple passant s’est changé en résidant. J’étais devenu quelqu’un du coin. Les gens s’intéressent toujours à celui qui montre une envie de rester, qui pose des questions. Parce qu’ils aiment satisfaire cette sorte de curiosité, parce qu’ils ont senti qu’il s’attarde pour autre chose. C’est alors que des visages s’ouvrent, qu’on aurait cru à tort froids comme la glace. Puis, un jour, on est adopté.
Souvent, je croisai le même cavalier dressé sur une jument pie. De longues traînes de cochayuyo – une laminaire comestible semblable à une lanière de cuir – étaient amoncelées sur la croupe de sa monture. L’homme semblait occupé à une espèce de soliloque intérieur, et j’hésitai à interrompre sa route. Il avait belle allure en dépit de son air renfrogné qui se repérait de loin et ne variait pas d’un pouce à mon approche. L’heure n’était pas arrivée d’engager la conversation. Ce n’était pas l’envie qui m’en manquait mais il faut savoir laisser à leur royaume les cavaliers taciturnes. Exit donc l’homme à la belle pouliche, c’est ce que je m’étais dit. Puis un jour, il a stoppé à ma hauteur et m’a questionné : “Ça fait pas mal de temps que tu es perdu dans le coin ?” J’ai avoué que le coin était plutôt vaste et qu’il y avait de quoi s’éterniser pour peu qu’on soit riche de son temps. J’ai découvert l’homme. Son visage bruni, son regard attentif, et l’air un brin roublard qu’il dissimulait derrière cette froide apparence. Je venais de passer une épreuve. Il a mis sa jument à l’attache et m’a proposé de l’accompagner. Nous avons marché, j’ai suivi son pas alerte, sa démarche légèrement chaloupée. De temps à autre, il s’écartait, se penchait sur un rocher et ajoutait une algue au millefeuille qu’il superposait sur son épaule.
Mes rencontres avec lui se sont multipliées. Si ce n’était pas dans les environs de Chanquín, c’était près de la pointe baptisée Pirulil, dans le secteur ou les derniers chercheurs d’or ont installé leurs chevalets et leurs trémies, que je le retrouvais. Je reconnaissais l’empreinte des sabots qui tassaient le sable comme à l’emporte-pièce. Au loin, dans le bandeau de vapeur, se dessinait tôt ou tard une silhouette équestre de la taille d’une allumette aux contours étirés. Nous faisions un nouveau bout de chemin ensemble. Nous échangions quelques mots.
Puis un jour, j’ai été invité. C’était une petite maison basse de plafond qui avait pourtant été plusieurs fois agrandie. Des bûches de tepu étaient soigneusement empilées sous l’avant-toit. Le poêle ronflait, sa chaleur rougissait les oreilles. J’ai donc fait la connaissance de doña Carmen, la femme de don Gustavo. Des pommettes écarlates, de beaux yeux bleus dans un visage rond.
J’ai le sentiment que c’était il y a des années. À chaque nouvelle visite, on dirait que la bande a précédé mon arrivée. L’accueil est maternel, dame Carmen est aux petits soins. Sa disponibilité est toujours la même. Qu’il ait plu, et il faut d’urgence suspendre vestes et bonnets au-dessus de la plaque en fonte. Elle me fait alors asseoir sur la banquette poussée contre le mur. Elle pose devant moi un pain chaud emmailloté dans un torchon, belle miche ronde qui emplit la pièce de son odeur. Elle apporte ensuite une petite assiette et une coupelle de beurre dans laquelle est planté un couteau. Elle sort du buffet un pot de confiture de murtas et m’oblige à manger. Après quoi, elle se prépare un maté sucré et se cache derrière son col comme une jeune fille timide. Plus tard, elle racontera. Mais je dois d’abord engloutir une ou deux tartines. »
(p. 38-40)
Décembre (p. 110-111)
Janvier (p. 122-124)
Extrait court


